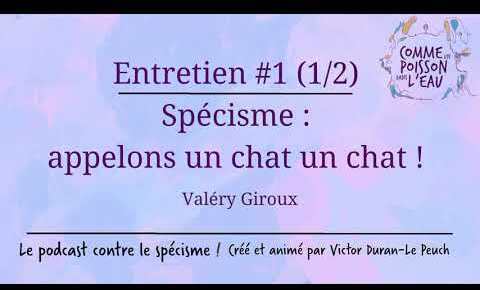Description
Bienvenue dans Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme ! Si vous ne savez pas ce qu'est le spécisme, c'est parfait vous êtes arrivé.e au bon endroit pour en savoir plus ! Dans ce premier entretien de Comme un poisson dans l'eau, Valéry Giroux nous explique ce qu'est le spécisme. Nous avons également abordé ensemble un certain nombre d'objections à la position antispéciste, distingué entre plusieurs dimensions du spécisme et nous nous sommes demandé s'il est pertinent de comparer l'exploitation des animaux non humains avec l'esclavage.
Transcription
Voir la transcription
Victor Duran-Le Peuch : Salut, moi c'est Victor Durand-Lepeuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme.
Victor Duran-Le Peuch : Pour lancer ce podcast, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir pour un double épisode Valéry Giroux. Valéry Giroux est juriste et chercheuse en philosophie morale. Elle a rédigé la première thèse en éthique animale en français au Québec. Elle est la coordinatrice du Centre de recherche en éthique québécois, logé à l'Université de Montréal, et fellow du Oxford Centre for Animal Ethics. Elle est également éditrice à L’Amorce, revue contre le spécisme. L’Amorce a récemment fêté ses trois ans, et c'est vraiment une super revue et une grande source d'inspiration pour moi, donc je vous invite vraiment à aller lire les articles de L’Amorce. Et enfin, Valéry Giroux est l'autrice du «Que sais-je sur l'antispécisme», aux éditions PUF, et la co-autrice du «Que sais-je sur le véganisme». C'est donc la personne à qui s'adresser pour mieux comprendre ce qu'est le spécisme.
Victor Duran-Le Peuch : Bonjour Valéry Giroux.
Valéry Giroux : Bonjour Victor.
Victor Duran-Le Peuch : C'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous recevoir dans ce premier épisode de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Alors chers auditeurices, si vous ne savez pas ce que c'est le spécisme, eh bien déjà c'est bien, vous êtes au bon endroit. Et surtout, ne vous en faites pas, ça n'a rien d'étonnant en fait, puisque le mot antispécisme a fait son entrée dans le Larousse en 2020. Et 2020, Valéry Giroux, c'est aussi l'année de la sortie de votre petit «Que sais-je sur l'antispécisme» aux éditions PUF. Alors on comprend bien que l'antispécisme s'oppose a priori au spécisme, mais alors Valéry Giroux, est-ce que vous pouvez nous expliquer, ce qu'est le spécisme?
Valéry Giroux : Oui, avec plaisir, je vais essayer de le faire. En fait, il y a une définition du spécisme que j'aime bien et qui est celle qui est donnée par les cahiers antispécistes. Si vous permettez, j'aimerais vous la lire parce que je trouve qu'elle est très éclairante.
Victor Duran-Le Peuch en aparté : Alors, les cahiers antispécistes, je pense que vous en entendrez souvent parler dans ce podcast. C'est la revue de référence sur la question du spécisme qui a été créée en France en 1991 par David Olivier, Françoise Blanchon et Yves Bonnardel pour faire exister les réflexions autour de ce concept. Tous les numéros de la revue sont disponibles sur le site des cahiers antispécistes et je vous recommande chaudement d'aller y faire un tour. C'est le moment de vous dire que ce podcast contient en réalité deux formats. Un format Entretien que vous êtes en train d'écouter et un format Lecture qui viendra en complément du thème traité dans l'épisode principal. Je ne veux pas vous spoiler l'épisode de la semaine prochaine, mais il s'agira, de la lecture d'un des textes fondateurs des cahiers antispécistes. Comme ça, ça vous donnera l'occasion de découvrir la revue. Et voici donc la définition du spécisme tel que défini par les cahiers antispécistes.
Valéry Giroux : On nous dit le spécisme est à l'espèce ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe. La volonté de ne pas prendre en compte ou de moins prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d'autres en prétextant des différences réelles ou imaginaires, mais toujours dépourvus de liens logiques avec ce qu'ils sont censés justifier. En gros, l'idée c'est que comme la couleur de la peau ou le fait d'avoir des organes reproducteurs féminins ou masculins, le fait d'être classé dans un groupe taxonomique ou un autre ne détermine pas en soi la valeur morale d'un individu et ça ne devrait pas affecter l'importance morale qu'on accorde à ses intérêts. Ça c'est en fait la position antispéciste, la position qui critique le spécisme. Et pour montrer ça donc ... que l'appartenance à une espèce ou une autre n'a pas la pertinence morale requise, certains auteurs vont avoir recours à des expériences de pensée comme on le fait souvent chez les philosophes. Il y a James Rachels, par exemple, qui rapporte que Eando Binder aurait imaginé un professeur venu de la planète Mars qui subissait les moqueries mesquines de ses élèves parce qu'il était physiquement différent des êtres humains. Il avait des tentacules, pardon, la peau très épaisse. Il était très grand, nous le disaient les auteurs. Et au plan intellectuel et émotif, il était pourtant très semblable à nous. La fable de ces auteurs-là porte en fait sur le racisme. En prenant l'exemple d'un être d'une autre espèce que la nôtre, mais semblable à nous psychologiquement, on est censé se rendre compte que les différences strictement physiques ou biologiques, comme la couleur de la peau, n'ont pas en tant que telles de pertinence morale. Et ça, bien en fait... Et c'est étonnamment peu contesté par les personnes qui cherchent à justifier la discrimination en fonction de l'espèce, ou à défendre le spécisme. En effet, la plupart des gens qui veulent montrer qu'il est légitime d'accorder moins de valeur aux animaux non humains ou à leurs intérêts qu'aux êtres humains ou à leurs intérêts équivalents, vont reconnaître bien sûr que ce n'est pas l'espèce en tant que telle qui est le critère qui fait toute la différence, mais des attributs typiquement associés à l'espèce. On va par exemple soutenir que si les êtres humains comptent plus moralement que les cochons, les poules, les poissons, ce n'est pas en soi parce qu'ils appartiennent à l'espèce homo sapiens, mais parce que les membres de l'espèce homo sapiens seraient les seuls à avoir une âme peut-être, ou à avoir été créés à l'image de Dieu. Aujourd'hui, les caractéristiques de l'humanité qui sont les plus souvent évoquées pour justifier la place des êtres humains tout en haut de la hiérarchie morale des êtres, c'est surtout des choses comme la conscience de soi, les capacités langagières, la capacité de se rappeler d'un passé lointain ou de se projeter dans un avenir lointain, ou encore l'autonomie rationnelle, ou l’agentivité morale. On a tendance à dire que ce n'est pas comme tel parce qu'on possède un ADN humain qu'on compte plus moralement, mais parce que l'appartenance à l'espèce humaine, c'est un très bon indicateur de la présence d'autres caractéristiques qui seraient, elles, pertinentes moralement. Mais le problème avec ça, si je peux me permettre, et c'est ce que vont répondre les antispécistes, c'est que toutes ces caractéristiques psychologiques-là, que sont la conscience de soi, en gros, le fait d'être une personne au sens étroit que les philosophes donnent, à la notion, sont finalement pas plus pertinentes d'un point de vue moral que les caractéristiques strictement biologiques. La preuve en est que dans les affaires humaines, on refuserait évidemment d'accorder plus d'importance à la souffrance de celles et ceux qui sont les plus intelligents, ou de considérer que les personnes aux capacités mentales les plus élevées ont plus de valeur morale. On pense que tous les êtres humains sont des égaux sur le plan moral, peu importe leur différence cognitive. Pourquoi est-ce que quand il s'agit d'animaux non humains, ces différences-là, parviendraient-elles soudainement à justifier la hiérarchie morale? En gros, c'est le genre de raisonnement qui conduit les antispécistes à penser qu'il est injuste de recourir aux critères de l'espèce, que ce soit en tant que tel ou à titre de proxy, d'indicateur de la présence d'une autre caractéristique, pour favoriser certains individus et en discriminer d'autres quand les uns et les autres ont des intérêts comparables. Si un lapin et un être humain sont tous les deux capables de ressentir de la douleur, ce qu'on pense être le cas, les mêmes précautions analgésiques devraient être prises quand on leur inflige un traitement qui risque d'entraîner la même expérience mentale pour l'un et l'autre, c'est-à-dire d'être également douloureux pour les deux. Le fait qu'un des deux individus soit humain et pas l'autre, ou que l'un des deux soit capable de faire des équations mathématiques avancées et pas l'autre, ne change rien, ce n'est pas pertinent. Pas plus que le fait d'être un homme ou d'être caucasien. Les intérêts semblables devraient être également considérés. C'est la critique, en tout cas, que les antispécistes adressent aux spécistes.
Victor Duran-Le Peuch : D'accord. Et donc le spécisme et son pendant, l'antispécisme, ce sont des concepts assez récents, non? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le contexte du développement de ces notions?
Valéry Giroux : Oui, bien, historiquement, il y a eu plusieurs penseurs qui ont remis en question la place que les êtres humains se sont eux-mêmes donnés au centre et au sommet du monde. On a critiqué l'anthropocentrisme puis l'humanisme, décrit comme des positions fondées sur une sorte de narcissisme puéril. Mais s'il y a eu plusieurs penseurs qui ont ridiculisé notre besoin de se sentir supérieurs aux autres animaux et de se penser même en opposition à eux à croire que ce qui est au cœur de notre essence, c'est précisément ce qui nous distingue d'eux, ça fait moins de 50 ans que les termes spécisme et antispécisme existent en tant que tels. Le spécisme, c'est le nom que le psychologue Richard Ryder, au début des années 70, a donné à un phénomène qui lui semblait comparable au racisme et au sexisme, mais qui s'articule non pas autour de la prétendue race ou du sexe biologique, mais de l'espèce des individus. Ryder a proposé ce terme-là parce qu'il s'est rendu compte que, en fait, du fait qu'on est traversé par des préjugés à l'égard des membres d'autres espèces animales, des espèces autres que la nôtre, des préjugés qui nous conduisent à traiter ces autres animaux non pas comme nos cousins, les cousins qui sont en réalité, selon ce que nous apprend la théorie de l'évolution, mais comme des choses, des ressources à exploiter. Il s'est surtout rendu compte que ce type de préjugés et les discriminations qui en découlent étaient d'une nature très comparable à ce qu'on associe justement au racisme ou au sexisme et qu'on n'avait pas jusque-là de nom pour les désigner. Ryder, c'est lui qui a officiellement inventé le terme, mais c'est au philosophe Peter Singer qu'on doit de l'avoir popularisé avec l'apparition de son livre La libération animale en 1975, un livre qui a eu beaucoup de succès.
Victor Duran-Le Peuch : Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer quelle est la différence entre, du coup, l'antispécisme et l'animalisme?
Valéry Giroux : Bien, l'animalisme, c'est un néologisme, donc ça fait très peu de temps que moi, je rencontre ce mot-là. Je pense que c'est un terme qui désigne à peu près toutes les positions associées à la protection des autres animaux, des animaux non humains. On peut se dire animaliste si on est végane pour les animaux, par exemple, ou si on cherche à améliorer leur sort, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ou si on vise leur libération totale.
Victor Duran-Le Peuch : Donc, le spécisme, c'est l'équivalent du sexisme ou du racisme, mais pour l'espèce. Mais alors, est-ce que ça veut dire que c'est une forme de discrimination, comme ces deux formes de discrimination-là que sont le sexisme et le racisme?
Valéry Giroux : Ce qu'on entend le plus souvent par discrimination, c'est un comportement qui consiste à traiter différemment et de manière désavantageuse les membres d'un certain groupe par comparaison avec les membres d'un autre groupe. On peut ensuite avoir une conception moralisée ou non de la discrimination, c'est-à-dire qu'un traitement différentiel qui est justifié, par exemple le refus d'accorder un permis de conduire aux personnes non voyantes, peut ne pas être considéré comme discriminatoire si on adopte une conception de la discrimination. On peut adopter une conception moralisée de la discrimination, mais peut être considéré comme une forme justifiée de discrimination si on préfère adopter une conception non moralisée. Mais en commençant mes recherches sur l'antispécisme, je me suis rapidement aperçue d'une espèce de problème, ou en tout cas d'un défi. Je constatais que le spécisme, dans la littérature consacrée à l'éthique animale, était souvent présenté à la fois comme une forme de discrimination et comme un phénomène comparable au racisme et au sexisme. On le comprenait tout à l'heure quand je lisais les définitions données par les cahiers antispécistes. Sauf qu'en regardant la littérature sur le racisme en particulier, j'ai vite fait de constater que la conception du racisme comme discrimination n'en était qu'une parmi d'autres, que le racisme n'était pas toujours compris, loin de là, comme un comportement différentiel ou comme une question de justice comparative. Certains auteurs parlent plutôt du racisme comme d'une disposition affective, d'autres comme d'un ensemble de croyances ou de préjugés. D'autres, enfin, s'intéressent surtout aux effets dommageables sur les communautés racisées de certaines organisations.
Victor Duran-Le Peuch : C'est le fameux racisme systémique dont on parle beaucoup en ce moment.
Valéry Giroux : Oui, tout à fait. Donc, il y a différentes conceptions du racisme comme ça qui sont disponibles et qui ne se réduisent pas. Et donc, la conception du racisme comme discrimination n'en est une que parmi toutes celles-là. Le racisme, on considère qu'il peut donc se loger dans les gestes, mais aussi dans la tête ou dans le cœur des individus ou encore être constitué par les effets de différentes choses sur les personnes racisées. Donc, pour résoudre ce problème-là et trouver une manière de présenter le spécisme qui répondait aux deux prétentions des animalistes, c'est-à-dire que c'est à la fois une discrimination et un phénomène largement comparable au racisme, je me suis dit qu'en fait, l'espèce de solution que je propose ou que j'ai trouvée, c'est que il me semblait que rien ne nous forçait à réduire la discrimination à un comportement. Je me suis dit qu'on pouvait aussi bien parler de discrimination quand le traitement différentiel et désavantageux des individus consistait à entretenir des préjugés à l'égard des uns, mais pas des autres, ou encore à ressentir du mépris face aux membres d'un groupe alors qu'on n'en ressent pas face aux membres d'un autre. J'ai pensé qu'avec une conception élargie comme ça de la discrimination, on pouvait accommoder l'intuition qu'est spéciste de croire que les animaux sont moralement inférieurs aux êtres humains ou d'être dégoûtés par les membres de certaines espèces animales alors qu'on ne l'est pas par les membres d'autres espèces. Et qu'il n'est pas toujours nécessaire d'agir pour s'en rendre coupable. Je me suis dit, en fait, plus exactement, que les actes purement mentaux et même les émotions pouvaient être considérés comme des comportements en quelque sorte, comme des actes justement discriminatoires. Je pense aussi qu'on doit pouvoir envisager une forme de spécisme systémique de la même manière qu'on reconnaît, comme tu le disais tout à l'heure, le racisme systémique. Même si on n'est pas en présence d'un agent qui a des croyances à l'égard des animaux ou qui est indifférent, qui serait indifférent à l'égard de leurs intérêts ou même méprisant envers eux, ou qui agit d'une manière discriminatoire, on peut constater qu'il y a du spécisme si nos institutions, nos aménagements publics ou nos lois affectent les animaux non humains de manière particulièrement désavantageuse et si ça nous semble injustifié. Il est certain qu'il y a plein de discussions entourant la notion de discrimination, mais à mon avis, on peut comprendre les problèmes qui y sont liés comme des problèmes de justice comparative. C'est-à-dire que le spécisme entendu comme une discrimination, ça, je pense que c'est important de le noter, ne permet pas de rendre compte de toutes les injustices commises à l'endroit des animaux non humains. Loin de là. Il renvoie seulement à celles, en fait, qui consistent à traiter moins bien des individus ou à accorder moins de considération à leurs intérêts semblables en raison de l'espèce à laquelle ils appartiennent ou le plus souvent en raison du fait qu'ils n'appartiennent pas à une espèce particulière, soit à l'espèce homo sapiens. On peut imaginer avoir des devoirs moraux envers les membres d'autres espèces animales qui ne trouveraient pas leur équivalent dans les affaires humaines. Et dans ce cas-là, l'approche antispéciste qui, donc, nous invite à ne pas discriminer ne nous aiderait pas à fonder ces devoirs-là. Quand on parle de discrimination qu'on oppose à l'égalité de traitement, c'est donc à une sous-catégorie de ce qui est dû aux individus qu'on pense. Et la justice animale n'échappe pas à ça, me semble.
Victor Duran-Le Peuch : J'aime beaucoup la définition très englobante que vous donnez de l'antispécisme, comme décrivant les différentes facettes que peut représenter une discrimination. C'est intéressant par rapport à la définition qui a justement été ajoutée au Larousse. Il me semble que cette définition-là met seulement l’accent sur la question de la croyance en la supériorité des humains sur les non-humains. Et du coup, ça veut dire que cette définition-là rate, en quelque sorte, ou est incomplète, rate un ensemble d'autres aspects dont vous avez parlé.
Victor Duran-Le Peuch : Bon, pour être sûr d'aller au fond des choses et surtout de bien comprendre la notion, j'ai voulu soulever, avec Valéry Giroux, quelques-unes des objections les plus fréquentes à la position antispéciste.
Victor Duran-Le Peuch : Donc, si on se concentre un peu sur la question de la différence de traitement, on se dit qu'a priori, c'est une évidence qu'on ne traite pas de la même manière les animaux qui ne sont pas humains par rapport aux humains. Peut-être que cette différence de traitement, elle peut être justifiée entre les animaux. Et notamment, par exemple, ça semblerait absurde, je ne sais pas, de donner un droit de vote aux poules, par exemple, en se disant qu'il faut une égalité de traitement entre les poules et les humains.
Valéry Giroux : Oui, c'est vrai que pour ridiculiser les défenseurs des droits des animaux ou les antispécistes, on lance souvent sur un ton amusé et méprisant qu'on ne va quand même pas accorder le droit de vote aux poules. Et les antispécistes rétorquent le plus calmement possible qu'en effet, il ne s'agit évidemment pas de ça du tout, en expliquant qu'octroyer aux autres animaux le même statut moral que celui qu'on accorde à tous les êtres humains ou encore accorder autant de considération aux intérêts comparables des individus, peu importe leur espèce, n'implique aucunement de nier les différences entre individus. Et de supposer que les animaux non humains et les êtres humains sont pareils, qu'ils ont les mêmes intérêts et qu'on devrait donc leur accorder les mêmes droits, incluant le droit de vote. On insiste sur le fait que l'égale considération des intérêts ça n'entraîne pas du tout une égalité de traitement des individus puisque tous les individus n'ont pas les mêmes intérêts et que tout ce que l'antispéciste nous demande c'est de ne pas accorder moins de valeur aux intérêts similaires des uns et des autres. Éviter la discrimination spéciste, ça implique de traiter différemment des cas semblables suivant le grand principe formel d'égalité d'Aristote. Si deux individus d'espèces différentes ont des intérêts différents, la justice ne demande pas traiter ces intérêts-là de la même manière et peut même au contraire exiger qu'on les traite de manière différente. C'est seulement quand les intérêts des uns et des autres sont à peu près les mêmes, équivalents ou très semblables et qu'on n'a pas de raison moralement valable de justifier la discrimination qu'on est tenu de leur accorder autant de considération.
Victor Duran-Le Peuch en aparté : En écoutant Valéry Giroux, je me dis que le principe d'égalité qu'elle présente, donc l'égale considération des intérêts, ne revient pas du tout à la caricature qui est souvent faite de l'antispécisme, ça viendrait à dire qu'il n'y a pas de différence entre un humain, une poule ou une fourmi. J'ai l'impression qu'au contraire, il s'agit de prendre en compte les différences qui existent entre les humains et les autres animaux pour pouvoir d'autant mieux tenir compte de leurs intérêts potentiellement différents. Et de la même manière d'ailleurs, l'égalité des genres ne revient pas à dire qu'il faudrait donner le droit à l'avortement à tout le monde. Ça ne fait sens que pour les personnes qui ont un utérus et qui peuvent enfanter. Et pour les autres, cet intérêt est tout simplement inexistant. Donc il n'a pas à être protégé par un droit.
Valéry Giroux : Précisément. Les antispécistes ne nient évidemment pas qu'il y a de très nombreuses différences entre les êtres humains et les autres animaux, tout comme il y a de grandes différences d'ailleurs entre les membres d'une même espèce, avec l'exemple qu'on vient de donner. Ce que les antispécistes soutiennent, c'est que quand deux individus ont bel et bien des intérêts semblables, ces intérêts doivent être également traités, peu importe les caractéristiques des individus qui en sont porteurs, qui n'ont pas de pertinence par rapport au traitement en question. D'ailleurs, l'exemple du lapin, si un lapin et un être humain doivent subir une intervention chirurgicale douloureuse, tous les deux devraient recevoir les analgésiques qui permettront d'atténuer leur douleur. Évidemment, et c'est ça, il est possible qu'une même intervention ne cause pas l'exact même degré de douleur au lapin et à l'humain. Un est peut-être plus sensible que l'autre, ce qui pourrait justifier le devoir d'accorder une dose différente, par exemple d'analgésique, justement pour également traiter leurs intérêts. Mais disons que face à une douleur comparable, en tout cas, on doit protéger également peu importe leur espèce, ces deux individus-là, peu importe leur espèce respective. Dans les affaires humaines, ça semble évident, le fait que vous soyez capable de composer des symphonies peut faire en sorte que vous ayez intérêt à être admis au Conservatoire de Paris, je ne sais trop, alors que moi, qui n'ai pas une bonne oreille, je n'ai évidemment pas cet intérêt-là. Mais comme vous et moi avons probablement en commun l'intérêt à être soigné quand on est malade, il semblerait injuste qu'on me refuse l'accès aux soins de santé parce que je ne sais pas chanter. Le talent musical n'a pas de pertinence dans ce contexte-là et ne devrait pas affecter la considération accordée à mon intérêt à être soigné quand je suis malade. Comme le talent musical, l'espèce d'un individu, encore une fois, n'a pas de pertinence dans la détermination de l'accès aux soins de santé. L'idée, c'est que si les humains ont certains intérêts que les autres animaux n'ont pas, et si ces intérêts sont plus importants que les intérêts différents des autres animaux, on peut et on doit même leur accorder plus d'importance. Ce n'est pas ce à quoi s'opposent les antispécistes, au contraire. Par contre, quand les uns et les autres ont des intérêts semblables, ces intérêts doivent compter également, peu importe l'espèce respective, des individus qui ont des intérêts en question.
Victor Duran-Le Peuch : Ça me fait penser à quelque chose qu'écrit Peter Singer. Un intérêt est un intérêt quelle que soit la personne dont il est l'intérêt. C'est vraiment à considérer l'intérêt de façon égale. Il y a quand même quelques personnes qui ont des objections par rapport à ça. Et peut-être la première objection qui est soulevée souvent, c'est l'idée, peut-être qui paraît intuitive à beaucoup de personnes, qu'il y a une supériorité des humains sur les autres animaux. Peut-être que ce n'est pas toujours clair de quoi relève cette supériorité ou ce qui fonde cette supériorité-là, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une forte intuition qui est en soi spéciste. Mais est-ce que ce n'est pas une justification qu'il y a bien quelque chose de différent ou qui distinguerait l'espèce humaine du reste du règne animal ?
Valéry Giroux : C'est-à-dire que quand on essaie de trouver une caractéristique que tous les êtres humains auraient, partageraient, auraient en commun et qui justifierait leur égalité, leur réel statut moral au centre et au sommet de la hiérarchie des êtres, une caractéristique qu'eux posséderaient tous mais qu'aucun autre animal ne posséderait, c'est bien compliqué de repérer une telle caractéristique, un tel critère qui permettrait de hiérarchiser tous les êtres humains d'un côté et tous les autres animaux de l'autre. Parce qu'évidemment, la supériorité et l'infériorité, c'est toujours par rapport à quelque chose. Si on parle d'un statut moral général comme ça, en tout cas, c'est bien embêtant de justifier la hiérarchisation. Ensuite, bien sûr, les êtres humains peuvent, de manière générale, être plus intelligents que les autres espèces animales qui existent sur Terre en ce moment. C'est tout à fait correct de reconnaître ça, mais cette supériorité-là qui serait celle de l'intelligence ne peut justifier que un type de traitement discriminatoire. Encore une fois, le fait de donner peut-être accès à l'éducation supérieure à ceux qui ont préalablement des compétences intellectuelles pour mener à bien des projets de recherche. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un statut moral général supérieur à celui des autres. Il faut encore une fois s'assurer qu'il y a un lien de pertinence entre la caractéristique qui est étudiée et le traitement en cause, le traitement dont on parle.
Victor Duran-Le Peuch : D'accord. Une autre objection qui est parfois soulevée et qui semble aussi être relativement intuitive, c'est l'idée qu'on aurait peut-être des devoirs particuliers envers les personnes de notre espèce, de même qu'on a des devoirs particuliers envers les personnes de notre famille qui justifient qu'on priorise leurs intérêts à eux, même en reconnaissant que peut-être leurs intérêts sont égaux aux intérêts d'autres êtres. Il y aurait peut-être une justification par des devoirs particuliers envers certaines personnes.
Valéry Giroux : Oui, c'est vrai qu'on pense généralement qu'il n'y a pas de mal à privilégier ses enfants par rapport à des inconnus, par exemple. L'espèce étant simplement un cercle plus large que celui de la famille, on se dit qu'elle autorise peut-être le même genre de privilège. Il faut quand même reconnaître que ce genre de devoirs spéciaux est extrêmement limité, en tout cas dans les affaires humaines. Peut-être qu'on peut ou qu'on doit même sauver sa propre sœur d'un incendie plutôt qu'un parfait inconnu quand on ne peut pas sauver les deux. Mais la relation privilégiée qu'on entretient avec une personne ne nous permet certainement pas de porter atteinte aux intérêts fondamentaux d'une autre pour l'aider. Si on s'attend d'une mère qu’elle privilégie son enfant à ceux des autres et qu'elle lui vienne en aide en priorité, elle ne peut quand même pas voler la nourriture des mains d'un enfant qui en a besoin pour nourrir le sien, et encore moins causer la mort de cet autre enfant pour offrir un de ses organes à son propre enfant même s'il en a désespérément besoin pour survivre. Tout au mieux, on pourrait soutenir qu'à intérêts comparables, ceux de nos proches, et par extension selon ce raisonnement-là, ceux de nos congénères pourraient être privilégiés. Et même là, je ne suis pas certaine que ça fonctionne. On pourrait se demander pourquoi privilégier les membres de sa propre espèce ressemblerait plus au fait de privilégier les membres de sa propre famille qu'au fait de privilégier les membres de sa propre race, de son propre groupe ethnique, peu importe ce qu'on entend par race, ou de son sexe ou de son genre. Selon le philosophe Jeff McMahan, qui nous dit que si on doit être loyaux envers nos proches, c'est parce que la loyauté est essentielle aux relations personnelles et que l'amitié, l'amour ou les autres relations affectives ne seraient pas possibles si on était strictement impartiaux. Sauf que la race, le sexe ou l'espèce tenu à des relations purement biologiques, dans le cas de l'espèce, à des relations fondées sur la généalogie, la génétique ou l'interfécondité, et non pas des relations personnelles. Même si on suppose qu'une mère peut légitimement sauver son propre enfant dans une maison en flammes, puis laisser dépérir un autre enfant si elle ne peut pas sauver les deux, il semblerait difficilement acceptable qu'un homme blanc choisisse de sauver entre deux individus celui qui est un homme parce qu'il est un homme ou celui qui est blanc parce qu'il est blanc. Ça donne, il me semble, de bonnes raisons de penser qu'il serait peut-être tout aussi problématique de choisir de sauver un être humain parce qu'il est homo sapiens.
Victor Duran-Le Peuch : Je vois bien. Si on se dit qu'il faut considérer également les intérêts, la question qui, moi, me vient, c'est les intérêts de qui, en fait? Parce que Peter Singer parle, par exemple, de l'extension de notre cercle moral, c'est-à-dire l'ensemble des individus dont on considère les intérêts pour juger ce qu'on doit faire ou non. Mais du coup, on s'arrête où, en fait? Qui a des intérêts? Comment on les détermine? Et c'est l'objection qui vient si facilement quand on parle d'antispécisme, c'est « et les plantes? » Qu'est-ce qu'on en fait?
Valéry Giroux : En fait, il n'y a pas de limite. Le principe de l’égale considération des intérêts semblables s'applique de manière absolue, si je puis dire. C'est juste qu'il n'y aura aucun effet, ce principe-là, sur les organismes ou les choses qui n'ont pas d'intérêt. Justement, tous les individus qui ont des intérêts peuvent, eux, être affectés par le principe d’égale considération des intérêts semblables et sont donc particulièrement concernés. La question devient alors, donc, qui a des intérêts? Et il y a bien quelques biocentristes qui soutiennent que les plantes ont des intérêts biologiques liés à leur épanouissement, par exemple. Certains auteurs vont même suggérer que des objets inanimés ou des artefacts pourraient ou peuvent avoir des intérêts. Un tracteur pourrait, en tant que tracteur, avoir intérêt à être huilé. Un tableau de Rembrandt à être protégé contre le soleil. Mais ces exceptions-là de la notion d'intérêt sont très controversées et rencontrent quand même plusieurs problèmes. C'est sans doute pourquoi les biocentristes qui soutiennent que tous les organismes vivants ont une valeur finale le plus souvent n'ont pas recours au concept d'intérêt pour le faire. La notion d'intérêt est étroitement associée à celle de bien-être. On peut penser que seuls les êtres sentients, ceux qui sont capables d'expériences subjectives, qui ressentent ce qui leur arrive, qui ont un point de vue sur le monde, ont un bien-être, et donc des intérêts individuels. Si les organismes vivants inconscients ou les tout écologiques n'ont pas d'intérêt, alors peut-être qu'on n'a pas de devoir moral envers eux directement. Ou si on en a, ces devoirs sont sans doute d'une nature très différente de ceux qu'on a envers les êtres dont on peut affecter le bien-être. Ce qui est certain, c'est que rien ne nous empêche d'appliquer le principe d'égale considération des intérêts semblables de manière illimitée, puisque c'est ensuite le fait d'avoir ou non des intérêts et le type d'intérêt en question qui va déterminer les conclusions auxquelles on va arriver. C'est donc un peu évident, un peu trivial, mais c'est le fait de posséder des intérêts qui délimitent les contours de la communauté des individus concernés par ce principe-là. Et les êtres qui ont le type d'intérêt pertinent, ce sont le plus probablement les êtres sentients. Qui sont les êtres sentients? Là, c'est aux scientifiques de nous le dire, mais disons qu'on pense aujourd'hui qu'au moins tous les mammifères, les reptiles, les poissons, les oiseaux et même certains invertébrés comme les pieuvres le sont. La situation des insectes est encore un peu controversée. Et malgré quelques rares indices qui vont dans le sens contraire, on pense généralement que les bivalves ne sont pas sentients. Mais ça, encore une fois, ça ne relève pas du travail des philosophes moraux de trancher ces questions-là.
Victor Duran-Le Peuch en aparté : Pour résumer, quand on réfléchit à quels êtres ont un statut moral, et donc aussi de quels êtres on doit prendre en compte les intérêts, on peut avoir trois types d'éthiques. L'anthropocentrisme considère que seuls les humains ont un statut moral. Valéry Giroux, elle, défend un sentiocentrisme, on parle aussi de pathocentrisme, et défend que ce sont les êtres sentients qui ont un statut moral. Et il y a enfin le biocentrisme, qui considère que tous les êtres vivants ont un statut moral. Mais ne vous en faites pas, on reviendra sur toutes ces distinctions dans un futur épisode.
Victor Duran-Le Peuch : Dans le livre issu de votre thèse, vous distinguez plusieurs types d'intérêts. Vous distinguez l'intérêt à ne pas souffrir, là c'est peut-être ce qui correspondrait aux critères de la sentience, mais vous distinguez deux autres types d'intérêts. L'intérêt à ne pas mourir, et l'intérêt à ne pas être exploité. Comment on détermine quels animaux et quels êtres ont quel type d'intérêt ?
Valéry Giroux : C'est la grande question. Comme tu le disais dans mes recherches doctorales, je me suis demandé si les êtres humains étaient les seuls animaux à avoir les intérêts qu'on considère généralement comme étant les plus fondamentaux et qui sont ceux que les droits de la personne ont pour fonction de protéger. Je parlais, comme tu le mentionnais, du droit de ne pas être torturé, du droit à la vie, du droit à la liberté, puis pour chacun de ces intérêts-là, je me suis demandé si les êtres humains étaient les seuls à avoir les intérêts qu'ils visent à protéger, c'est-à-dire l'intérêt à la sécurité physique et psychologique, celui de ne pas être tué prématurément, celui de ne pas être asservi. De manière pas très surprenante, mes recherches m'ont amené à conclure que tous les êtres sentients ont probablement, ou en tout cas, on a de bonnes raisons de penser qu'il est difficile de nier qu'ils puissent avoir ces intérêts de base eux aussi, ce qui m'a amenée à soutenir à la suite la philosophe Paola Cavalieri, selon qui les droits humains n'ont rien de proprement humain, qu'il faut octroyer les droits individuels les plus fondamentaux à tous les animaux sentients. Je pense que ces intérêts sont en quelque sorte les plus importants, on dit qu'ils sont les plus fondamentaux, ceux qu'on doit reconnaître je pense en priorité, mais évidemment les animaux sont loin d'avoir que ces intérêts-là. En plus des intérêts négatifs, que sont comme ça l'intérêt à ne pas subir de douleur, à ne pas être tué ou à ne pas être empêché de faire ce qu'on veut, tous les êtres sentients ont des intérêts positifs, comme l'intérêt à choisir soi-même ses amis, à être socialisé convenablement, à recevoir des soins de santé par exemple. Et en plus de tout ça, je pense qu'on peut imaginer que les animaux non humains puissent avoir certains intérêts que les humains n'ont pas. Et il serait chouette qu'on en arrive aussi à bien comprendre ces intérêts-là plutôt qu'à nous limiter aux intérêts que les animaux peuvent avoir en commun avec nous et à leur accorder la considération qu'ils méritent. Mais c'est plus difficile, évidemment la posture antispéciste nous amène à nous conduire à nous limiter plutôt à ce qu'on a de commun avec, à ce que les autres animaux ont en commun avec nous. Mais je pense que la justice exige qu'on aille au-delà de ça.
Victor Duran-Le Peuch : J'ai l'impression qu'on est passé des droits de l'homme aux droits humains et j'espère peut-être que bientôt on passera des droits humains aux droits sentients.
Valéry Giroux : Exactement, voilà, c'est bien dit.
Victor Duran-Le Peuch : C'était la première partie de l'épisode 1 de Comme un poisson dans l'eau. On se retrouve dans la deuxième partie pour la suite de l'entretien avec Valéry Giroux. À tout de suite.
Crédits
Comme un poisson dans l'eau est un podcast créé et animé par Victor Duran-Le Peuch. Charte graphique : Ivan Ocaña Générique : Synthwave Vibe par Meydän Musiques : The return par Alexander Nakarada
 Comme un poisson dans l’eau
Comme un poisson dans l’eau