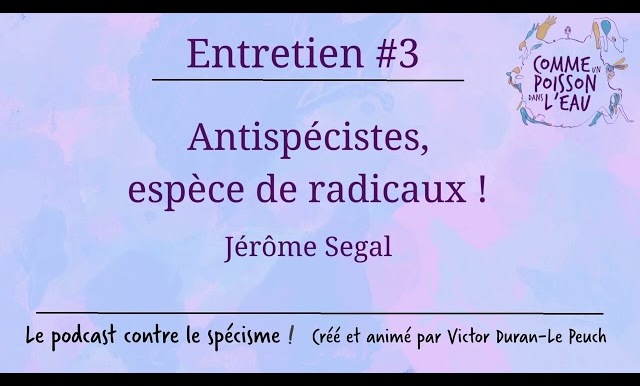Description
Bienvenue dans Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme ! Les antispécistes sont-ils trop radicaux ? C'est la question centrale à laquelle j'ai cherché des réponses auprès de Jérôme Segal dans ce troisième entretien du podcast. Nous avons aussi parlé de l'histoire du mouvement animaliste, de l'analogie contestée entre les abattoirs et les centres d'extermination nazis et de la situation de l'antispécisme en Israël.
Transcription
Voir la transcription
Victor Duran-Le Peuch : Salut, moi c'est Victor Duran-Le Peuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Les opposants au spécisme sont souvent caricaturés dans les médias, décrits comme des radicaux, des extrémistes, quand ils ne sont pas carrément taxés de terrorisme. j'ai tout de même voulu prendre au sérieux et interroger de front cette question de la radicalité, supposée ou réelle, de l'antispécisme. Et qui de mieux pour le faire que Jérôme Segal, maître de conférences en histoire à Sorbonne Université, chercheur et journaliste à Vienne, et il a écrit plusieurs ouvrages sur la question du spécisme et de l'antispécisme, dont « Animal radical » en 2020, « 10 questions sur l'antispécisme » en 2021, et tout dernièrement, « Tous vegan », manifeste pour un véganisme éclairé. Donc sans plus attendre, voilà l'entretien avec Jérôme Segal. Bonjour Jérôme Segal.
Jérôme Segal : Bonjour.
Victor Duran-Le Peuch : Alors, un de vos ouvrages s'appelle Animal radical, et j'aimerais commencer en interrogeant cette question de la radicalité, justement. Parce qu'en effet, les antispécistes ont mauvaise presse dans les médias, en général, perçus comme extrémistes. Alors, je voudrais vous demander, Jérôme Segal, est-ce que les antispécistes sont trop radicaux ?
Jérôme Segal : Alors, je pense qu'il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on entend par radicaux. La radicalité a mauvaise presse, c'est vrai, vous l'avez dit. Mais si on s'intéresse à l'origine du mot, à son étymologie, on voit que ça vient de radix, qui veut dire la racine. Et donc, en fait, les gens qui sont radicaux, ce sont les gens qui remontent à la racine d'un problème. Et donc, pour les antispécistes, c'est remonter aux spécismes, aux origines du spécisme. Et on peut même voir différentes formes de radicalité. Il y a des travaux assez intéressants d'un philosophe, John Pitzeis, qui explique qu'il y a quatre formes de radicalités. Par exemple, une radicalité qui dépend d'un principe unique, donc un agent de cohérence qui explique toute la position d'un individu. Donc, ça va être l'antispécisme qui va permettre, par exemple, de décider même des réseaux de sociabilité, on reste amis entre antispécistes, etc. Donc, c'est une forme de radicalité assez forte. Pour d'autres, au contraire, et là, c'est une deuxième forme de radicalité, la radicalité repose sur un unique principe fondateur qui est très profond, qui est très respecté. À ce titre, par exemple, on peut considérer que la CDU, le Parti chrétien démocrate en Allemagne, est plus radicale que le Parti communiste chinois de Xi Jinping puisqu'il est vraiment dans l'esprit de ce parti chrétien démocrate, alors que le communisme n'est pas vraiment typique de ce que fait le dirigeant chinois. Une autre forme de radicalité, ça peut être l'idée qu'on étend les luttes très très loin, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement, dans le cas des antispécistes, manifester devant un cirque qui utilise des animaux, on ne va pas seulement empêcher une corrida de se tenir, mais on va aller dans un magasin qui vend de la viande, on va essayer de bloquer un abattoir, on va aller très très loin dans cette perspective-là antispéciste. Et puis, une dernière forme de radicalité, et c'est celle qui a le plus mauvaise presse, c'est la radicalité qui est liée à une certaine forme de violence politique. Là, ce sont des gens qui vont penser qu'il faut renouer avec l'action directe qu'on connaissait dans les mouvements anarchistes au début du 20e siècle, et puis agir directement sans trop respecter nécessairement le jeu démocratique, c'est-à-dire faire des lois, agir sur les partis politiques, etc. Ça, c'est une autre forme de radicalité. Donc, on voit bien que si on dit que les antispécistes sont radicaux, on peut dire oui dans le sens étymologique. On revient à la racine du problème. Mais après, il y a différentes formes de radicalité.
Victor Duran-Le Peuch : D'accord. Et il y a des racines quand même de la cause animale, avant que le concept d'antispécisme soit développé, que l'on peut vraiment juger radicales. Et notamment, vous parlez dans votre livre du passage de la protection des animaux à la défense des animaux, vers la fin du 19e siècle. Est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre les deux et revenir sur ce qui a peut-être motivé cette évolution dans la façon de lutter pour les animaux ?
Jérôme Segal : Oui. Il y a au début du 19e siècle, il y a la création de la Société protectrice des animaux en Grande-Bretagne. Ensuite, une vingtaine d'années plus tard, en 1848 en France, la SPA, qu'on connaît encore en France. Et cette idée, c'est vraiment, on va protéger les animaux, mais en fait, c'est encore dans une version très anthropocentrée, dans la mesure où on protège les animaux effectivement parce qu'on se rend compte qu'ils ressentent la douleur, qu'ils souffrent, mais surtout parce que cette violence dans la rue, par exemple, avec les cochers qui étaient parfois très violents sur les chevaux, cette violence peut faire du mal aux hommes. Et puis, il y a ce cas d'un fait divers qui était assez symbolique. Les cochons étaient tués sans aucun égard pour la population environnante dans les villages. Et puis, il est arrivé qu'un jeune enfant assiste à la tuerie du cochon. Et ensuite, se munisse d'un couteau et fasse subir le sort du cochon à sa petite sœur. Et donc là, les ligues de protection des animaux se sont dit, oui, il faut passer des lois et ce sera la loi Gramont, la première loi en France en 1850, qui punit de façon très symbolique cette cruauté envers les animaux, mais surtout pour le mauvais exemple que ça donne pour les humains et pour éviter que, par exemple, les personnes sensibles voient des animaux maltraités dans les rues de Paris ou des grandes villes, ou comme je le disais, pour l'abattage des animaux. Donc, cette protection des animaux, c'est quand même surtout une protection qui vise à épargner les humains et puis à placer les humains au centre de cette démarche. Alors que la défense, on voit ça par exemple avec la ligue contre la vivisection de Marie Huot autour de 1900, on peut dire. Et là, c'est vraiment la décision de dire non, on ne supporte pas, cette violence qui est faite aux animaux et on va sauver les animaux, on va directement intervenir. Et elle-même, Marie Huot, est assez célèbre pour une scène où, au Collège de France alors qu'une expérience de vivisection allait être pratiquée sur un singe où elle saisit son ombrelle, descend et tente de libérer le singe. Donc, c'est vraiment une forme d'action directe, c'est-à-dire là, tout de suite, sans passer par des intermédiaires, c'est pour ça que c'est direct, sans passer par des syndicats, par des partis politiques, c'est en tant que personne, on va essayer d'agir pour prendre la défense des animaux.
Victor Duran-Le Peuch : Et cette logique d'action directe et de défense des animaux, c'est aussi la ligne qu'a choisie l'ALF, le Front de Libération Animale. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu ?
Jérôme Segal : Oui, alors là, on est catapultés dans l'histoire dans les années 1960 et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un moment où il y a des manifestations contre le nucléaire et certaines personnes engagées dans la cause animale se disent il faut, nous aussi, qu'on agisse avec nos corps. C'est-à-dire, on n'est pas seulement des gens qui écrivent des articles dans les journaux, mais on va aller, par exemple, saboter les chasses. Et ça, c'est quelque chose qui avait déjà une petite tradition. Il y avait les saboteurs de chasse qui étaient assez connus en tant qu'association en Grande-Bretagne. Et donc, ils viennent sur le terrain, ils affrontent les chasseurs et puis, parfois, avec des ruses, par exemple, ils mettent des produits qui ont des odeurs très fortes pour que les animaux s'en aillent et ne soient pas victimes des chasseurs. Et l’ALF va aller un peu un cran plus loin parce que, même s'ils ont parmi leurs dix principes celui de, évidemment, ne jamais faire de mal aux humains qui sont des animaux comme les autres, ils n'ont pas hésité à causer des biens matériels. Il y avait notamment un laboratoire qui allait mener des expériences sur les animaux qui était en cours de construction et ils ont mis le feu. Ce qui fait qu'il y a eu des peines de prison qui ont été prononcées. Pour certains, dans la presse, on va dire « bourgeoise » ou mainstream, c'était des terroristes. Mais eux-mêmes ont toujours insisté justement sur le fait qu'ils ne créaient que des dégâts matériels. Mais ça a tout de même eu une influence assez importante.
Victor Duran-Le Peuch : Aussi bien qu'un nombre énorme de leurs membres ont fini en prison et n'ont pas pu continuer à défendre les animaux, c'est ça ?
Jérôme Segal : Oui, beaucoup de leaders de l'ALF se sont retrouvés en prison. Et ça a donné lieu aussi à la création d'autres mouvements. Par exemple, PETA aux États-Unis est créé un peu dans le sillage de l'ALF. Et après, c'est tout un jeu de tenir compte des lois qui existent qui sont très restrictives maintenant en Amérique du Nord pour tout ce qui est infiltration dans les élevages. C'est très très dur d'avoir une action directe de ce type. Alors certains se sont déplacés sur d'autres continents, en Australie, en Europe. Mais cette idée d'action directe reste encore assez active aujourd'hui.
Victor Duran-Le Peuch : Mais toutes et tous n'ont pas choisi cette manière de lutter, donc l'action directe, et ont au contraire, face à une société radicalement spéciste, choisi de se retirer, en communautés séparées, sur le modèle de certaines communautés anarchistes ou naturiennes, c'est-à-dire prônant un retour à la nature. Et vous en parlez également dans votre livre Animal Radical.
Jérôme Segal : Oui, il y a eu ce qu'on appelle des communautés végétaliennes. Alors c'est évidemment d'une part pour ne pas participer au spécisme, au grand carnage, à cette tuerie de masse contre les animaux non humains. Mais c'est aussi dans un souci de rejet de l'industrialisation des villes, avec la pollution, une forme d'hygiénisme aussi, de se dire il faut renoncer au tabac, à l'alcool, et à la consommation de viande. Donc c'est des courants assez variés. Il y a une idée forte qu'on pourrait qualifier d'animaliste, mais c'est mêlé à d'autres aspects un peu hygiénistes ou naturiens, comme vous avez dit. Donc c'est ce qui fait que ces communautés n'ont pas eu non plus de très grands échos dans l'histoire, et ont été un petit peu perdues. Il y a aussi quelques dérives liées justement à la présence de ces mouvements naturolâtres, on pourrait dire, d'idéalisation de la nature comme étant quelque chose qu'il faut absolument respecter, adorer, etc. Et parfois même avec des dérives vers des formes de fascisme.
Victor Duran-Le Peuch : Alors on a déjà abordé dans le premier épisode avec Valéry Giroux une des analogies contestées quand on parle de la condition des animaux non humains, celle avec l'esclavage. Et il y a une autre comparaison qui est, il me semble, encore plus controversée et qui est pourtant tout aussi mobilisée. Il s'agit de la comparaison entre la Shoah et l'abattage de millions d'animaux chaque jour, ou similairement la comparaison entre les abattoirs et les camps de concentration. Donc puisqu'on parlait de radicalité plutôt, cette comparaison-là paraît radicale ou extrême, et pourtant dans votre ouvrage vous rappelez certains éléments historiques qui expliquent qu'elle n'est pas complètement infondée en fait.
Jérôme Segal : Alors c'est effectivement un sujet très délicat qu'il importe d'aborder avec toute la sagesse qui sied à une analyse posée et respectueuse aussi des sensibilités des uns et des autres. D'abord, on parle de la Shoah en général, c'est un terme qui parfois est critiqué, parce que le terme Shoah renvoie en hébreu à catastrophe naturelle, il y a 13 occurrences dans la Torah du mot Shoah pour décrire des catastrophes naturelles. Donc on peut parler de la destruction systématique du peuple juif et plus précisément en Europe, mais je pense qu'au préalable il est important de rappeler que si on peut s'intéresser à ce parallèle, comme tous les parallèles, avoir en tête évidemment que comparaison n'est pas raison, mais peut mener à la réflexion, et si on établit des parallèles c'est bien justement pour réfléchir, pour susciter la réflexion, et en préalable il faut rappeler des objectifs fondamentalement différents. Dans un cas, il est question d'éliminer un peuple, le peuple juif, quoi qu'on entende exactement par la notion de peuple plus ou moins construit ou pas, c'est un autre débat. Dans l'autre cas, il s'agit d'asservir des espèces, de contrôler leurs populations, mais pas du tout de les exterminer, puisqu'il s'agit de tuer et de faire naître des cochons, des vaches, des poules, etc. Donc il faut bien avoir ça à l'esprit que les objectifs sont très différents, mais en même temps on se rend compte qu'il y a cette même idée de déshumaniser les personnes qu'on va tuer. Lorsqu'on s'intéresse à l'histoire du racisme, et par exemple au racisme, donc à l'antisémitisme dans la Seconde Guerre mondiale, mais aussi au racisme contre les Roms et les Tziganes, racisme contre les Slaves, différentes formes de racisme, on voit justement que les Juifs étaient comparés à des rats. Il y a des vidéos de propagande sous l'égide de Goebbels qui présentent des Juifs vivant dans un ghetto, et la voix off dit voilà, ce sont des rats qui grouillent partout, etc. Même chose, les Asiatiques étaient représentés souvent par de la vermine, ou par des fourmis, les Africains sous la forme de singes, donc on voit que tout de suite, dans les racines mêmes et l'expression du racisme, on trouve cette volonté de déshumaniser et donc de placer l'humain comme étant supérieur à toutes ses victimes, animaux ou bien humains déclassés, on pourrait dire. Donc ça, on voit déjà là un premier parallèle, et on peut estimer que dans les deux cas, il s'agit de l'expression d'une forme de suprémacisme humain, puisque les Juifs n'ont plus le statut d'humains, ils ne sont pas Ariens, parce que les seuls les véritables humains sont les Ariens pour les nazis. Ensuite, toujours dans cette généalogie du nazisme et de la volonté d'extermination systématique du peuple juif, on a aux États-Unis, en 1906, la troisième réunion de l'American Breeders Association, donc l'association des éleveurs américains, qui se réunit et qui décide de créer un 16e comité, ils avaient 15 comités pour par exemple améliorer les races bovines, améliorer les races porcines, améliorer les nouvelles formes qu'ils avaient obtenues par croisement de poulets, de chèvres, etc. Ils avaient 15 comités de ce type, et là, il leur vient l'idée d'ajouter une 16e commission, qu'ils appellent donc le comité, sur l'amélioration de la race humaine. Et ça, c'est la définition même de l'eugénisme. L'eugénisme, pour rappel, c'est cette idée, cette idéologie, qui consiste à améliorer la race humaine. Alors, il y a deux types d'eugénisme, je vais être très bref, il y a l'eugénisme positif, qui consiste à privilégier la reproduction des humains dont on pense qu'ils ont des traits génétiques favorables, c'est ce qu'on trouve par exemple aux États-Unis, avec par exemple la banque de sperme de prix Nobel. Là, on se dit, ces gens-là ont obtenu le prix Nobel, ces hommes-là, et donc, on va leur demander leur sperme pour créer plusieurs bébés, et comme ça, améliorer le peuple américain. Donc ça, c'est plutôt ridicule, mais ça ne fait pas grand mal. Par contre, l'eugénisme négatif, ça va être l'idée d'empêcher de se reproduire des humains dont on pense qu'ils ont des traits génétiques défavorables, et c'est exactement ce qui se fait aux États-Unis. Suite aux travaux de cette commission, on a la première loi qui est passée en 1924 qui pose un quota de juifs parmi les immigrés qui arrivent aux États-Unis, et cette idée est vraiment écrite noir sur blanc. On ne veut pas de ces juifs souffreteux qui viennent des ghettos et qui vont affaiblir la race américaine. Donc là, on voit qu'il y a un lien très fort entre l'élevage et, en même temps, l'eugénisme, et l'eugénisme son expression la plus cruelle, c'est évidemment le nazisme. Alors, un autre point important dans la généalogie de ce qu'on peut appeler la Shoah, et en même temps dans la généalogie de l'abattage en masse des animaux, c'est les conséquences de la modernité. La modernité, et là, toute l'école de Francfort, avec notamment Adorno, a beaucoup écrit sur le sujet, et notamment aussi sur ce parallèle, c'est de rechercher l'efficacité avant tout, et donc on a le développement de ce qu'on peut appeler une industrie de la mise à mort. Donc ça, ça se passe à Chicago, c'est dans les années 1880 à peu près, c'est les Union Stockyards, c'est un endroit où travaillent jusqu'à 30 000 personnes en même temps, donc c'est vraiment une véritable ville dédiée à l'abattage essentiellement des bœufs, et il y a là Henry Ford, qui visite les abattoirs de Chicago, et est émerveillé par le fait qu'il y a une réification absolue des animaux, c'est-à-dire que le bœuf arrive à un endroit, il est mis sur une espèce de tapis roulant, il est abattu, il est dépecé, il est éviscéré, on le coupe dans tous les sens, etc., et à la fin, il y a des barquettes de viande qui sortent, et Henry Ford reprend cette idée, créé, comme on sait, le modèle T de la célèbre voiture, et en même temps, Henry Ford est un antisémite notoire. Il publie en 1920 « Le Juif international », qui est très largement diffusé en Europe, et qui a une grande influence sur les futurs nazis. Si on prend quelqu'un comme Baldur von Schirach, qui était responsable des jeunesses Hitlériennes, qui ensuite va être responsable de la déportation des juifs de Vienne, Baldur von Schirach dira au procès de Nuremberg Je suis devenu nazi en lisant Henry Ford. Henry Ford lui-même avait un portrait dans le bureau de Hitler à Munich, c'est le seul étranger à avoir eu la plus grande décoration du Troisième Reich, donc là, on voit que historiquement, que ça nous plaise ou non, qu'on accepte ou pas ce parallèle, il y a des imbrications qui sont très fortes dans l'histoire. C'est quelque chose qui se retrouve aussi dans la technique, il y a le tatouage, il y a le gaz, les cochons aujourd'hui sont étourdis avec du dioxyde de carbone, les juifs étaient tués avec du Zyklon B, il y a cette idée aussi de feinte, les animaux, tout est fait pour qu'ils ne comprennent pas, qu'ils arrivent tout de suite à l'abattoir, les juifs, on leur disait « vous allez avoir un morceau de savon, vous allez passer aux douches », donc on voit des techniques qui sont indiscutablement semblables, et tout ceci, que ce soit la généalogie ou les aspects plus techniques, nous invite à nous interroger sur la validité ou pas de ce parallèle, et puis évidemment les limites que j'ai dites au préalable.
Victor Duran-Le Peuch : Oui, parce qu'au-delà de ces considérations historiques-là, qui montrent qu'il y a effectivement une circulation des idées dans la conception des abattoirs, puis des usines fordistes, puis des camps de concentration, je me demande s'il y a plutôt une vertu heuristique, malgré tout, d'utiliser cette analogie-là pour briser l'emprise des biais spécistes, ou si ce n'est pas finalement contre-productif, parce que ça peut participer à une forme d'instrumentalisation de traumas qui ont encore des conséquences aujourd'hui sur beaucoup de personnes qui sont d'ascendance juive.
Jérôme Segal : Alors, juste une petite remarque, je pense que c'est important de différencier les camps de concentration et les centres d'extermination. Les camps de concentration, c'était des camps de travaux forcés, où on mourait d'épuisement, mais on ne mourait pas systématiquement, alors que le parallèle qui est fait ici, c'est vraiment entre les abattoirs et les centres d'extermination, qui ne sont pas des camps, c'est-à-dire qu'ils sont construits dans le dur. Et voilà, à Auschwitz, par exemple, on avait un camp de concentration et un centre d'extermination, qui est justement un traitement industriel de la mise à mort. Cette petite remarque étant faite, je pense que ce parallèle a un grand pouvoir, seulement il faut au moins se donner quelques minutes pour l'exposer. On ne peut pas, si quelqu'un va dire, tu manges de la viande, t'es comme les nazis qui tuaient les juifs, là oui, je pense que ça va être très contre-productif, parce que la personne qui reçoit ça ne peut pas l'entendre, ne peut pas le comprendre, puisque c'est le mal absolu d'être nazi. On ne peut pas dire à quelqu'un, t'es comme les nazis. Donc je pense qu'il faut vraiment aborder ce parallèle de façon très posée, et il peut avoir sa pertinence, il a d'autant plus de pertinence que le principal historien qui a écrit un livre sur ce parallèle, c'est Charles Patterson, qui a écrit « Un éternel Treblinka ». Lui-même est juif, a eu de la famille qui est morte dans les camps. Il se réfère lui-même à une citation de Isaac Bashevis Singer, prix Nobel littérature yiddish, et Isaac Bashevis Singer écrit justement dans une pièce de théâtre, il fait parler une souris, il décrit une amitié entre un homme et une souris, et cette souris décède, et l'homme dit « mais pour vous les animaux c'est un éternel Treblinka ce que vous vivez ». Donc je pense que si on prend en compte le fait que ce sont des personnalités juives, même des activistes comme Gary Yourofsky, qui reprennent ce parallèle, on ne peut pas d'un revers de la main les taxer d'antisémitisme, dire c'est inadmissible, etc. Ensuite s'il y a des gens effectivement qui sont heurtés par ce parallèle, bon ben faut pas trop insister.
Victor Duran-Le Peuch : Alors justement je rebondis sur ce que vous venez de dire, en fait dans votre ouvrage vous suggérez qu'en réalité la mémoire de la Shoah rendrait peut-être plus sensible au sort des plus vulnérables, et c'est vrai que je ne m'en étais pas rendu compte avant de vous lire, mais de nombreuses figures de l'antispécisme, ou de la contestation du spécisme, sont en fait d'ascendance juive, et font explicitement le lien avec la judaïté, qui est bien à distinguer de la dimension religieuse qui est plutôt le judaïsme, et c'est le cas de Peter Singer notamment.
Jérôme Segal : Oui tout à fait. J'ai eu la chance de mener un entretien avec Peter Singer sur ces questions-là, et il m'a répondu de façon assez intéressante, parce que je lui ai demandé s'il y avait un lien entre le fait d'être juif et de s'engager comme il le fait dans la cause animale, et il m'a dit indiscutablement oui, mais de façon assez diffuse. C'est-à-dire que pour lui c'est pas quelque chose qu'il peut verbaliser de façon très simple, mais il fait partie indiscutablement, de tous ces juifs pour lesquels être juif, c'est être solidaire des persécutés, des discriminés, quels qu'ils soient. Si on regarde dans l'histoire, on voit qu'il y a beaucoup de juifs qui se sont par exemple engagés dans le mouvement des droits civiques auprès des noirs. Les seuls blancs qui ont été tués par le Ku Klux Klan, c'était des juifs qui étaient auprès des noirs. Dans les révoltes étudiantes, je ne sais pas si on pense à Daniel Cohn-Bendit et beaucoup d'autres, il y a une surreprésentation manifeste des juifs dans tous ces mouvements de révolte et de solidarité. Et c'est ce qu'on trouve aussi chez Henry Spira. Henry Spira, c'est un des premiers activistes qui réfléchit vraiment à sa façon de militer, aux méthodes qu'il met en place pour obtenir des premiers résultats dans les années 70, par exemple la fin d'expériences particulièrement atroces qui étaient menées sur des chats au Muséum d'histoire naturelle de New York. Ensuite, des expériences qui étaient menées sur les yeux des lapins pour une entreprise de cosmétiques. Tout ça, il va de succès en succès. Et lui-même est formé dans Hashomer Hatzaïr, qui est le mouvement de jeunesse des juifs libéraux un peu de gauche. Et donc, je pense qu'il y a bien un lien. Et lorsque, par exemple, l'association 269 Life est créée, en Israël, au début des années 2010, la séance inaugurale qui vraiment marque énormément la population israélienne, c'est Rabin Square, donc un centre majeur à Tel Aviv, des activistes décident de se tatouer les numéros 269 sur le bras. Et ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux Israéliens, parce qu'encore aujourd'hui, on peut voir quelques personnes qui ont un tatouage issu des camps nazis. Donc, je pense qu'il y a vraiment une sensibilité très forte en Israël. Et ce parallèle parle aux gens.
Victor Duran-Le Peuch : Justement, vous me donnez une transition toute trouvée. Parce que j'aurais bien aimé parler un peu d'Israël avec vous, justement. Il me semble que c'est le pays avec la plus grande proportion de personnes qui se déclarent véganes. Du coup, j'ai deux questions par rapport à ça. Déjà, qu'est-ce qui explique cela ? Et ensuite, est-ce qu'Israël est réellement le paradis antispéciste qu'on décrit parfois ?
Jérôme Segal : Alors, il semblerait qu'effectivement, Israël soit le pays au monde où il y ait le plus de personnes qui se déclarent véganes, 2, 3, voire 4 %. Le fait est que si on se promène dans les rues de Tel Aviv, le véganisme est partout. Si on rentre dans un café pour demander, par exemple, un cappuccino, le serveur va vous demander lait d’épeautre, lait de noisette, lait d'amande, qu'est-ce que vous voulez comme lait. C'est quelque chose qu'on connaît assez peu en France. Il faut dire, en fait, je suis allé à deux reprises en Israël pour des séjours prolongés pour justement essayer de comprendre pourquoi l'antispécisme et le véganisme, il faut faire un peu la distinction entre les deux, pourquoi le véganisme et l'antispécisme sont si forts. Le véganisme, il y a déjà un effet de mode, c'est-à-dire qu'Israël est un petit pays avec des communications très très denses, énormément d'échanges entre toutes les communautés, à l'intérieur des groupes, etc. Donc lorsqu'une mode prend, et on peut parler d'une mode du véganisme, elle se diffuse vraiment très largement. Maintenant, je vois quatre raisons pour expliquer l'essor du véganisme et dans une certaine mesure un peu moindre de l'antispécisme. D'abord, tout simplement, la gastronomie israélienne est tout à fait adaptée au véganisme. Le plat national, c'est houmous falafel. Les falafels sont véganes, le houmous aussi, purée de pois chiches. Donc c'est assez simple. Il n'y a pas non plus de grande culture du fromage, par exemple. Il n'y a pas non plus énormément de viande. Donc c'est assez facile d'être végane en Israël. Et puis, deuxième point, les Israéliens ont souvent été habitués à réfléchir à ce qu'ils mangeaient. Ce ne sont pas du tout tous les Israéliens qui suivent les prescriptions bibliques de manger kasher. Déjà, les Juifs eux-mêmes sont à peu près que 80% de la population du pays. Mais parmi ces Juifs, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout religieux. Mais tout de même, ils viennent de familles où on est habitués, par exemple, à ne pas manger la viande avec le lait, à ne pas manger de porc, à se poser des questions avant de manger. Et ça, même pour les Juifs athées, laïcs, ça leur paraît naturel de se poser des questions sur ce qu'ils mangent. Ensuite, le troisième point, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure. C'est cette façon de développer l'identité juive sous forme d'une solidarité ontologique avec les persécutés. Et il y a un moment où ces personnes juives ont une espèce de déclic où elles se disent « On va défendre évidemment les femmes, qui sont la plus grande minorité persécutée, même si c'est une majorité. On va défendre les personnes racisées, on va défendre les homosexuels, on va défendre les ouvriers, etc. » Et puis à un moment, ils se disent « Mais on va aussi défendre les animaux maltraités par les humains». Et donc ça, c'est le troisième point. C'est ce qui explique notamment l'engagement de Peter Singer, d'Henry Spira et de beaucoup d'autres. Et puis, il y a un quatrième aspect qui est un peu plus complexe et plus politique. Et ça, c'est ce qui est apparu vraiment dans les entretiens. Dans les entretiens que j'ai menés, certaines personnes m'ont dit « Moi, je suis devenu antispéciste, je me suis engagé dans la cause animale, parce que là, au moins, j'ai du succès, là, au moins, ça marche. » On obtient, par exemple, que le foie gras soit interdit dans le pays, que les fourrures soient interdites dans le pays, sauf pour les schtreimel, les chapeaux des juifs orthodoxes. On obtient pas mal de résultats. Alors que pendant des années, on s'est engagé pour la paix au Moyen-Orient, pour une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. On a été d'échec en échec. Le gouvernement a poursuivi la colonisation en Cisjordanie. Gaza est une prison à ciel ouvert, etc. C'était des déconvenues, des déconvenues. Et donc, c'est par dépit qu'on a trouvé une cause où là, au moins, on avait la satisfaction de militer et d'obtenir des résultats. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'il y a ces quatre aspects-là qu'il faut prendre en compte. Donc la gastronomie, l'idée de réfléchir avant de manger, la solidarité ontologique et puis cet engagement par dépit. Et maintenant, pour répondre à votre deuxième question sur « est-ce qu'Israël est vraiment l'Eldorado des antispécistes ? » En fait, non. Si l'on regarde la consommation de viande par habitant, Israël est largement au-dessus de la moyenne européenne. On mange plus de viande en Israël qu'ailleurs. Et puis surtout, on tue beaucoup plus d'animaux puisque tout ce qui correspond à la consommation de viande porcine en Europe est remplacé par de la volaille en Israël. Évidemment, pour 10 kilos de viande de porc, il faut, mettons, une dizaine de poulets. Donc il y a beaucoup plus d'animaux qui sont tués en Israël que dans le reste du monde. Et puis, comme je le disais, il y a aussi ce phénomène de mode qui fait que le véganisme reste quand même assez circonscrit à une certaine jeunesse éduquée qui suit les réseaux sociaux. Il y a eu notamment une militante, Tal Gilboa, qui s'est fait connaître en gagnant un concours de genre Ninja Warriors, d'épreuves à la télévision, d'épreuves plus ou moins athlétiques. Et elle, elle a beaucoup œuvré pour la conversion au véganisme parce qu'elle l'a fait toujours avec un tee-shirt Go Vegan, etc. Donc elle a montré qu'on pouvait être fort, forte en l'occurrence, et végane. Mais les gens qui l'ont suivi l'ont suivi plus pour des raisons de santé, de vouloir être fort comme elle, plutôt que vraiment vouloir sauver des animaux.
Victor Duran-Le Peuch : D'accord. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une authentique présence de la lutte contre le spécisme en Israël ? Vous parlez, par exemple, de différents groupes antispécistes ou de la communauté des Israélites Hébreux Noirs de Dimona. Est-ce que c'est des groupes qui se sont vraiment construits contre le spécisme ? Et combien de personnes ça représente à peu près ? Est-ce que c'est une force, une grosse présence en Israël ?
Jérôme Segal : Alors, sur le militantisme, il y a différents groupes. Il y a Animals, qui était un groupe assez fort en Israël, qui reste assez présent. Mais je n'ai pas vraiment l'impression que ce groupe est en grande expansion. Il y a une multitude de petites associations, mais pas d'essor massif. Et par contre, il y a un développement démographique assez important de cette communauté que vous avez citée, donc les Hebrew Israelites of Jerusalem, les Hébreux Noirs de Jérusalem. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'ils sont basés, comme vous l'avez dit, au début du désert du Negev, à Dimona. Et eux-mêmes sont descendus, ils sont descendants d'Afro-Américains. C'était à la fin des années 60. Un homme qui a eu cette idée qu'il était descendant d'une 13e tribu d'Israël et que donc, il fallait quitter le pays de la grande oppression à cause de l'esclavage. Les États-Unis d'Amérique, pour lui, il n'y avait absolument aucun avenir. Et donc, il est parti en Afrique. Donc, une espèce de retour aux sources. Il est arrivé au Libéria, qui était le seul pays qui n'avait pas été colonisé. Et là, après quelques mois passés là-bas, dans des conditions très dures, à cause des bêtes sauvages, à cause du paludisme, à cause de l'inadéquation entre la banlieue de Chicago et sa culture, et puis arrivé dans des villages au Libéria, plusieurs personnes sont reparties ou sont décédées. Et il restait à peu près une centaine de personnes qui croyaient vraiment que c'était là leur avenir. Et puis, pour fêter la Pâques, ils avaient trouvé une chèvre, acheté une chèvre qu'ils avaient tenue par une laisse. Et cette chèvre, pendant la nuit, s'est étranglée avec sa laisse. Et donc, au réveil, Ben Carter, ce leader de ce petit groupe d'Afro-Américains, a vu ça comme une révélation, comme un signe qu'un ange lui avait parlé, l'ange Gabriel, et que c'était le signe qu'il ne fallait plus faire de mal aux animaux et qu'il fallait partir en Israël, en Terre Sainte. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés avec des visas de touristes, la centaine qu'ils étaient. Ils se sont installés à Dimona. Et donc là, on est au début des années 70. Et ils ont créé un village vegan, entièrement vegan, dans lequel je me suis rendu pour essayer de comprendre leur motivation, savoir quelle était un peu leur culture, avoir une petite idée. Et là, c'était vraiment très impressionnant parce que c'est un village qui vit essentiellement en autarcie, mais qui a ouvert le premier restaurant vegan à Tel Aviv, au début des années 80, qui a ensuite lancé une chaîne de restaurants vegan, des produits vegan qu'ils développent dans tout le pays. Et ce sont des gens qui sont en parfaite santé. Il y a des scientifiques qui viennent et qui sont très étonnés de voir qu'il n'y a aucune maladie cardiovasculaire. C'est un petit peu la preuve vivante que le régime vegan est bon pour la santé. En même temps, et là encore, c'est dans ma démarche d'universitaire que je ne veux pas enjoliver les choses, dans ce village de Dimona, donc des hébreux noirs israélites de Jérusalem, il y a une idée très réactionnaire. Tout ce qui est contraception est interdit. Les femmes sont invitées à faire le plus d'enfants possible. La polygamie est très présente. Il y a aussi l'obligation de faire du sport, trois fois par semaine pour tout le monde. Ce mode de vie explique aussi la bonne santé puisque la pratique sportive est obligatoire. J'ai visité aussi l'école. Uniforme différent pour les garçons et les filles. Les filles ont des cours de cuisine, mais pas les garçons. C'est quelque chose qui est quand même assez réactionnaire, assez conservateur pour nos standards d'Européens que nous sommes. Mais ça vaut le coup d'y aller et de voir comment c'est là-bas. C'est vraiment très impressionnant.
Victor Duran-Le Peuch : Il y a un élément de critique important que vous adressez contre l'idée d'un paradis antispéciste en Israël. C'est l'idée de vegan washing. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est et en quoi ça concerne Israël ?
Jérôme Segal : Oui, tout à fait. Le vegan washing fait référence à deux autres concepts. D'abord, le premier est largement connu. C'est ce qu'on appelle le green washing. Le green washing, c'est lorsqu'une entreprise comme Total, qui pollue énormément à cause des hydrocarbures, va décider par exemple d'être le sponsor d'un marathon pour se donner une image verte et écolo. C'est le green washing. Et en Israël, il y a un auteur qui s'appelle Jean Stern qui a parlé de pink washing. Pink washing, c'est l'idée de détourner l'attention des étrangers sur les problèmes profonds qu'il y a en Israël, liés notamment au sort des Bédouins, à la colonisation, au traitement des Palestiniens, et de cacher cela en mettant en exergue une relative tolérance vis-à-vis des minorités sexuelles. En fait, cette tolérance ne s'applique pas partout. Deux hommes qui se tiendraient par la main à Mea Sharim, dans le quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem, ne pourraient pas continuer longtemps à avancer en se tenant la main. Mais Tel Aviv est effectivement un havre de paix où on peut vivre son homosexualité comme on le ferait à New York. Et là encore New York, pas partout, mais disons à Manhattan au moins. Et donc Israël, le pays de la tolérance, LGBTIQ, Welcome Israel, etc. C'est ce qu'on appelle du pink washing, c'est-à-dire mettre sur le devant cette relative tolérance pour cacher des aspects moins reluisants. Il est par exemple à la pose du mur sur le territoire palestinien, à toutes les exactions, les manquements aux droits de l'homme qu'on connaît. Et avec le greenwashing, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que les gouvernants israéliens, et pendant très longtemps Benyamin Netanyahou, étaient très contents de voir les jeunes faire des manifestations pour arrêter l'élevage en cage des poules, pour demander à ce qu'on arrête le foie gras, plutôt que d'aller manifester pour le sort des palestiniens ou des aspects plus profonds de sa politique sur lesquels il a des positions intangibles. Et donc le gouvernement a tendance à lâcher du lest pour les animalistes, pour les rendre satisfaits, qu'éventuellement ils votent pour eux. Et d'ailleurs c'est très symbolique, Tal Gilboa dont je parlais, qui était cette militante végane qui a gagné Ninja Warrior, cette émission de télévision, elle est devenue conseillère pour les animaux de Netanyahou. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de récupération politique, pour canaliser la contestation sur la question des animaux. Et c'est pour ça que certaines personnes en viennent à parler de vegan washing, et notamment les antispécistes palestiniens, ce sont eux qui sont très forts dans l'utilisation de ce terme.
Victor Duran-Le Peuch : Bon, Jérôme Segal, quelles sont vos trois recommandations pour les auditeurices ?
Jérôme Segal : Alors, comme on est sur un podcast, j'ai pensé que c'était une bonne idée de vous donner des chaînes sur YouTube. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup, c'est Réplique éthique, c'est des petites capsules qui sortent toutes les semaines sur des aspects de l'antispécisme auxquels on peut être confrontés, par exemple la radicalité, l'intolérance supposée des antispécistes, ou bien des réponses à des questions comme « chacun son choix », « je mange ce que je veux », etc. Donc c'est celui qui fait ça, il explique vraiment très bien. Et puis il y a aussi, en langue anglaise, mais vraiment dans un anglais parfait, très lent, bien prononcé, très compréhensible, c'est Humane Hancock. Et c'est un Britannique qui aime bien aller rencontrer des gens qui ne sont pas antispécistes et discuter avec eux, et essayer de leur faire comprendre pourquoi la cause animale est importante. Donc ce sera ma deuxième recommandation.
Victor Duran-Le Peuch : Pour l'anecdote, j'ai des amis qui se sont retrouvés à Londres, et qui ont été interrogés par Humane Hancock, et qui du coup ont fini sur sa chaîne. Voilà, pour l'anecdote.
Jérôme Segal : Non, je pense qu'il fait vraiment un super boulot. Et puis ma troisième recommandation, ce sera les livres de mon distingué ami et collègue Thomas Lepeltier, notamment son dernier « Les véganes au pouvoir », qui est vraiment très bien, parce que je trouve que Thomas Lepeltier a un style aussi concis qu'incisif, et si certaines personnes peuvent se sentir au départ un petit peu heurtées par sa façon de présenter les choses, je pense qu'à la réflexion, c'est vraiment très intéressant ce qu'il propose.
Victor Duran-Le Peuch : Super, merci beaucoup pour toutes ces recommandations. Je mettrai tout en description. Et merci encore, Jérôme Segal, d'être venu dans le podcast.
Jérôme Segal : Avec plaisir.
Victor Duran-Le Peuch : J'espère que cet entretien vous a plu. Si c'est le cas, et que vous avez deux minutes, ce serait vraiment utile que vous laissiez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou la plateforme où vous écoutez ce podcast. Et puis, la meilleure façon de soutenir comme un poisson dans l'eau, c'est d'en parler autour de vous. On se retrouve lundi prochain, pour une lecture. Bisous.
Crédits
Comme un poisson dans l'eau est un podcast créé et animé par Victor Duran-Le Peuch. Charte graphique : Ivan Ocaña Générique : Synthwave Vibe par Meydän Musique : Desire par Markvard
4 livres cités :
Animal radical · Histoire et sociologie de l'antispécisme Jérôme Segal

L’antispécisme – la lutte contre toute discrimination fondée sur l’appartenance à une espèce animale – est plus explicitement politique que le végétarisme ou le véganisme, qui sont essentiellement des modes de vie.
ISBN : 9782895963172 · publié le 19 mars 2020
Acheter sur Place des LibrairesDescription complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
Cité dans 1 épisode(s) :Dix questions sur l'antispécisme · Comprendre la cause animale Jérôme SEGAL

Jérôme Segal est un essayiste et historien franco-autrichien, maître de conférences à Sorbonne Université ainsi que chercheur et journaliste à Vienne, en Autriche. Il est l’auteur de Animal Radical.
ISBN : 9782377292059 · publié le 5 mai 2021
Description complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
Fin des animaux sauvages dans les cirques, actions militantes devant des boucheries, remise en cause de l’élevage, vidéos dénonçant la réalité des abattoirs... tout ceci donne du crédit au mouvement «antispéciste».Le mot «spécisme» est entré dans les dictionnaires récemment, mais son usage se répand rapidement pour désigner des discriminations fondées sur l’espèce. Une des conséquences de l’antispécisme est le véganisme.Cet ouvrage percutant permet de comprendre les liens de ce mouvement avec des courants de pensée comme le socialisme, l’anarchisme et le féminisme. Il appréhende son rapport avec l’écologie, les religions et la critique du capitalisme, et finalement aborde la question de la convergence des luttes, mais aussi d’une redéfinition de la place de l’humain sur notre planète. Jérôme Segal est un essayiste et historien franco-autrichien, maître de conférences à Sorbonne Université ainsi que chercheur et journaliste à Vienne, en Autriche. Il est l’auteur de Animal Radical. Histoire et sociologie de l’antispécisme, (Lux, 2020), Athée et Juif. Fécondité d’un paradoxe apparent, (Matériologiques, 2016).
Cité dans 1 épisode(s) :Tous véganes ? · Manifeste pour un véganisme éclairé Jérôme Segal
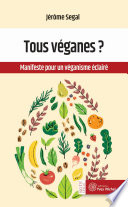
Tous véganes ? est un texte court qui défend une thèse simple : il vise à expliquer pourquoi aujourd’hui, le véganisme est nécessaire.
ISBN : 9782364291966 · publié le 12 octobre 2021
Description complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
Tous véganes ? est un texte court qui défend une thèse simple : il vise à expliquer pourquoi aujourd’hui, le véganisme est nécessaire. Un livre engagé, qui entend convaincre le lecteur de la nécessité de se tourner vers ce mode de consommation, bien conscient du fait que ce changement ne pourra se faire du jour au lendemain et nécessitera d’importantes mesures d’accompagnement et de reconversion. Un ouvrage concis et sérieux qui s’adresse au grand public, avec des sources incontestables. Un livre engagé et unique, visant non pas à diaboliser la consommation de produits d’origine animale, mais plutôt à ouvrir les esprits et éveiller les consciences. Par l’auteur de Animal radical : Histoire et sociologie de l’antispécisme, paru aux Éditions Lux en 2020.
Cité dans 1 épisode(s) :Un éternel Treblinka Charles Patterson
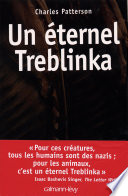
Je vous incite vivement à le lire et à réfléchir à son important message. » Jane Goodall, primatologue « Le défi moral posé par Un éternel Treblinka en fait un livre indispensable pour celui qui cherche à explorer la leçon ...
ISBN : 9782702146057 · publié le 3 janvier 2008
Description complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
La souffrance des animaux, leur sensibilité d’êtres vivants, est un des plus vieux tabous de l’homme. Dans ce livre iconoclaste – que certains considéreront même comme scandaleux –, mais courageux et novateur, l’historien américain Charles Patterson s’intéresse au douloureux rapport entre l’homme et l’animal depuis la création du monde. Il soutient la thèse selon laquelle l’oppression des animaux sert de modèle à toute forme d’oppression, et la « bestialisation » de l’opprimé est une étape obligée sur le chemin de son anéantissement. Après avoir décrit l’adoption du travail à la chaîne dans les abattoirs de Chicago, il note que Henry Ford s’en inspira pour la fabrication de ses automobiles. Ce dernier, antisémite virulent et gros contributeur au parti nazi dans les années 30, fut même remercié par Hitler dans Mein Kampf. Quelques années plus tard, on devait retrouver cette organisation du « travail » dans les camps d’extermination nazis, où des méthodes étrangement similaires furent mises en œuvre pour tétaniser les victimes, leur faire perdre leurs repères et découper en tâches simples et répétitives le meurtre de masse de façon à banaliser le geste des assassins. Un tel rapprochement est lui-même tabou, étant entendu une fois pour toutes que la Shoah est unique. Pourtant, l’auteur yiddish et prix Nobel de littérature Isaac Bashevis Singer (qui a écrit, dans une nouvelle dont le titre de ce livre est tiré, « pour ces créatures, tous les humains sont des nazis ») fut le premier à oser la comparaison entre le sort réservé aux animaux d’élevage et celui que les hommes ont fait subir à leurs semblables pendant la Shoah. S’inspirant de son combat, Patterson dénonce la façon dont l’homme s’est imposé comme « l’espèce des seigneurs », s’arrogeant le droit d’exterminer ou de réduire à l’esclavage les autres espèces, et conclut son essai par un hommage aux défenseurs de la cause animale, y compris Isaac Bashevis Singer lui-même. « Le livre de Charles Patterson pèsera lourd pour redresser les torts terribles que les hommes, au fil de l’histoire, ont infligés aux animaux. Je vous incite vivement à le lire et à réfléchir à son important message. » Jane Goodall, primatologue « Le défi moral posé par Un éternel Treblinka en fait un livre indispensable pour celui qui cherche à explorer la leçon universelle de la Shoah. » Maariv, journal israélien
Cité dans 1 épisode(s) :3 autres références :
- Humane Hancock (youtube) (video)
- Les livres de Thomas Lepeltier
- Réplique éthique (youtube) (video)
 Comme un poisson dans l’eau
Comme un poisson dans l’eau