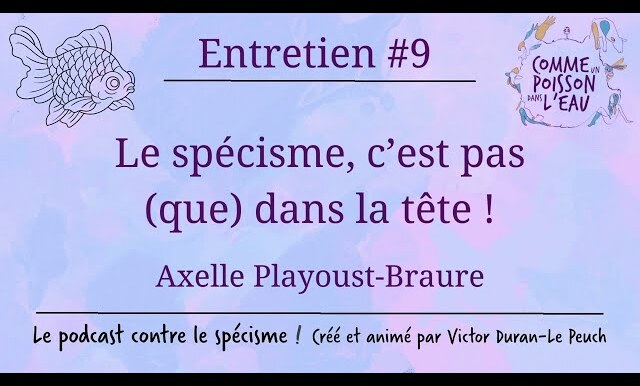Description
On revient dans cet épisode sur la définition même du spécisme, avec la journaliste et autrice Axelle Playoust-Braure, qui présente sa conception matérialiste du spécisme en définissant l'espèce comme une catégorie sociale et politique. Après avoir présenté l'intérêt d'une telle définition sociale de l'espèce par rapport à la définition canonique du spécisme comme discrimination, elle présente trois éléments clés de la pensée matérialiste et montre en quoi cette grille d'analyse a été fructueuse pour les féministes matérialistes à partir des années 1970, avant de l'appliquer à la question du spécisme. Ainsi Axelle Playoust-Braure préfère-t-elle parler d'animalisés et d'humanisés pour mettre l'accent sur l'animalisation en tant que processus social qui s'applique en fait aussi à certains individus Homo sapiens lorsqu'iels sont infériorisé.es. Il convient alors de remettre en cause le suprémacisme humain en tant que monopole illégitime de l'universel qui est en fait surtout la domination des humains sur les autres animaux. Le reste de l'épisode est consacré à tirer les fils de cette conception matérialiste du spécisme, en considérant notamment que l'idéologie ne précède par les structures sociales spécistes mais qu'elle en est une production a posteriori qui vient tenter de légitimer l'ordre social inégalitaire.
Transcription
Voir la transcription
Victor Duran-Le Peuch : Salut, moi c'est Victor Duran-Le Peuch et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Avec Martin Gibert, on a vu dans le dernier épisode que la psychologie peut nous aider à comprendre comment le spécisme se perpétue et pourquoi l'argumentation éthique rationnelle a parfois ses limites, du fait de certains de nos biais ou du fait de la dissonance cognitive. Mais en réalité, la psychologie est loin d'être la seule discipline qui peut nous informer sur ces questions, car une grande partie de nos croyances sont déterminées socialement. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de biais, de fonctionnement du cerveau humain qui mène à des erreurs systématiques dans certaines situations, car ça dépend aussi beaucoup des gens qui nous entourent, de nos valeurs, de notre position sociale, des intérêts de chacun et chacune, des institutions auxquelles on participe, etc. Tout ça, ce sont des facteurs d'explication qui sont davantage le propre des sciences sociales, en particulier la sociologie. Et quand on utilise la sociologie pour comprendre le spécisme, en fait, on ne le définit pas exactement de la même manière. Et ça donne donc de nouvelles lunettes pour analyser le spécisme comme le sexisme ou le racisme comme une organisation sociale. Mon invité aujourd'hui nous présente cette perspective nouvelle qu'on peut adopter sur le spécisme. Il s'agit d'Axelle Playoust-Braure, qui est journaliste scientifique pigiste. Elle a écrit en 2018 un mémoire de master en sociologie qui s'intitule « L'élevage comme rapport d'appropriation naturalisé, le cas du publispécisme ». Elle est la co-autrice avec Yves Bonnardel de « Solidarité animale, défaire la société spéciste », édité en 2020. Et c'est enfin la co-rédactrice en chef de « L’amorce », la revue contre le spécisme. Bonjour Axelle Playoust-Braure.
Axelle Playoust-Braure : Bonjour.
Victor Duran-Le Peuch : C'est un grand plaisir de vous recevoir dans « Comme un poisson dans l'eau ». Et j'aimerais pour commencer revenir avec vous sur la définition même du spécisme. Jusque-là dans le podcast, j'ai un peu jonglé entre plusieurs définitions du spécisme, sans jamais vraiment prendre le temps d'expliquer ce qui peut les différencier. Alors là, c'est l'occasion. J'ai commencé par parler de spécisme comme une discrimination, donc l'inégale prise en considération des intérêts des individus, en reprenant à la suite de Valéry Giroux la façon habituelle dont le spécisme est généralement pensé en philosophie. J'ai aussi parlé du spécisme comme une idéologie, donc un ensemble de croyances. Et on a vu, au fil de plusieurs épisodes, que plusieurs des croyances spécistes sont fausses. Et j'ai parfois, mais moins souvent, je dois l'avouer, parlé du spécisme comme une oppression ou une domination perpétrée et perpétuée par des acteurs ou des institutions comme les industries agroalimentaires ou leur lobby, par exemple. Et vous, la définition du spécisme que vous mobilisez est fortement influencée par le cadre théorique auquel vous puisez, qui est le féminisme matérialiste. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est le matérialisme et en quoi consiste du coup une définition du spécisme en termes matérialistes ?
Axelle Playoust-Braure : Oui. Alors, avant de définir ce qu'est le matérialisme, j'aimerais justement parler de la définition classique du spécisme en termes de discrimination pour que je puisse expliquer en quoi elle me paraît insuffisante sous certains aspects et justement amener à la définition du spécisme en tant qu'organisation sociale, une définition justement plus matérialiste. En fait, la définition classique, qui en fait remonte à Peter Singer dans les années 70, elle rentre dans le domaine de la philo-morale. Et dès le départ, elle a une forme analogique. C'est-à-dire que ce que dit Peter Singer, c'est que le spécisme est à l'espèce, ce que le racisme est à la race et le sexisme au sexe. C'est-à-dire une discrimination qui est fondée sur un critère moralement arbitraire. Alors ça ne veut pas dire que l'espèce, le sexe ou la race ne peuvent jamais servir pour distinguer des individus ou des situations. L'idée, ce n'est pas de postuler une identité entre tous les individus, une sorte d'identité à tous niveaux. Mais d'un point de vue moral, ce sont des critères arbitraires. C'est-à-dire qu'en eux-mêmes, à eux seuls, ils ne peuvent pas servir à justifier des différences de considération morale ou de traitement. C'est-à-dire qu'il y a une définition qui a le mérite d'être claire, logique, rationnelle, qui est implacable et qui d'ailleurs n'a pas été vraiment réfutée depuis 50 ans, depuis sa formulation dans « La libération animale » de Peter Singer. Donc c'est une définition que je ne récuse absolument pas. Par contre, je la trouve un peu limitée sous certains aspects. Et la première chose qui me perturbe avec cette définition, c'est qu'elle appréhende la notion d'espèce, qui est une définition assez plate dans sa version la plus commune, à savoir comme une appartenance biologique évidente. Donc en fait, quand on parle de discrimination fondée sur le critère de l'espèce, la notion d'espèce renvoie à homo sapiens, cochons, vaches, lièvres, etc. C'est la conception la plus commune de la notion d'espèce. Or, je pense que le spécisme, ce n'est pas exactement de ça dont il s'agit quand on parle d'espèce. Je pense que c'est pas tant une question d'appartenance biologique, d'humains, de cochons, de vaches, etc. Même si dans les faits, c'est bien des animaux concrets, des animaux au sens littéral qui sont exploités dans les élevages, etc. Mais je pense que la question du spécisme, c'est surtout une question d'humanité et d'animalité, des individus qui sont plus ou moins humains ou plus ou moins animaux, animalisés. Et que du coup, la définition du spécisme en tant que discrimination qui renvoie aux différentes espèces au sens littéral, du terme, ça ne recouvre pas totalement ce qu'on entend par humanité et animalité. Parce qu'on sait très bien, et je pense qu'on y reviendra un peu après, qu'il y a des humains au sens homo sapiens qui, en fait, sont considérés comme des sous-humains, sont animalisés, sont traités d'animaux, etc. Donc on voit bien que la conception seulement biologique de l'espèce est insuffisante pour comprendre le phénomène du spécisme dans son entièreté. Et en fait, un truc que je trouve vachement étonnant, quand même, venant d'une définition analogique avec le racisme et le sexisme, c'est qu'en fait, si on regarde la façon dont la notion de sexe et de race est traitée aujourd'hui, en fait, il n'y a plus personne aujourd'hui qui parle de ces notions de sexe et de race de façon biologique. On a pris énormément de distance avec ces concepts. Les notions de race et de sexe ont été questionnées, ont été critiquées, historicisées. Aujourd'hui, on parle de « race sociale ». On parle de genre, évidemment. On dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes. C'est étonnant comme considération si on pense que le sexe est simplement une considération biologique. On parle de « personnes racisées ». Donc tout ça, c'est des concepts qui sont des productions théoriques, des études féministes, des théories féministes et des théories critiques de la race qui ont produit énormément d'analyses depuis plusieurs décennies.
Victor Duran-Le Peuch : Je vais vous donner deux minutes sur cette idée de race sociale. Parce que dès qu'on parle de race en France, tout le monde s'insurge et il y a souvent des malentendus. Alors déjà, on parle des théories critiques de la race et non pas des races. Parce que justement, ces théories récusent complètement l'idéologie raciste historique qui affirmait l'existence de races biologiques et leur hiérarchie. Cette idéologie raciste est scientifiquement fausse. Il n'y a pas de race biologique, tout le monde est d'accord avec ça. Mais du coup, pourquoi continuer de parler de race ? Et bien parce que d'après les théories critiques de la race, la race est un système social et politique, une certaine organisation de la société qui produit des effets et construit des catégories hiérarchisées de façon raciste, donc qui racialise négativement certains individus. Vous pouvez aller écouter le podcast « Kiffe ta race » pour approfondir toutes ces questions. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez écouter l'épisode 27 Check tes privilèges blancs, où le sociologue Eric Fassin explique justement la pertinence d'étudier la race comme une catégorie sociale, construite et historique. Il y cite notamment un ouvrage d'histoire de Noël Ignatiev qui s'intitule « Comment les Irlandais sont devenus blancs ». Bon bah là, ça montre bien que « blanc » ne renvoie pas à une catégorie biologique. L'ouvrage ne dit pas que les Irlandais ont changé de couleur de peau. Mais ça renvoie bien à une catégorie sociale, évolutive selon le contexte. Bref, je vous mets d'autres ressources en description si vous voulez aller plus loin sur ce sujet. Et pour la phrase « les lesbiennes ne sont pas des femmes », c'est la même logique. C'est une phrase de Monique Wittig, une des féministes matérialistes, dans son livre « La Pensée Straight ». Et ce qu'elle y défend, c'est que les catégories hommes et femmes peuvent être analysées une fois de plus comme des catégories sociales, qui sont le résultat du système hétérosexuel, conçu comme un régime politique. Les lesbiennes sont en rupture avec ce système, et donc n'entrent pas dans les catégories que celui-ci construit. Donc, ne sont pas des femmes. Et là aussi, je vous laisse des ressources en description.
Axelle Playoust-Braure : Et du coup, tous ces mots, « race », « racisation », « genre », etc. C'est pas juste des mots compliqués pour faire compliqué. C'est vraiment un travail épistémologique, c'est-à-dire un travail sur la production de connaissances, sur un questionnement scientifique sur qu'est-ce que c'est la race, qu'est-ce que c'est le sexe. Et donc c'est une vraie avancée scientifique, au sens des sciences sociales, au-delà de la simple appréhension commune et évidente de couleur de peau, sexe, homme-femme, etc. Et en fait, ce que dit Nicole-Claude Mathieu, qui est une féministe matérialiste, qui a justement contribué à cet effort épistémologique de critique de la notion de sexe, c'est qu'elle dit dans un texte super, qui s'appelle « Note pour une définition sociologique des catégories de sexe » elle dit que l'objectif c'est « d’ériger au rang de variables sociologiques des notions qui jusqu'ici étaient totalement naturalisées ». Et donc en fait, moi ce que je défends, c'est de prendre au sérieux l'analogie en fait. Et c'est de dire que le principe c'est de faire à l'espèce ce que les études féministes ont fait au sexe et ce que les études critiques de la race et les études antiracistes ont fait à la race. Et c'est un travail que j'inscris dans une démarche dite matérialiste.
Victor Duran-Le Peuch : Alors du coup, est-ce que vous pourriez expliquer en quoi c'est matérialiste et qu'est-ce que c'est le matérialisme pour qu'on comprenne bien le lien avec l'emphase sur la définition sociale de l'espèce que vous venez de présenter justement et dont vous parlez en employant les termes de rupture épistémologique dans votre mémoire ?
Axelle Playoust-Braure : Oui. Alors une approche matérialiste, c'est une approche qui cherche à analyser le monde social et notamment les rapports entre les groupes sociaux en se penchant vraiment sur les conditions concrètes d'existence, sur les conditions matérielles d'existence. Historiquement, on doit l'approche matérialiste, plus ou moins, enfin en tout cas, historiquement, Marx utilise l'approche matérialiste. Donc souvent on associe le matérialisme à Marx, mais il faut bien comprendre que toutes les personnes qui se réclament du matérialisme ne sont pas marxistes. Il faut distinguer en fait l'approche matérialiste du contenu de la théorie marxiste. Et en fait, l'approche matérialiste, elle fait trois choses principales. Déjà, elle considère que le monde social est composé de classes sociales qui ont des relations antagonistes, c'est-à-dire qu'elles ont des intérêts différents et qu'une classe exploite l'autre. L'exploitation peut prendre des formes différentes. Ça peut être l'exploitation de la force de travail, mais ça peut être l'appropriation du corps des individus. L'exploitation, ce n'est pas un terme univoque, ça peut prendre des formes différentes et puis ça peut évoluer dans le temps en fonction des contextes et des lieux. Donc premier point, l'existence de classes sociales, c'est-à-dire des groupes sociaux aux intérêts antagonistes. Le deuxième point de l'approche matérialiste, c'est de dire que ces classes, ces groupes sociaux, ils n'existent pas avant les rapports qu'ils ont entre eux. Ce ne sont pas des groupes naturels qui existent a priori, en tout temps et en tout lieu. Au contraire, ce sont le résultat des rapports de classes. Et que donc, et ça c'est très intéressant à comprendre, c'est que les caractéristiques de ces classes ne sont pas fixes et éternelles. Contrairement à ce que souvent l'idéologie qui accompagne les rapports sociaux de pouvoir voudrait nous faire croire que les groupes sont toujours là, que c'est pour toujours, que les caractéristiques, par exemple, ce qu'est une femme, ce qu'est un homme, sont des choses fixes, essentialisées, etc. Donc l'approche matérialiste, en disant que ce sont les rapports de pouvoir qui constituent les classes et qui donnent le contenu des classes, c'est une approche qui est très critique de l'essentialisation des groupes et aussi de l'idéologie différentialiste, qui est une idéologie qui, avec tout un contenu de croyances et de discours, essaie de fixer les groupes sociaux dans des essences différentes, voire complémentaires, en tout cas d'imposer une vision fixiste du monde social. Et du coup, le troisième point de l'approche matérialiste, qui est lié au second point, c'est que l'idéologie, donc tous ces contenus de croyances et de discours, sont vraiment perçus comme le résultat, comme la production des rapports sociaux de pouvoir inégalitaires, et en jouant un rôle de légitimation de l'inégalité et des rapports de pouvoir. Et en fait, l'idéologie est là pour verrouiller les rapports de classe. Et ça, c'est important à comprendre d'un point de vue stratégique et politique, parce que ce que ça veut dire, c'est que si on veut efficacement lutter contre les rapports de classe, les rapports de pouvoir, il faut avant tout s'attaquer aux structures concrètes, matérielles de la société, se poser des questions du genre qui a le pouvoir de décision, qui peut voter, qui possède le capital économique, qui peut sortir dans la rue sans crainte, ou au contraire, qui est assigné à résidence au sein du foyer. Voilà, c'est vraiment des questions concrètes de « qui a le pouvoir ? », et pas seulement de lutter contre les idées, ou les catégories dans lesquelles on nous enferme. Ça ne veut pas dire que c'est intéressant de critiquer l'idéologie et de dire que ce soit au sujet des animaux, que ce ne sont pas des êtres inférieurs, qu'ils ne sont pas bêtes, qu'ils peuvent être intelligents. Regardez, les études scientifiques disent que ceci, cela. Ce n'est pas inintéressant. On est dans une société qui méprise tellement les animaux que ça vaut le coup de rappeler des faits scientifiques à leur sujet. Mais je dirais que l'essentiel de la lutte n'est pas là, et qu'en fait, on se bat, pour moi, c'est un peu des coups d'épée dans l'eau de se battre contre l'idéologie, parce que l'idéologie va sans cesse ressurgir tant qu'il y aura les structures en place, parce que l'idéologie est là pour légitimer les structures en place. Il y a un intérêt stratégique à comprendre l'approche matérialiste.
Victor Duran-Le Peuch : Si tout ça vous paraît nouveau ou encore un peu flou, ne vous en faites pas, on va revenir au fil de l'épisode sur chacun des trois points dont a parlé Axelle Playoust-Braure, en les appliquant à la question du spécisme. Mais avant ça elle nous parle de l’usage de cette grille matérialiste fait par les féministes matérialistes dans les années 70.
Axelle Playoust-Braure : En fait, un bon exemple, je trouve, de l'approche matérialiste, c'est justement les féministes matérialistes. C'est un courant féministe qui remonte aux années 70, qui est incarné par la revue Question Féministe, avec Christine Delphy, Nicole-Claude Mathieu, Paola Tabet, Colette Guillaumin, etc. Donc il y a tout un groupe qui a produit des analyses très intéressantes. Et en fait, ce qu'on doit à ces féministes matérialistes, c'est une théorisation, justement, des groupes « hommes et femmes » comme étant des classes sociales. Un vocabulaire qui est souvent utilisé, c'est que hommes et femmes sont des constructions sociales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à dire sur le sexe au sens biologique, au sens de caractéristiques biologiques, en fait, mais ce n'est pas le sujet des féministes matérialistes. Des fois, on leur reproche de dire que le sexe est une construction sociale et que ça serait absolument aberrant, ça ne veut rien dire, etc. Mais en fait, les féministes matérialistes s'intéressent au phénomène social des groupes sociaux, des interactions, des rapports de pouvoir, et leur objet, ce n'est pas le sexe au sens biologique. Et en fait, les féministes matérialistes, elles ont politisé la sphère familiale, par exemple. Donc on a Christine Delphy qui a théorisé l'exploitation du travail domestique, qui est quand même, aujourd'hui, ça nous paraît évident, de parler de travail domestique qui serait fourni de façon gratuite par les femmes, on parle de charge mentale, de charge domestique, mais en fait, à l'époque où Christine Delphy a mis ça en avant, c'était une vraie révolution dans la compréhension des rapports hommes-femmes, en fait. Parce qu'à l'époque, la sphère familiale relevait vraiment du naturel et du privé. Et utiliser des termes comme exploitation du travail, parler de travail domestique, ça n'allait pas du tout de soi. On a aussi Paola Tabet, qui a théorisé les rapports de couple hétérosexuels comme étant des rapports économico-sexuels. Et en fait, elle postule l'existence d'un continuum des rapports économico-sexuels, qui vont en gros de la prostitution à des formes un peu floues, d'échanges économico-sexuels au couple et au mariage. Et en fait, ça aussi, ça n'allait pas du tout de soi de considérer les relations de mariage hétérosexuels comme des relations d'échanges économico-sexuels. C'est deux exemples pour montrer qu'en fait, à chaque fois, c'est une façon de politiser et de regarder les conditions concrètes d'existence et les interactions matérielles entre les groupes, au-delà de l'appréhension évidente qu'on en avait avant. Le projet, c'est de faire la même chose avec les rapports humains-animaux, avec la façon dont on appréhende l'élevage, et peut-être aussi parler non plus, enfin, continuer à parler « d'animaux et d'humains », mais surtout parler « d’animalisé et d'humanisé ».
Victor Duran-Le Peuch : Alors justement, j'aimerais qu'on tire ensemble tous les fils que vous avez commencé à tracer de façon très précise de cette définition matérialiste. Et il me semble qu'il y en a beaucoup, qu'il y a de très nombreuses implications sur la façon dont on doit justement, où on peut penser le spécisme, à partir de cette définition-là. La première implication, vous l'avez très bien expliqué, c'est l'idée que l'idéologie n'est pas antérieure à la violence, mais qu'elle est une production a posteriori pour venir légitimer l'ordre social tel qu'il est déjà. Et donc, à peu près tout ce qu'on fait dans le podcast « Comme un poisson dans l'eau » n'est que le dévoilement de l'idéologie et ne s'attaque pas vraiment aux structures matérielles. Donc voilà, c'est une des limites dont il faut avoir conscience, je pense, quand on fait un podcast sur le spécisme. Et une deuxième implication, c'est que penser le spécisme comme une oppression ou comme une exploitation, donc en fait comme un rapport social, ça revient, vous l'avez dit, à dénaturaliser ce qui semblait naturel. C'est-à-dire montrer que ce qui était perçu comme un ordre naturel est en fait produit par des rapports de pouvoirs, et peut donc être, par conséquent, contesté et changé. Et justement, vous parlez dans votre mémoire et dans le livre « Solidarité animale » d'une construction sociale des animaux, où vous parlez aussi d’animalisation des animaux. Et alors là, c'est pas forcément évident de comprendre à priori de quoi il s'agit, donc est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi on peut parler de construction sociale ici ?
Axelle Playoust-Braure : Oui. En fait, l'idée c'est de dénaturaliser ce qu'on entend par « animaux » et ce qui nous paraît évident à leur sujet. En fait, c'est de sortir de tout cet enfumage idéologique qui est produit par les institutions et les individus qui ont intérêt à ce que l'exploitation animale perdure. Et en fait, quand je dis qu'il faut parler « d'animalisés et d'humanisés », l'idée c'est que, pour moi, la distinction entre les humains et les animaux, c'est une question de groupes sociaux, c'est-à-dire de positions sociales, qui font référence à des positions sociales. La distinction entre humains et animaux, c'est une distinction entre des propriétaires et des appropriés. Parce qu'il y a un truc que met en avant l'approche matérialiste du spécisme, un truc qui saute aux yeux quand on dit une approche matérialiste, c'est que les animaux actuellement sont soumis au statut de propriété, ils sont soumis au régime des biens. Et ça, d'un point de vue concret, d'aller voir les conditions matérielles d'existence, mais c'est phénoménal comme chose à analyser en fait. Donc en fait, les... Les animaux, ce sont celles et ceux qu'on peut s'approprier, qu'on peut tuer, qu'on peut mutiler, ce sont ceux qu'on peut utiliser comme des moyens pour servir à nos propres fins. Ce sont les individus de seconde zone, les moins que rien. C'est pour ça que, pour moi, animaux, ça fait référence à une position sociale, et pas tant à une appartenance biologique. D'où l'utilité de l'approche matérialiste aussi pour faire un pont avec les autres luttes sociales, c'est qu'en fait, on se rend compte que l'animalité en tant que position sociale, elle concerne pas seulement les animaux au sens biologique. Il y a énormément d'humains, au sens clatique homo sapiens, qui sont en fait animalisés, et qu'on peut considérer comme faisant partie de la catégorie des animaux au sens social. Parce que, eux aussi sont considérés comme corvéables, utilisables, tuables, comme des corps n'ayant pas de... oui, avant tout comme des corps, en fait, et à qui on refuse un statut de sujet à part entière. C'est dans ce sens-là, en fait, que je considère que animaux au sens biologique et animaux au sens social ne se recouvrent pas.
Victor Duran-Le Peuch : Pour être sûr de bien comprendre la distinction entre le sens biologique d'animal comme catégorie scientifique, et le sens social que vous vous défendez, il y a un slogan qu'on retrouve dans certaines luttes, en fait, de personnes minorisées, qui est « nous ne sommes pas des animaux ». Et on peut le décliner, on n'est pas de la viande, il y a plein d'éléments comme ça. En fait, ce qui est en jeu ici, dans ces définitions-là, c'est bien le sens social d'animal. Et non, en fait, c'est pas une affirmation biologique de dire que l'homo sapiens ne serait pas dans le règne animalia. C'est bien de dire qu'on se distingue de la définition sociale de l'animalisation, qu'on rejette l'animalisation qui est portée sur les femmes ou les personnes racisées.
Axelle Playoust-Braure : Exactement. En fait, on se rend compte qu'il y a des indices de la nature sociale de l'appartenance d'espèces dans toutes les rhétoriques militantes politiques des mouvements, des mouvements sociaux. Donc, comme tu le disais, c'est des slogans de type « on n'est pas du bétail », « on n'est pas des animaux », « on n'est pas des morceaux de viande », « on est tous humains ». Donc, en fait, il y a toute une rhétorique humaniste qui, et c'est intéressant, qui n'a pas conscience de mobiliser l'appartenance d'espèces, en fait. Parce que l'animalité est perçue de façon routinière comme étant une insulte. Et en fait, on ne va pas chercher plus loin. Les groupes, les mobilisations de gauche d'ordre humaniste, en fait, vont rejeter l'animalisation pour eux-mêmes, vont critiquer l'animalisation des humains, sans comprendre que, ou en comprenant pas assez malheureusement, que l'animalisation des humains, elle n'est possible que parce qu'il y a animalisation des animaux, que parce que les animaux sont mis dans la catégorie de l'animalité au sens d'individus de seconde zone, corps qu'on peut utiliser, ce statut subalterne, en fait. Et ça, c'est vraiment, je pense, un travail à faire, c'est de faire des ponts avec les autres mouvements sociaux en disant « vous utilisez déjà du vocabulaire antispéciste ».
Victor Duran-Le Peuch : Et seulement pour les humains.
Axelle Playoust-Braure :
Voilà. Mais essayons de voir ensemble ce que veut vraiment dire animalité. Et c'est un projet, je pense, qui porterait des résultats en termes de convergence des luttes, qui serait phénoménal, oui.
Victor Duran-Le Peuch : Ça me rappelle beaucoup ce qu'avait dit Valéry Giroux dans le premier épisode, où elle parlait de la politique de la respectabilité, qui est justement cette idée de revendiquer ses droits en se mettant du bon côté de la hiérarchie, mais en rejetant celles et ceux qui sont minorisés, en fait, qui sont dévalorisés. Et du coup, en reconduisant cette même hiérarchie, plutôt que de la contester de front. Ce qu'il faudrait idéalement faire quand on en a les moyens. Oui.
Axelle Playoust-Braure : Et ça me fait penser à un texte dans les cahiers antispécistes qui s'appelle « L'autre moitié », qui est en fait une sorte de poème où il y a un passage qui explique bien qu'en fait l'humanité, c'est la communauté fondée sur l'exclusion des Autres, avec un grand A, des différents, etc. Et je trouve ça très poignant comme texte. Et c'est vrai que ça brise le cœur quand on voit des manifestations pour différentes luttes, qui sont des luttes extrêmement importantes et légitimes évidemment, mais qui utilisent une rhétorique humaniste sans s'en rendre compte que ça renforce et ça réitère en fait la légitimité du spécisme. Et ce n'est pas conscientisé comme tel.
Victor Duran-Le Peuch : Moi, ce qui m'avait vraiment frappé à la lecture de votre mémoire, c'était que, alors qu'on a déjà parlé dans le podcast plusieurs fois de cette animalisation et ce dénigrement en fait des animaux, et on ne l'identifiait pas comme tel, mais en fait on voit maintenant que c'était en tant que catégorie sociale ou politique, et ce que vous décrivez, vous parlez de spéciation sociale dans votre mémoire, et en fait ça décrit un double processus, non seulement d'animalisation d'un côté, mais, vous l'avez déjà plus ou moins dit, d'humanisation de l'autre en fait, de construction de catégories politiques relationnelles opposées et hiérarchisées. C'est ça ?
Axelle Playoust-Braure : C'est ça. En fait, parce que dès qu'on pose l'existence d'espèces sociales, ce qu'on dit en même temps, c'est que ce sont des appartenances qui sont dynamiques, qui sont historiques, qui sont mouvantes en fonction des temps et des lieux. En fait, c'est ça aussi le travail des disciplines comme la sociologie ou l'histoire, c'est de comprendre l'évolution des phénomènes sociaux. Donc, quand on parle d'espèces sociales, forcément, on parle de construction des catégories. Donc, d'un côté, on a un processus pour les animaux ou l'animalisation, on a un processus d'infériorisation, de relégation dans les marges, de mise en... Il y a un terme utilisé par Colette Guillaumin qui est de mise en altérité. Et puis de l'autre, on a l'humanisation, on pourrait dire en tout cas, la construction d'une... qui est liée à la notion de dignité humaine, où en fait, en parallèle d'un côté, la mise en altérité, on pourrait parler de « mise en dignité » pour les humains. Donc, c'est pour ça que j'utilise le mot de « spéciation sociale ». Spéciation faisant référence, en fait, à la base à un phénomène évolutionnaire quand des espèces au sens biologique apparaissent. Et du coup, c'est le... Voilà, on parle d'espèce sociale ou on peut parler aussi de spéciation sociale.
Victor Duran-Le Peuch : C'est drôle parce que dans toute la rhétorique spéciste qui conteste toutes les idées et théories antispécistes, on retrouve beaucoup cette affirmation de l'humanisme, de l'humanité. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est presque révélateur. S'il y a besoin de le rappeler si souvent, c'est que c'est une construction, c'est que ça ne va pas de soi, c'est que ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un ordre social.
Axelle Playoust-Braure : Oui, il y a vraiment un truc paradoxal dans le fait de vouloir prescrire, de vouloir imposer des différences qui seraient normalement naturelles. Il y a un truc un peu...
Victor Duran-Le Peuch : Oui, qui sont présentées même comme naturelles, mais qui sont prescrites.
Axelle Playoust-Braure : Voilà, et en fait, ça devient ridicule parce que tout est bon pour maintenir une division soi-disant évidente. Donc, il y a tout un travail sur le « propre de l'homme » qui devient totalement absurde. Et il y a un passage magnifique dans un livre de Patrice Rouget. Ce livre, ça s'appelle « La violence de l'humanisme », où en fait, il y a un chapitre sur la notion de « propre de l'homme » où il dézingue totalement cet effort sans fin de vouloir reconstruire, remaintenir, réaffirmer la différence et l'éminence absolue de l'humanité. Et en fait, c'est une vaste entreprise qui est motivée par la volonté de garder l'ordre social en place. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces efforts dans les discours, dans les croyances, de vouloir réaffirmer les différences entre humains et animaux, de vouloir réaffirmer l'ordre social avec les humains au centre et au sommet de la création, ils sont d'autant plus mis en œuvre que le spécisme est contesté. Parce que les catégories sociales humanité et animalité étant mouvantes, n'étant pas acquises en tout temps et en tout lieu, il y a des luttes qui les remettent en question. Et du coup, il va y avoir des groupes sociaux qui vont contester les définitions essentialistes de l'humanité et de l'animalité. Et donc, en backlash, on va avoir les groupes réactionnaires qui vont réaffirmer des choses qui, selon eux, devraient être évidentes.
Victor Duran-Le Peuch : D'ailleurs, vous écrivez dans « Solidarité animale » avec Yves Bonnardel, je vous cite, « L'inclusion des animaux dans notre champ de considération morale et politique ne pourra se faire sans une remise en question de l'humanisme comme monopole illégitime de l'universel. »
Axelle Playoust-Braure : Oui. Et là, il y a un parallèle très fort à faire avec l'androcentrisme, qui est le fait de plaquer le général sur le masculin, de considérer que le masculin est le neutre, l'universel, etc. Et en fait, il y a un parallèle très fort à faire avec l'anthropocentrisme. Et à ce niveau-là, il y a des réflexions très intéressantes de Nicole-Claude Mathieu, encore une fois, sur l'androcentrisme et la façon de détricoter tout ça.
Victor Duran-Le Peuch : Alors, pour être sûr de bien comprendre la façon dont vous théorisez l'humanisme, parce qu'en fait, l'humanisme, c'est considéré comme quelque chose de très positif, en général, et par la grande majorité, c'est les Lumières, c'est l'héritage rationaliste, c'est un idéal qui a servi d'ailleurs à obtenir plus d'égalité entre les humains, qui est mobilisé pour obtenir des droits pour certaines personnes minorisées. Donc, j'aimerais comprendre si vous pensez que l'humanisme a une utilité mais qu'il est simplement incomplet en tant qu'il ne pense pas aux animaux autres qu'humains et qu'il pense que la sphère morale ne peut pas s'étendre au-delà de l'humanité, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est activement négatif, qui est une forme d'oppression en lui-même ?
Axelle Playoust-Braure : Alors effectivement, ça dépend de ce qu'on met derrière le terme « humanisme », c'est-à-dire que dans le sens le plus courant, effectivement, l'humanisme c'est un mouvement historique, scientifique, et dans ce sens-là, je ne vois pas le problème. Par contre, l'humanisme tel que, justement, tel que mobilisé par Patrice Rouget dans son livre « La violence de l'humanisme », c'est au sens de suprémacisme humain, c'est un régime politique et une organisation sociale où les humains ont des privilèges sur le reste des animaux. Donc dans ce sens-là, l'humanisme, pour moi, c'est quelque chose à abolir, il faut lutter contre l'humanisme au sens de suprémacisme humain. Mais du coup, il peut y avoir effectivement une confusion entre les deux ou quand on va critiquer l'humanisme, les gens vont penser qu'on va s'attaquer aux droits humains et au progrès socio-civilisationnel, alors qu'en fait, le projet anti-humaniste, ou en fait le projet antispéciste, c'est un projet d'abolition des privilèges que les humains se sont auto-octroyés sur le dos des autres animaux. À ce moment-là, ça ne serait plus le modèle social qu'il faudrait défendre, ne serait plus l'humanisme, mais un sentientisme où en fait le nouveau critère de considération morale et d'inclusion des animaux dans la sphère de considération morale, ce n'est pas le fait d'être humain, ce n'est pas le fait d'être un homme, ce n'est pas le fait d'être blanc ou chrétien, etc. C'est le fait d'être sentient, c’est à dire de pouvoir avoir des intérêts, ressentir des choses, d'avoir des émotions, de pouvoir souffrir. C'est le fait d'être un individu qui peut pâtir ou jouir de ce qu'il vit et qui a un avis sur la façon dont sa vie devrait se dérouler. Et ça, c'est le vrai universalisme. Ce n'est pas l'humanisme des Lumières qui se présente comme l'universalisme le plus abouti mais qui est en fait extrêmement colonialiste et raciste aussi. Il y a beaucoup de critiques à faire à l'humanisme en tant que période historique. Mais disons que l'aboutissement pour moi d'un universalisme, ça serait une considération morale de tous les êtres qui ont intérêt en fait à être inclus dans l'aspect de considération morale et dans les luttes politiques.
Victor Duran-Le Peuch : Donc en fait, on peut dire que le vrai idéal humaniste, donc pas celui qui a été utilisé de façon colonialiste, raciste et en fait exclusive, le vrai idéal devrait être inclusif et aller au-delà de l'humanité. Je pense d'un point de vue stratégique, est-ce qu’on ne crée pas plus de confusion et est-ce qu'on ne donne pas le bâton pour se faire battre à des opposants idéologiques quand on récuse quelque chose qui est connoté aussi positivement que l'humanisme ? Et ça me fait penser, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les écrits justement où les antispécistes sont accusés d'être anti-humanistes et donc contre les humains et contre leurs droits. Et je pense à la distinction qu'a introduite Martin Gibert entre un « humanisme inclusif » donc qui est en fait le sentientisme, et un « humanisme exclusif » qui est l'humanisme dont vous parlez et que vous appelez à combattre, en fait.
Axelle Playoust-Braure : Oui. C'est une distinction que je trouve très utile. Humanisme inclusif, humanisme exclusif. Après, effectivement, à la place d'humanisme, on peut parler de suprématisme humain, on peut parler d'exploitation animale, on peut parler de régime politique suprématiste. on ne peut pas pencher plus que ça sur est-ce qu'on devrait continuer à utiliser le mot humanisme ou non. Après, la notion d'humanisme en elle-même, je veux dire, il y a quand même « humain » dedans. Oui. Je pense que si on veut faire référence aux progrès sociaux, à la rationalité, au progrès scientifique, on utilise un autre mot. On parle de rationalisme, on parle de science, etc... Mais je pense que la notion d'humanisme pourrait être remplacée par un terme moins associé aux humains.
Victor Duran-Le Peuch : Et donc, pour prolonger cette idée-là, le plus souvent, l'humanisme que vous dites, « c'est la forme anthropocentrique que prend le spécisme dans notre civilisation ». Donc, ce suprémacisme humain, comme vous le dites, le plus souvent prend la forme d'une hiérarchisation explicite entre les humains sont supérieurs et les autres animaux. Mais parfois, ça prend la forme, et vous l'avez déjà suggéré plutôt dans l'entretien, d'un différentialisme qui dit non pas que les humains seraient supérieurs aux autres animaux, mais juste qu'il y a une différence, que de façon essentielle, les humains et les animaux sont différents.
Axelle Playoust-Braure : Oui. Alors moi je pense que les discours différentialistes qui postulent une différence soi-disant sans hiérarchie sont toujours plus ou moins au service d'une hiérarchie. Parce que la différence au sens différentialiste, elle est toujours prescriptive d'une position sociale. Elle n'est pas seulement descriptive. Tout ce qui est affirmation d'une essence ou d'une complémentarité entre des groupes différents, on n'est pas dans une description factuelle de certains individus sont ceci, cela, de façon totalement neutre et désintéressée. Oui, il y a toujours un enjeu de position sociale et de bien maintenir les personnes à leur rôle social, etc. Il y a toute une critique du différentialisme des sexes entre hommes et femmes qui est faite par les féministes matérialistes et notamment dans le tout premier numéro de questions féministes où il y a une sorte de mise en garde sur la notion de différence parce qu'il y a eu des mouvements féministes qui avaient tendance à revendiquer la différence des femmes, à en faire un étendard pour revaloriser les compétences et les caractéristiques féminines et en fait les féministes matérialistes disaient et disent encore attention à ne pas réutiliser malgré nous le discours des dominants qui veulent nous assigner un certain rôle, une certaine position, une certaine gangue précise.
Victor Duran-Le Peuch : D'accord. C'est pas si grave le différentialisme parce que de fait il y a des différences entre les humains et les autres animaux mais ce que vous dites c'est qu'en fait ce différentialisme de façade a pour fonction politique de renforcer la hiérarchie et de revéhiculer l'ordre social sans le dire. Oui
Axelle Playoust-Braure : parce que moi j'ai rien contre les différences factuelles sont évidentes entre tous les individus, on peut faire des ressemblances et des dissemblances on peut faire des groupes on peut prendre les individus un par un et constater des différences, c’est une question factuelle. Là où j'ai un problème c'est la notion de Différence avec un grand D, et c'est ça le différentialisme c'est une autre une autre conception de la différence qui est d'emblée essentialiste et c'est là que on se rend compte que c'est idéologique et que c'est là pour justifier un ordre du monde et des positions sociales dissymétriques.
Victor Duran-Le Peuch : Donc si le spécisme est une oppression est-ce qu'on peut dire que c'est une oppression systémique ? Et si oui pour être sûr de bien comprendre ce que voudrait dire une oppression qui ne soit pas systémique ?
Axelle Playoust-Braure : Alors « systémique » pour moi ça renvoie tout simplement à l'idée qu'il y a une organisation sociale avec une histoire avec une sédimentation des opinions dans la culture dans la loi il peut y avoir de la même façon qu'on peut parler d'un « racisme d'État » on pourrait parler d'un « spécisme d'État » et essayer de décortiquer les phénomènes les soutiens publics à l'industrie de l'élevage la répression la contestation du spécisme. En fait au-delà du fait que les individus peuvent avoir des idées ou une psychologie spéciste de dénigrement des animaux, le fait de considérer le spécisme comme un système ou une organisation sociale, c'est s'intéresser aux phénomènes de façon beaucoup plus large, de façon beaucoup plus historique, et mobiliser d'autres disciplines que simplement la psychologie ou ce genre de choses.
Victor Duran-Le Peuch : D’accord, donc en fait, l'oppression quand elle est décrite de façon sociale est toujours systémique par définition ?
Axelle Playoust-Braure : J'aurais tendance à penser ça. Après le mot d'oppression systémique il est un peu galvaudé aujourd'hui. C'est-à-dire que, moi je préfère parler d'organisation sociale et d'emblée essayer de décrire. Par exemple dans le cas du spécisme, de tout de suite dire que les animaux sont des propriétés, d'aller voir les textes de loi, d'aller voir le code rural, tout de suite aller sur des choses concrètes, qui, ou... Des choses très concrètes aussi c'est l'histoire de l'élevage, l'histoire de l'intensification de l'élevage. Il y a une anthropologue néerlandaise qui s'appelle Barbara Noske qui a introduit le concept de complexe animalo-industriel en 1989. Et ça c'est un concept intéressant parce que d'emblée l'idée c'est d'aller voir les réseaux d'acteurs, les lobbys, les organisations gouvernementales, les ONG, tout un tas d'acteurs qui ont un intérêt à développer l'élevage ou à faire perdurer l'élevage. Et l'idée c'est pas d'avoir une théorie complotiste sur des réseaux occultes d'acteurs non, c'est de décrire réellement qui finance l'élevage, depuis quand, dans quel but, dans quel pays aussi. Et de retracer comme ça l’histoire de la zootechnie, qui est toutes les sciences de l'élevage en fait, la génétique, la pharmacologie, qui fait que l'élevage a pu s'intensifier depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
Victor Duran-Le Peuch : Sur un plan un peu plus méta, une des choses dont je vous ai déjà entendu parler sur d'autres médias et qui est peut-être pas la plus évidente, c'est l'impératif de penser le spécisme de façon autonome. Parce que la lutte antispéciste, ce que vous dites, c'est qu'elle est une lutte en elle-même, avec des logiques de domination et de pouvoirs propres et qui mérite donc ses propres grilles d'analyse et ses concepts pour pouvoir bien et efficacement les dénoncer
Axelle Playoust-Braure : Oui. Parce que le gros problème auquel on est confronté aujourd'hui dans le mouvement antispéciste, c'est qu'on est sans cesse relégué ou associé à d'autres luttes et notamment la lutte environnementale ou la lutte anticapitaliste. Et le problème avec ça, c'est que déjà les mouvements environnementaux et anticapitalistes défendent très mal les animaux. Il peut y avoir des convergences ponctuelles qui font que ça va aussi dans le sens de la critique de l'élevage. Mais ce sont des mouvements sociaux qui ne formulent pas du tout des revendications en termes d'abolition de l'élevage, en termes d'abolition du statut de propriété des animaux, en termes d'abolition des privilèges humains, d'abolition des institutions spécistes. Donc en fait le fait d'être relégué associé à une lutte secondaire qui serait rattachée plus ou moins à ces autres luttes, ça nous empêche d'imposer nos axes de lutte, notre agenda politique, avec nos revendications propres. Et ça c'est un problème pour l'efficacité politique. Et je pense que la convergence avec d'autres mouvements sociaux ne pourra pas se faire de façon équilibrée pour les deux luttes tant que la lutte antispéciste n'aura pas une existence autonome avec ses propres apports théoriques, ses propres revendications politiques et ses propres, son propre agenda stratégique.
Victor Duran-Le Peuch : C'est vrai qu'on entend souvent ces discours qui font de l'exploitation animale une sorte d'émanation du capitalisme qui serait, qui oppresserait à la fois les humains et les autres animaux et la planète de façon plus ou moins indifférenciée et sans avoir d'analyse spécifique sur l'oppression des humains sur les autres animaux. Et quand on lit ces analyses, on peut en arriver facilement à la conclusion que l'exploitation animale n'est mauvaise que dans ses formes industrielles ou capitalistes. Et on parle alors d'abus ou d'excès comme s'il n'y avait pas de problème si la même chose était faite à petite échelle et du coup ça relégitime en miroir le fameux petit élevage bio, qui pourtant relève je pense que vous en conviendrez, qui relève aussi de l'exploitation spéciste quand on l'analyse comme une oppression spécifique.
Axelle Playoust-Braure : En fait ce qui manque au paysage politique des luttes actuellement, c'est une analyse en termes d'antagonisme d'espèces, d'antagonisme entre humanité et animalité. Ça c'est un axe d'analyse qui est totalement ignoré par les mouvements progressistes. On a d'autres axes d'analyse, sur les questions raciales, sur les questions sexistes qui sont aujourd'hui beaucoup plus acceptés, et repris et heureusement et évidemment. Mais c'est en ça que le mouvement antispéciste n'a pas encore réussi à imposer son propre axe d'analyse. Et ça me fait beaucoup penser à l'histoire des mouvements féministes, qui à l'époque où les féministes matérialistes ont commencé à se constituer comme force politique autonome subissaient ce discours de la part des marxistes orthodoxes qui disaient que l'antagonisme homme-femme il vient brouiller l'antagonisme principal qui serait l'antagonisme de classe entre capitalistes et travailleurs. Et ça c'est une façon de reléguer comme une sous lutte, une lutte de seconde zone, des luttes qui pourtant ont tout autant d'existence sociale que les autres et qui n'ont pas moins d'effet sur la vie des gens. Et en fait il y avait un peu cette idée que une fois que la lutte des classes aurait abouti de façon un peu (magique) miraculeuse, magique il y aurait les rapports hommes femmes qui se régleraient un peu d’eux mêmes. Donc ça c'est un gros danger, c'est de considérer qu'il y a des luttes secondaires, des luttes principales. C'est pour ça que Christine Delphy, il y a un recueil de texte qui s'appelle « L'ennemi principal », c'est une façon de dire nous femmes, notre ennemi principal c'est pas le capital, le capital a des effets sur nos vies concrètes l'idée c'est pas de dire qu'il n'y a pas d'intersectionnalité à ce niveau là, mais l'ennemi principal des femmes en tant que groupe social ce sont les hommes en tant que groupe social. Et poser cet antagonisme c'était totalement nouveau, ça a été extrêmement critiqué et aujourd'hui c'est encore très critiqué. Mais c'était l'avancée épistémologique majeure des féministes matérialistes. Et c'est la même chose que le mouvement antispéciste doit imposer dans les réflexions, les discussions des luttes actuellement. C'est qu'il y a un antagonisme qui a été totalement laissé de côté, qui n'est pas vu, c'est l'antagonisme entre les humains et les animaux entre les humanisés et les animalisés.
Victor Duran-Le Peuch : Pour éviter un contresens, je vais quand même vous poser la question, penser le spécisme de façon autonome, ça veut pas du tout dire la pensée de façon déconnectée des autres formes d'oppression.
Axelle Playoust-Braure : Pas du tout, effectivement. Mais on fait tant mieux les connexions avec les autres luttes qu'on a un sous-bassement théorique autonome. Parce que sinon les analyses elles sont d'emblée flouées. On ne peut pas faire une analyse croisée intersectionnelle réellement solide et équilibrée si on n'a pas d'emblée une analyse solide des deux systèmes qu'on cherche à comprendre ensemble.
Victor Duran-Le Peuch : Pour ma part je trouve l'application de la grille d'analyse matérialiste au spécisme vraiment passionnante et stimulante pour la réflexion et la recherche. Dites moi si vous aussi, ou si au contraire pas du tout. Et n'hésitez pas à me poser vos questions ou objections dans les commentaires ou sur les réseaux. Je fais de mon mieux pour y répondre et pour renvoyer vers d'autres ressources. Et parfois c'est vous qui apportez des compléments d'informations ou des références que je n'avais pas, ça me fait toujours très plaisir. L'entretien n'est en fait pas fini, ce n'était que la première partie, et vous pourrez retrouver la suite dans deux semaines. On parlera de l'élevage analysé comme une institution de l'oppression spéciste, du rôle de la publicité dans sa légitimation, et on continuera à tracer les conséquences d'une définition matérialiste du spécisme. Et avant ça on se retrouve pour une lecture la semaine prochaine. Allez, bisous !
Crédits
Comme un poisson dans l'eau est un podcast créé et animé par Victor Duran-Le Peuch. Charte graphique : Ivan Ocaña Générique : Synthwave Vibe par Meydän Musique : Takayama par Niwel
8 livres cités :
L'idéologie raciste · Genèse et langage actuel Colette Guillaumin

ISBN : 9783111269757 · publié le 1 janvier 1970
Description complète et liste des 2 épisode(s) qui le citent
Cité dans 2 épisode(s) :La grande arnaque · Sexualité des femmes et échange économico-sexuel Paola Tabet

Dans la majorité des sociétés connues, la sexualité apparaît comme un échange asymétrique et non réciproque entre hommes et femmes, une compensation masculine pour une prestation féminine, un paiement qui peut revêtir les formes ...
ISBN : 9782296384347 · publié le 1 janvier 2005
Description complète et liste des 2 épisode(s) qui le citent
Dans la majorité des sociétés connues, la sexualité apparaît comme un échange asymétrique et non réciproque entre hommes et femmes, une compensation masculine pour une prestation féminine, un paiement qui peut revêtir les formes les plus variées en échange d'une sexualité transformée en service. Comment se fait-il que les hommes, même plongés dans les situations les plus misérables, peuvent se payer le service sexuel d'une femme - alors que non seulement les femmes n'ont pas, sauf exception, cette possibilité mais de plus n'ont même pas droit à leur propre sexualité ?
Cité dans 2 épisode(s) :La pensée straight Monique Wittig

ISBN : 9782915547528 · publié le 1 janvier 1970
Acheter sur Place des LibrairesDescription complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
Cité dans 1 épisode(s) :La Violence de l'humanisme · Pourquoi nous faut-il persécuter les animaux ? Patrice Rouget
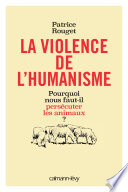
Dans cet essai lumineux, Patrice Rouget reconstitue le parcours métaphysique qui nous a amenés à nous détourner de l’animal pour ensuite le transformer en bouc émissaire de nos imperfections, puis à le ravaler au statut d’objet ...
ISBN : 9782702155042 · publié le 16 avril 2014
Description complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
Pourquoi le destin de l’animal empire-t-il au fur et à mesure que la civilisation progresse ? Pourquoi, dans une société aussi développée que la nôtre, aussi assurée de ses capacités, aussi capable de subordonner ses besoins élémentaires à une réflexion morale, persécute-t-on les animaux avec une bonne conscience qui frise parfois la jouissance ? L’humanisme métaphysique, en divinisant l’homme, exige-t-il que celui-ci vive dans le déni de ses origines, et punisse les animaux de lui être trop semblables ? Est-ce parce qu’ils échappent à la fatalité rhétorique, ne sont pas soumis à la passion mauvaise du moi, parce qu’ils se contenteraient, s’ils le pouvaient, de vivre pleinement leur vie qui est fusion avec le monde jusqu’à la mort qui est leur ultime abandon à l’ordre des choses, que les animaux sont l’objet d’une telle férocité de la part de nous autres, les humains ? Ne les haïssons nous pas, au fond, d’en être capables ? Dans cet essai lumineux, Patrice Rouget reconstitue le parcours métaphysique qui nous a amenés à nous détourner de l’animal pour ensuite le transformer en bouc émissaire de nos imperfections, puis à le ravaler au statut d’objet industriel uniquement destiné à satisfaire nos pulsions hédonistes, avec la caution permanente de l’humanisme métaphysique, idéologie illusoire qui accompagne avec une constance impressionnante l’histoire de la philosophie. Sotto voce, il instruit le procès d’une humanité qui a décidé d’asseoir son « exception naturelle » sur le supplice du reste du vivant.
Cité dans 1 épisode(s) :How the Irish Became White Noel Ignatiev
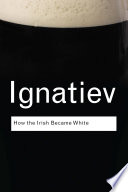
This is the story of How the Irish Became White.
ISBN : 9781135070694 · publié le 12 novembre 2012
Description complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
'...from time to time a study comes along that truly can be called ‘path breaking,’ ‘seminal,’ ‘essential,’ a ‘must read.’ How the Irish Became White is such a study.' John Bracey, W.E.B. Du Bois Department of Afro-American Studies, University of Massachussetts, Amherst The Irish came to America in the eighteenth century, fleeing a homeland under foreign occupation and a caste system that regarded them as the lowest form of humanity. In the new country – a land of opportunity – they found a very different form of social hierarchy, one that was based on the color of a person’s skin. Noel Ignatiev’s 1995 book – the first published work of one of America’s leading and most controversial historians – tells the story of how the oppressed became the oppressors; how the new Irish immigrants achieved acceptance among an initially hostile population only by proving that they could be more brutal in their oppression of African Americans than the nativists. This is the story of How the Irish Became White.
Cité dans 1 épisode(s) :Solidarité animale · Défaire la société spéciste Yves BONNARDEL, Axelle PLAYOUST-BRAURE
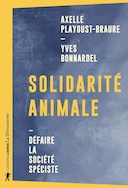
Proposant une synthèse claire et accessible, Axelle Playoust-Braure et Yves Bonnardel montrent en quoi le spécisme est une question sociale fondamentale et plaident en faveur d'un changement de civilisation proprement révolutionnaire.
ISBN : 9782348059278 · publié le 18 juin 2020
Description complète et liste des 4 épisode(s) qui le citent
Malgré la visibilité croissante de la " question animale ", la confusion règne parmi ses divers commentateurs. Les termes dans lesquels le débat est posé, y compris dans les milieux progressistes, empêchent d'en comprendre les enjeux véritables. C'est en particulier le cas pour la notion de " spécisme ", qui désigne une discrimination fondée sur le critère de l'espèce, et postule la supériorité des humains sur les autres animaux. Cette hiérarchisation des individus selon leur espèce a pourtant des effets très concrets : aujourd'hui, ce sont plus de 1 000 milliards d'animaux qui sont exploités et tués chaque année pour leur chair, parmi lesquels une vaste majorité d'animaux aquatiques. Comment est-il possible de continuer à justifier toutes ces souffrances et morts d'êtres pourvus de sensibilité ? Cet ouvrage, en dévoilant l'impasse théorique, éthique et politique dans laquelle nous enferme la société spéciste, clarifie les réflexions développées par le mouvement antispéciste en France. Proposant une synthèse claire et accessible, Axelle Playoust-Braure et Yves Bonnardel montrent en quoi le spécisme est une question sociale fondamentale et plaident en faveur d'un changement de civilisation proprement révolutionnaire.
Cité dans 4 épisode(s) :L'ennemi principal - tome 1 · Économie politique du patriarcat Christine Delphy
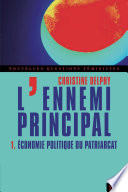
Ce livre en deux volumes rassemble la plupart des textes publiés par Christine Delphy à partir de 1970 au sujet de ce qu’on appelait jusqu’alors la «condition féminine» ou «la question des femmes», et qu’avec la deuxième vague ...
ISBN : 9782849504000 · publié le 3 octobre 2013
Description complète et liste des 2 épisode(s) qui le citent
Ce livre en deux volumes rassemble la plupart des textes publiés par Christine Delphy à partir de 1970 au sujet de ce qu’on appelait jusqu’alors la «condition féminine» ou «la question des femmes», et qu’avec la deuxième vague du mouvement féministe du 20e siècle, elle a désigné comme l’oppression des femmes et la question du patriarcat. L’oppression étant la situation des gens opprimés, les femmes étant le nom que l’on donne à ces opprimés-là, et le patriarcat étant le système socio-politique qui organise tout cela. Qui est donc alors «l’ennemi principal»? Pour la féministe matérialiste qu’est Christine Delphy, il ne s’identifie ni à l’Homme – avec une majuscule –, ni aux hommes en général. Ce n’est en effet ni une essence ni un groupe naturel: c’est un système. Or ce n’est pas non plus, ou plutôt pas principalement, pour cette théoricienne qui s’inspire de Marx mais dans un parfait esprit d’hétérodoxie, le système capitaliste. L’ennemi principal, c’est ce qu’elle a choisi d’appeler le patriarcat: à savoir un système autonome d’exploitation et de domination, une structure sociale hiérarchique et inégalitaire. Elle refuse toute explication de la subordination des femmes en termes idéalistes – que ce soit sur des bases biologiques, naturalistes ou essentialistes, ou bien encore fondées sur l’idéologie ou le «discours». Les différences entre femmes et hommes ne sont pas seulement des différences, mais aussi des hiérarchies. La société s’en sert pour justifier son traitement « différent » – en réalité inégal, hiérarchique – des groupes et des individus.
Cité dans 2 épisode(s) :L'anatomie politique · catégorisations et idéologies du sexe Nicole-Claude Mathieu

Dans toutes les sociétés, la conception du sexe anatomique comporte toujours un aspect politique dans l'organisation des relations entre les sexes.
ISBN : 9782907883207 · publié le 1 janvier 1970
Acheter sur Place des LibrairesDescription complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
Dans toutes les sociétés, la conception du sexe anatomique comporte toujours un aspect politique dans l'organisation des relations entre les sexes. L'auteur s'intéresse aux diverses idéologies qui sous-tendent l'oppression des femmes dans les civilisations et dans les discours ethno-anthropologiques.
Cité dans 1 épisode(s) :9 autres références :
- Article qui revient sur les liens entre féminisme et cause animale et sur l'explication de l'usage d'une rhétorique humaniste par certaines féministes (« Nous ne sommes pas des animaux ») (www.revue-ballast.fr)
- La revue Questions féministes, parue entre 1977 et 1980 (revue)
- la série de 4 épisodes "Blanc comme neige" sur la blanchité, du podcast Programme B (podcast)
- « L’autre moitié » - Estiva Reus (voir épisode spécial du podcast (podcast)
- le mémoire de master en sociologie d'Axelle Playoust-Braure "L'élevage comme rapport d'appropration naturalisé. Le cas du publispécisme" (www.academia.edu)
- le podcast Kiffe ta race, notamment l'épisode 27 "Check tes privilèges blancs" avec le sociologue Éric Fassin (podcast)
- l’épisode 7 du podcast À l’intersection avec la sociologue Kaoutar Harchi (podcast)
- les deux épisodes du podcast Camille « Contraint.es à l’hétérosexualité » et « Sexy Wittig » (podcast)
- Une liste des ouvrages critiques de l’antispécisme qui mobilisent la rhétorique humaniste (on y fait implicitement référence sans jamais les citer) est à retrouver en note 3 de cet article de l'Amorce écrit par Yves Bonnardel (lamorce.co)
 Comme un poisson dans l’eau
Comme un poisson dans l’eau