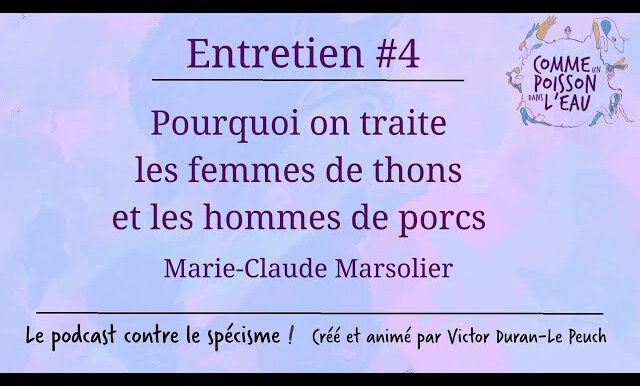Description
Bienvenue dans Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme ! Le langage est-il spéciste ? Marie-Claude Marsolier répond par l'affirmative dans cet entretien et montre que le français oppose systématiquement humains et non humains, dévalorise ces derniers et participe à l'invisibilisation des violences envers les non humains par des procédés d'euphémisation. On a également parlé de l'imbrication entre sexisme et spécisme dans certaines insultes, de la dimension implicitement spéciste du slogan '#Balancetonporc' et de l'importance d'une transformation du langage dans les luttes pour l'émancipation.
Transcription
Voir la transcription
Victor Duran-Le Peuch : Coucou, moi c'est Victor Duran-Le Peuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme. Aujourd'hui, on parle du spécisme dans le langage avec Marie-Claude Marsolier, qui est chercheuse au Commissariat à l'énergie atomique, le CEA, et travaille au Muséum national d'histoire naturelle en paléogénomique, c'est-à-dire la reconstitution des génomes anciens. Elle s'est intéressée à la question du langage et a publié en 2020 le Mépris des bêtes, un lexique de la ségrégation animale.
Victor Duran-Le Peuch : Bonjour Marie-Claude Marsolier.
Marie-Claude Marsolier : Bonjour Victor.
Victor Duran-Le Peuch : Alors j'aimerais me pencher avec vous aujourd'hui sur la question du langage, et surtout en fait sur la façon dont le français, que l'on parle tous les jours, véhicule et renforce constamment le spécisme. Alors votre ouvrage s'appelle « Le Mépris des bêtes », et justement, c'est drôle parce que j'avais prévu initialement d'appeler ce podcast « sale bête » par ironie et pour dénoncer le fait que « bête » et même « animal » est systématiquement une connotation négative dans le langage. Bon finalement j'ai fait le choix de « comme un poisson dans l'eau ». Mais alors vous, vous dites non pas que le langage est spéciste, mais plus spécifiquement qu'il est misotaire. Alors est-ce que c'est vous qui avez forgé ce terme-là, et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il est formé et ce qu'il veut dire ?
Marie-Claude Marsolier : Alors j'ai pensé avoir inventé ce terme, parce qu'au début j'ai regardé dans les dictionnaires et il n'est pas présent dans les dictionnaires sur Internet. Et après en faisant des recherches sur Google, j'ai vu qu'il y avait quelques occurrences, vous pouvez trouver quelques occurrences. Donc c'est un terme qui est construit de manière très classique, il est composé de deux éléments grecs. D'une part le verbe « misein » qui signifie « détester ». Ou « haïr », et qu'on va retrouver dans « misogyne » ou « misanthrope ». Et puis le mot « thère », « Thérione » en grec, qui signifie « animal non humain ». Alors parce que les Grecs, dans l'Antiquité, désignaient l'ensemble des animaux par le terme « zoone », donc qui a donné l'élément « zoo » en français, donc comme la zoologie par exemple. Mais pour les Grecs, les humains faisaient partie des zoones. C'était juste des animaux, des zoones qui étaient doués du « logos ». Le « logos » étant la raison ou le langage, ce qui sont des choses très proches comme concept chez les Grecs. Alors l'emploi de cet élément « thère » me semblait plus justifié pour se composer que l'élément « zoo » parce que ce sont spécifiquement les animaux non humains qui sont victimes de ce mépris par les humains. Alors « terre » est moins connu que « zoo ». Mais il se retrouve par exemple dans un mot comme « thériomorphe » qui veut dire qu'il y a la forme d'un animal quand on parle d'une figure thériomorphe. Et puis en science, eh bien les mammifères euthériens dont nous faisons partie sont des mammifères qui ont un placenta. Les mammifères métathériens sont des mammifères sans placenta comme les marsupiaux.
Victor Duran-Le Peuch : Donc la première chose que vous avez analysée dans le langage, c'est une opposition ou ségrégation entre, vous l'avez déjà plus ou moins dit, entre les humains d'un côté et tous les autres animaux de l'autre. Alors peut-être que vous pouvez préciser la démarche que vous avez eue. En fait, vous avez regardé dans un dictionnaire de référence et vous avez pu constater que la définition même des termes distinguait et opposait systématiquement les humains et les autres animaux.
Marie-Claude Marsolier : Voilà. C'est-à-dire que quand on regarde dans un dictionnaire classique les définitions du terme « animal », il y a deux définitions. Il y a « animal » au sens scientifique de métazoère, membre du groupe des animalia qui, évidemment, englobe les humains. Et puis il y a « animal » au sens de, spécifiquement, métazoère non humain. D'un point de vue scientifique, et donc moi je suis biologiste, et c'est vrai que d'un point de vue scientifique, cette catégorie d'animal non humain n'a aucun sens. Parce que quand on construit des catégories scientifiques, on les construit sur la base de caractéristiques positives qui sont partagées. Et là, ce terme « animal » au sens de « non humain », c'est vraiment un terme d'exclusion. C'est un terme négatif parce qu'il fait référence aux humains. Et cette catégorie des non humains, elle n'est jamais définie par rapport à elle-même, mais par rapport à un centre de référence, une référence qui est située ailleurs. Et en fait, on le comprend en réfléchissant, on le comprend, parce que ce n'est pas un terme scientifique, en fait c'est un terme social qui va désigner l'ensemble des êtres sentients que les humains peuvent, en gros, tuer, enfin auxquels les humains peuvent faire un peu n'importe quoi, sans avoir trop de soucis avec la loi, voire en étant même encouragés par la loi.
Victor Duran-Le Peuch : Et à l'inverse, il y a d'autres termes qui sont plutôt connotés positivement, qui ne s'appliquent qu'aux humains, alors qu'ils pourraient très bien s'appliquer aux autres animaux aussi. Vous prenez l'exemple de « visage », qu'on utilise presque jamais, enfin selon la définition du dictionnaire, qu'on n'est pas censé utiliser pour les animaux autres qu'humains.
Marie-Claude Marsolier : Exactement. Donc effectivement, quand on regarde la façon dont sont désignés les non humains, donc il y a « animal » dans ce sens restrictif, péjoratif, et il y a aussi donc ce mot « bête », qui est très péjoratif, puisque même s'il est dérivé au début d'un mot latin « bestia », qui signifiait les bêtes féroces, en fait il a pris en français une connotation de stupidité. Être bête, c'est être stupide. Donc on désigne en fait les non humains de manière très péjorative avec ce terme « bête qui a été extrêmement prolifique, c'est les bêtises, bétifier. Donc d'un côté on a des termes très péjoratifs pour désigner les non humains, et par contre on a réservé aux humains des termes très positifs, enfin qui leur sont exclusivement réservés. Donc « visage », c'est un très bon exemple. De manière intéressante, l'anglais n'a pas cette distinction, parce qu'en anglais on va dire « face » pour autant le visage des humains que des non humains. Et donc on a cette particularité en français de réserver « visage », qui signifie donc partie antérieure de la tête d'un humain. On la réserve strictement aux humains, et donc ça c'est la définition des dictionnaires. Alors il y a bien sûr des écrivains et des écrivaines qui vont subvertir cette définition et parler du visage d'un chien, d'un cheval, enfin de n'importe quel être sentient, avec de préférence deux yeux, sur une partie antérieure. Et donc en plus de « visage », c'est vrai qu'il y a des tas de termes pour désigner des individus qui sont strictement réservés aux humains. Donc de manière très caractéristique, le terme « personne » est réservé aux humains. le dictionnaire, une personne c'est un humain, indépendamment de son sexe. Et puis même de manière plus banale, disons-nous, quand on parle de « quelqu'un », « quelqu'un », ça ne peut pas être un homme humain. Si on dit « j'ai vu quelqu'un passer dans la rue », peu de gens penseront que ça peut être un chien ou un chat, par exemple.
Victor Duran-Le Peuch : Ça me fait penser, des fois, on lit dans des articles qu'il y a eu un incendie qui n'a fait aucune victime. Quand, par exemple, des milliers d'animaux sont morts dans l'incendie. Mais voilà, c'est sous-entendu que « victime » ne peut s'appliquer aussi qu'à « humain ». Donc en fait, j'ai l'impression que c'est encore plus répandu que ça dans l'usage qu'on a de la langue. Et un autre type de mot qu'on n'utilise que pour les humains, c'est par exemple le fait d'être « enceinte » ou d'« accoucher ». Ce ne sont pas des termes qu'on utilise pour les autres animaux.
Marie-Claude Marsolier : Oui, et c'est même vu de manière… Enfin, il y a des gens qui sont profondément choqués quand on dit qu'une vache accouche. Il y a des gens qui ressentent cette expression comme une dégradation des êtres humains. Et c'est intéressant parce que, Arthur Schopenhauer avait déjà noté qu'en allemand, il y avait cette propension à distinguer des termes spécifiquement pour les humains et pour les non-humains. Et il disait que c'était une manière de déguiser, sous la différence des termes, une identité fondamentale des choses ou des actions.
Victor Duran-Le Peuch : Donc les mots qu'on est censés utiliser d'après le dictionnaire, c'est non pas « enceinte » et « accoucher », mais « être gravide » et « mettre bas », c'est ça ?
Marie-Claude Marsolier : Voilà. Être en gestation, maître bas, mettre bas à des petits, alors que les humaines vont accoucher d'enfants ou de bébés.
Victor Duran-Le Peuch : C'est drôle parce que ça s'applique même à la question du plaisir sexuel. On pense toujours que les rapports sexuels des animaux non-humains seraient uniquement le produit d'un instinct de reproduction, par opposition à ceux des humains qui auraient la faculté de détacher la sexualité de sa dimension. Et même d'en faire un acte relationnel ou social complexe. Du coup, c'est une forme d'opposition supplémentaire que vous analysez dans votre ouvrage.
Marie-Claude Marsolier : Oui, c'est assez fascinant. C'est vrai que la sexualité, quand on regarde... Moi, je me suis beaucoup fondée sur un dictionnaire qui a été élaboré par une équipe de linguistes à la fin du XXe siècle. Je pense que ça s'est terminé en 1994. Et ça a été vraiment un travail considérable pendant 20 ans. Une équipe du CNRS a fait un travail, encore une fois, considérable de recension et de définition. Et donc, ça s'appelle le CNRTL et qui met à disposition sur un site internet ce dictionnaire.
Victor Duran-Le Peuch : C'est le trésor de la langue française, non ?
Marie-Claude Marsolier : Exactement. Et ce trésor de la langue française informatisée contient vraiment des perles. Voilà. Dont la sexualité qui est définie pour les animaux non humains et pour les végétaux, tout ça, c'est un peu la même chose, comme acte purement de reproduction. Et par contre, pour les humains, c'est un échange, c'est une recherche de plaisir, c'est censé être même, combler l'épanouissement de la personnalité. Enfin, il y a beaucoup. Même, ça se retrouve aussi dans des manuels scolaires. Le plaisir sexuel est censé être réservé aux humains, éventuellement à quelques grands singes, éventuellement aux dauphins.
Victor Duran-Le Peuch : Et alors, c'est drôle parce que vous donnez même l'exemple que je trouve vraiment très éloquent du clitoris, qui, d'après la définition du dictionnaire, est censé être réservé à l'anatomie humaine, alors que non, en fait, alors qu'il y a des preuves chez les animaux de la présence d'un clitoris.
Marie-Claude Marsolier : C'est des preuves. Effectivement, il y a des organes homologues, c'est-à-dire que, par exemple, chez tous les mammifères, quand on regarde les organes génitaux femelles, il y a des structures qui sont ce qu'on appelle homologues, c'est-à-dire qui ont la même position les unes par rapport aux autres. Et donc, on ne peut pas ne pas appeler ça un clitoris, si on veut être rigoureux. Mais c'est vrai que, les dictionnaires français sont unanimes sur le fait que clitoris, ça fait partie de l'anatomie humaine, point. Alors, il y a Priscille Touraille qui a vraiment, je vais lui emprunter cet exemple, et elle, c'est une anthropologue qui fait des études du genre. C'est une manière de priver le clitoris d'une assise phylogénétique, alors que le pénis, par exemple, les gens n'ont aucun problème pour dire que ça se retrouve chez toutes les espèces de mammifères. Et même chez les oiseaux, alors qu'il y a 3% des oiseaux qui ont un pénis, par exemple. Mais ça, c'est très volontiers évoqué. Et même la notion d'orgasme, évidemment, s'il n'y a pas de clitoris, il ne peut pas y avoir d'orgasme chez les animaux non humains. Et encore tabou, même chez les scientifiques. C'est vraiment une décision politique assez réfléchie, de se dire à quel moment on va pouvoir parler d'orgasme. Par exemple, chez les souris, il y a des équipes scandinaves qui étudient ça. Et ça donne lieu à des discussions vraiment stratégiques, de dire quand est-ce qu'on va faire le titre d'un article en parlant vraiment d'orgasme pour un non humain.
Victor Duran-Le Peuch : Et alors, en plus d'opposer systématiquement humain et non humain, le langage hiérarchise, c'est-à-dire qu'il valorise l'humain et surtout, il dévalorise systématiquement les animaux non humains. Et j'ai l'impression que l'élément de dévalorisation le plus courant peut-être, c'est l'idée d'un manque d'intelligence ou de rationalité des non humains, qui est implicite dans beaucoup de définitions.
Marie-Claude Marsolier : Oui, c'est vrai qu'il y a des dictionnaires pour lesquels « animal » au sens restreint, c'est un être qui est privé de raison. Ça remonte à Aristote, parce que pour Aristote, les humains sont des « zoones », donc des animaux, « eikon logon », qui ont le logos. Alors que les non humains sont, c'est comme parler du silence des bêtes d'Elisabeth de Fontenay, ça fait référence à ça. Les non humains ne parlent pas de langage humain, donc ils sont silencieux, donc ils n'ont pas la parole, ils n'ont pas le logos, et donc ils n'ont pas la raison. Et donc on voit le poids de ces traditions que les gens répètent d'une génération à l'autre. Effectivement, le fait d'avoir des êtres qui sont proclamés stupides, ça ne peut que favoriser leur exploitation.
Victor Duran-Le Peuch : Oui, on en a parlé dans le premier épisode avec Valéry Giroux, l'utilisation de ce critère-là d'intelligence ou de rationalité comme critère qui est en fait arbitraire, mais pour fonder une discrimination, entre les humains et les non humains. Il y a eu aussi la question de la saleté ou de l'obscénité, et alors là, je crois que l'animal qui concentre tout le mépris, c'est vraiment le porc.
Marie-Claude Marsolier : Voilà, ça c'est vrai. Et c'est vrai que c'est des choses, c'est assez fascinant, parce qu'avant de me plonger dans ce travail, c'est vrai qu'on dit de temps en temps faire des cochonneries, ou ce type est un porc, et il y a eu récemment des slogans « balance ton porc », « science porc », pour parler de harcèlement sexuel.
Victor Duran-Le Peuch : Et oui, alors que c'était « me too » en anglais, on aurait pu traduire par « moi aussi ».
Marie-Claude Marsolier : Absolument. Bon, je pense que les anglo-saxons sont plus conscients des enjeux du langage. En tout cas, je pense qu'il y a chez eux moins de spécismes dans leur langage qu'en français. Et donc, c'est vrai que, par exemple, ils peuvent aussi parler « chauvinistic pig », et les « pigs », ce sont aussi les policiers en anglais.
Victor Duran-Le Peuch : Alors, comme nous, c'est les poulets en français ?
Marie-Claude Marsolier : Nous, c'est les poulets, mais récemment, il y a eu le hashtag « mort au porcs ».
Victor Duran-Le Peuch : Ah oui, juste.
Marie-Claude Marsolier : Alors, peut-être en référence avec cette image qui vient des anglo-saxons. Et c'était, avant, c'était « mort aux vaches », donc les policiers, c'était aussi les « dreaux-per », les « perdreaux ». Bon, enfin, il y a beaucoup de termes pour les, pour les désigner, mais évidemment, qui ont tous la même finalité, et tous cet aspect, cette possibilité d'utiliser les animaux non-humains pour les dévaloriser.
Victor Duran-Le Peuch : Oui, dès qu'on veut parler de quelque chose de négatif, on va avoir tendance à animaliser la personne, ou à comparer avec des animaux non-humains.
Marie-Claude Marsolier : Exactement.
Victor Duran-Le Peuch : Et pour revenir sur la question du slogan « balance ton porc », comment vous l'analysez-vous ? Est-ce que ça veut dire que c'est un slogan qui a aidé une lutte contre un type d'oppression, en l'occurrence sexiste et patriarcale, mais qui, du coup, en perpétue une autre, l'oppression spéciste ?
Marie-Claude Marsolier : Malheureusement, oui. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que, d'un côté, c'est une évidence qu'il faut promouvoir la parole des personnes qui ont été victimes de harcèlement, et d'un autre côté, c'est vraiment particulièrement mal choisi. Et c'est vrai que c'est malheureusement des erreurs qui ne sont pas rares, d'utiliser pour se défendre soi, en fait, c'est se servir d'autres qui sont encore plus opprimés pour essayer soit de se sortir de l'oppression.
Victor Duran-Le Peuch : Peut-être que ça vous rappelle ce qu'a évoqué Valéry Giroux à la toute fin du premier entretien. C'est ce qu'on appelle la politique de la respectabilité. C'est-à-dire chercher à se rendre soi-même respectable selon les critères de la hiérarchie sociale. Mais en reconduisant cette même hiérarchie pour d'autres personnes. En l'occurrence, pour les non-humains.
Marie-Claude Marsolier : Je ne pense pas que les gens qui utilisent ça soient conscients des problèmes. Parce qu'ils sont comme tout le monde, ils vivent dans le spécisme, et ils ont peut-être moins le loisir de réfléchir à ces formes d'oppression, étant eux-mêmes victimes d'un autre type d'oppression.
Victor Duran-Le Peuch : Plus largement, pour la question de tout ce qui est le mépris associé à tout ce qui se réfère aux animaux non-humains, vous listez, et c'est assez drôle, mais vraiment faramineux, le nombre d'insultes à base de noms d'animaux. Et on parle d'ailleurs de noms d'oiseaux pour désigner les insultes. Et il y en a un paquet, en fait.
Marie-Claude Marsolier : Oui, en fait, on a l'impression que n'importe quel nom d'animal non-humain peut servir d'insulte. Qu'on soit une limace, qu'on soit une autrice, qu'on soit une autruche et qu'on se mette la tête dans le sable, qu'on ait une mémoire de poisson rouge, ou qu'on soit une bécasse ou une tête de linotte, une vache, un cochon, un chien... Honnêtement, effectivement, il y a quelques non-humains, quelques espèces qui échappent à cette dévalorisation, donc on est fort comme un taureau ou brave comme un lion, même si ça ne veut rien dire, parce qu'en fait, les lions, par rapport aux lionnes, sont nettement moins féroces.
Victor Duran-Le Peuch : Oui, c'est les lionnes qui chassent, en fait.
Marie-Claude Marsolier : C'est les lionnes qui chassent, oui, pas de chance. Mais bon, voilà, on peut chanter comme un rossignol, mais en fait, il y a très peu d'expressions qui sont valorisantes pour les non-humains. Et à côté de cette poignée d'expressions, à peu près n'importe quel nom d'espèce, de toute façon, non-humaine, va être dévalorisante. Comme les termes animal et bête qui sont appliqués aux humains sont dévalorisants.
Victor Duran-Le Peuch : D'ailleurs, vous parliez d'animalisation. Un des exemples que vous donnez dans le livre, c'est que les femmes sont parfois traitées de chiennes, par exemple.
Marie-Claude Marsolier : Absolument, absolument. Et puis, « ma poule ». Donc, il y a Marina Iaghello qui, dans son livre « Les mots et les femmes », parle de beaucoup de choses, mais en particulier de tout son répertoire. Une « bonne lapine », c'est une femme qui a beaucoup d'enfants. Une « coche », qui voulait dire la femelle du cochon, « chameau », de toute façon, c'est dévalorisant. On ne sait pas exactement ce que ça veut dire, on sait juste que c'est négatif.
Victor Duran-Le Peuch : J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux qui sont épargnés par la connotation péjorative. Par exemple, en termes d'animalisation de personnes minorisées, je me rappelle, par exemple, quand Christiane Taubira avait été comparée à un singe dans l'Assemblée. C'est clairement raciste, mais c'est en fait, à la fois, raciste et spéciste.
Marie-Claude Marsolier : Alors, en fait, c'est compliqué pour moi. C'est évidemment raciste, spéciste, mais d'une certaine manière, pour moi, c'est scientifique, parce que nous sommes des singes, nous sommes des primates. Mais bon, il y a peu de gens qui le prennent de cette façon-là. Mais évidemment, de toute façon, en particulier pour les femmes, c'est vrai que toutes ces expressions sexistes, en fait, elles sont négatives, essentiellement parce que les animaux non humains sont dévalorisés. Sinon, se faire traiter de poule, pourquoi pas ?
Victor Duran-Le Peuch : Ça pourrait ne pas être une insulte si on n'était pas spéciste, en fait, si on ne dévalorisait pas tout ce qui est non humain.
Marie-Claude Marsolier : Exactement.
Victor Duran-Le Peuch : Ouais. Et alors, une troisième manifestation du spécisme, justement, dans le langage que vous analysez dans votre livre, c'est l'euphémisation de la violence et de l'exploitation des animaux. Par exemple, c'est beaucoup le cas pour les termes autour de l'abattage, qui sont tout le temps euphémisés. Alors, je précise que l'euphémisation, c'est l'idée que ça revient à adoucir ou à édulcorer une réalité, mais du coup, aussi, en partie, à la dissimuler.
Marie-Claude Marsolier : Oui, absolument. C'est une très bonne définition d'euphémisation. Bon, c'est sûr que les personnes qui sont dans l'agroalimentaire ou même dans la recherche, qui sont interrogées, mis en cause dans leurs pratiques, se réfugient souvent, pour toute leur communication, dans ces euphémismes. Et le terme « abattage », lui-même, en fait, est une euphémisation parce que c'est un terme qui est extrêmement général. Et Noeli Vialles analyse bien cette façon d'euphémiser tous les traitements des non-humains dans les abattoirs, parce qu'elle dit tout ce traitement qui va finir par donner de la viande, parce qu'elle dit qu'il y a beaucoup de connotations avec le règne végétal. Et c'est vrai qu'on peut dire abattre un animal comme on abat un arbre. Enfin, c'est même beaucoup plus large que ça, parce qu'on abat un arbre, on abat des cartes, on abat un mur, une maison. Donc, abattre est vraiment extrêmement polysémique. Et on peut contraster ça avec l'équivalent pour un humain qui serait assassiné, par exemple. Là, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique. Et donc, du coup, émotionnellement plus sensible. Et c'est vrai, dans l'élevage, il y a tous cette manière de désigner les traitements dont les animaux sont victimes, et qui sont assez terribles, de coupe du bec, de castration, de coupe de la queue pour les cochons. Évidemment, il n'y a jamais d'anesthésie, parce que les anesthésiants sont interdits, ils se retrouveraient dans la chair de ces êtres. Tout ça, c'est regroupé sous un terme opaque de soins aux animaux, et c'est vraiment terrible. Et même le terme bien-être animal lui-même est utilisé en permanence, alors qu'il faudrait parler de souffrance animale, de mal-être animal. On ne peut pas parler de la notion en général de bien-être animal, ça n'a de sens que si la majorité des individus concernés ne sont pas dans des situations de souffrance. C'est comme si, de la même manière, pour la population française, on peut parler de santé, de santé publique, dans la mesure où la majorité des individus ne souffrent pas, ne sont pas dans des hôpitaux. Et là, pour les animaux non-humains, en particulier dans les élevages, quand on sait qu'il y a entre 80 et 90% des individus qui sont dans des élevages intensifs, parler de bien-être, c'est vraiment Orwellien. C'est une manière de tout mélanger pour que les mots perdent leur sens. C'est comme dire « la liberté c'est l'esclavage » parce qu'il y a les slogans qui se retrouvent dans le newspeak d'Orwell de 1984 où la « liberté » c'est l'esclavage, le « Min Love », le ministry of love, le ministère de l'amour, c'est le ministère de la guerre en fait. Donc c'est cette confusion savamment entretenue du vocabulaire pour faire perdre aux mots leur signification qui est malheureusement très utilisée.
Victor Duran-Le Peuch : Et en aval d'ailleurs, côté consommateur, il y a aussi une euphémisation de la consommation des produits d'origine animale. Vous parlez dans l'ouvrage de la bataille sur le langage autour du lait végétal.
Marie-Claude Marsolier : Alors oui, c'est vrai qu'il y a une recherche de substituts d'origine végétale. Donc le lait, c'est un très bon exemple parce qu'aujourd'hui on trouve toute une gamme de lait d'origine végétale, de soja, de noisette, d'avoine, de riz. Eh bien ces boissons avec, à base d'aliments végétaux, en fait ont été désignées par leurs producteurs par le terme lait parce que c'était des liquides qui étaient souvent blancs, dans lesquels, dont la composition se rapprochait de celle du lait en termes de protides ou de lipides. Et puis c'était le but avoué, c'était d'avoir des substituts végétaux. Et donc il y a eu de la part des producteurs de ces aliments d'origine animale, de chair ou de lait, la volonté de stopper ce genre d'initiative en exigeant qu'au niveau européen, que ces appellations de lait ou de beurre ou de steak soient strictement réservées à des produits d'origine animale. Donc c'est en cours, je pense que pour la majorité des produits c'est déjà acté. Ça a fait l'objet de beaucoup de protestations. Mais bon, c'est vrai que j'ai un avis un peu mitigé sur le sujet parce que je comprends d'un côté que reprendre pour un produit végétal une dénomination qui correspond à un produit d'origine animale, comme lait ou steak, c'est une façon de faciliter la transition des produits animaux vers des produits végétaux. Maintenant, il me semble que c'est rester aussi dans une position où ces produits d'origine végétale, sont toujours vus comme des ersatz, des produits de référence qui sont des produits d'origine animale. Et il me semble qu'il faut se détacher de ça, que les produits d'origine animale ne sont pas l'alpha et l'oméga de la nourriture humaine et que rester inféodé à ces produits n'est pas une bonne idée à moyen et long terme.
Victor Duran-Le Peuch : Et pourtant, si les lobbys de l'agroalimentaire investissent massivement pour faire du lobbying pour empêcher justement de pouvoir appeler le lait d'avoine, lait d'avoine et non pas boisson à base d'avoine, c'est bien que du coup il y a une vraie effectivité du langage, non ?
Marie-Claude Marsolier : Oui, ça c'est sûr. En fait, je pense qu'il y a une combinaison d’effets à court terme et d’effets à moyen-long terme. Donc ça dépend de ce que l'on veut favoriser. À court terme, c'est sûr qu'on peut quand même vraiment imaginer que ça facilite la transition vers les aliments d'origine végétale.
Victor Duran-Le Peuch : Mais c'est ça qu'ils essayent de stopper en fait les lobbys.
Marie-Claude Marsolier : Absolument. Oui.
Victor Duran-Le Peuch : Mais vous, vous appelez en fait à long terme à plutôt valoriser de façon séparée peut-être les produits d'origine végétale, enfin les produits végétaux en fait.
Marie-Claude Marsolier : Oui, je pense que l'avenir ultimement c'est ça et appeler un steak de soja un steak, je pense que dans quelques décennies on se dira mais c'est curieux. Parce que les steaks c'est de la chair animale, enfin c'est quand même, c'est à peu près le pire de ce qu'on peut faire subir comme exploitation aux non-humains. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'à un moment si l'humanité progresse dans un sens plus favorable aux non-humains, il me semble qu'on abandonnera ces désignations.
Victor Duran-Le Peuch : Et d'ailleurs toujours à propos des lobbys, il y a vraiment quelque chose de fabuleux que j'ai vu passer et dont vous parlez dans votre bouquin, c'est la récupération du terme flexitarien par justement ces mêmes entreprises agroalimentaires. Est-ce que déjà vous pouvez expliquer ce que ça veut dire flexitarien dans le sens initial et dans le sens détourné en quelque sorte et récupéré par l'industrie ?
Marie-Claude Marsolier : Alors flexitarien donc c'est un terme qui a été forgé par un Américain, donc Mark Bittman je crois, et qui était favorable à une décroissance vraiment forte de la consommation de viande. Il lui disait, vraiment de manière extrêmement convaincante, la consommation de chair animale c'est un désastre à tout point de vue, en particulier écologique, il était plus sensible à cet aspect-là, et donc il faut qu'on diminue et il faut devenir majoritairement végétarien, éventuellement se permettre de temps en temps de consommer des produits d'origine animale, mais ça doit être vraiment très limité et flexitarien ça tend à être ultimement vers le végétarisme. Et le problème c'est que je pense que ce terme c'est comme « bien-être », c'est des termes qui ne sont pas très adaptés, et « flexitarien » ça a une connotation positive, parce que être flexible aujourd'hui c'est très valorisé, il faut être agile, il faut être capable de faire plein de choses, être adaptable, et donc Interbev, et l'industrie de la viande globalement, a facilement pu récupérer ce terme en disant en fait les flexitariens c'est les gens, c'est les omnivores, c'est les gens qui consomment de tout, qui ne font pas d'histoire parce que il y a un aliment d'origine animale, il y a un peu de viande, etc. Donc les flexitariens, ils mangent de tout, ce sont des omnivores, et par omnivores ils veulent surtout dire que ce sont des carnivores, c'est-à-dire qu'ils ne mangent pas que des végétaux. Et donc ça a été complètement dévoyé, et donc Interbev a fait une campagne il y a quelques années, qui s'intitulait « Naturellement Flexitarien », pour dire que les flexitariens c'était l'humain avancé qui suivait Interbev.
Victor Duran-Le Peuch : Mais alors cette campagne tourne encore en fait, je l'ai vu passer récemment à la télé, et je suis même allé voir juste avant l'entretien sur leur site. Donc « Naturellement Flexitarien », allez voir c'est très drôle, on retrouve en gros en rouge en arrivant sur le site « Aimez la viande, mangez-en mieux ». C'est vraiment cette idée que, en fait, il faut continuer à manger de la viande, et c'est une idée que je retrouve vraiment beaucoup autour de moi, cette idée qu'il faut manger de la viande, mais de qualité. Donc peut-être réduire un petit peu, mais en fait c'est surtout, il s'appuie sur cette image du petit élevage bio qui serait bien à la fois pour l'animal, et pour l'humain, et pour la planète.
Marie-Claude Marsolier : Voilà, bon. C'est vrai que ça va complètement à l'encontre de ce qu'on connaît de la proportion d'animaux non humains qui sont en élevage intensif, et c'est vrai que les petits élevages sont la caution de la viande aujourd'hui. Et donc, ce terme « flexitarien », on est venus, en fait, à se retourner contre les végétariens qui apparaissent comme, ou les végétaliens qui apparaissent comme des êtres rigides, parce qu'ils ne sont pas flexibles, ils ne reviennent pas à la viande.
Victor Duran-Le Peuch : Oui, alors que les flexitariens sont les gens cools, dans cette opposition-là.
Marie-Claude Marsolier : Voilà, c'est des gens qui, qui ne font pas d'histoires, qui mangent de tout, qui savent s'adapter, tandis que les végétariens et les végétaliens sont des psychorigides.
Victor Duran-Le Peuch : Donc, si je comprends bien, et pour résumer, en fait, les mots qu'on utilise ont pour effet de nous donner bonne conscience quand on participe, en fait, à des pratiques violentes. Et on peut se dire que, du coup, les pratiques de l'élevage ne sont pas si horribles si c'est des soins et si c'est du bien-être animal. Ou on peut dire que, voilà, si on est flexitarien, on fait déjà ce qu'on peut pour aider les animaux, on réduit comme tout le monde. En fait, la définition est si large que flexitarien, tout le monde peut l'être.
Marie-Claude Marsolier : Et c'est un des grands avantages. Flexitarien, en fait, ça ne veut rien dire. Enfin, encore une fois, je pense que ça veut dire plutôt en opposition aux êtres rigides, psychorigides, que sont les végétariens et végétaliens.
Victor Duran-Le Peuch : Donc, pour résumer, le spécisme dans le langage se manifeste principalement par trois caractéristiques. La séparation entre humains et non-humains, la dévalorisation des non-humains, et l'euphémisation des violences envers les non-humains. Alors, j'en arrive, j'aimerais être sûr de bien comprendre pourquoi la question du langage vous semble si importante dans l'oppression des animaux non-humains. Vous parlez, par exemple, dans votre ouvrage de violence symbolique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce concept-là ?
Marie-Claude Marsolier : Alors, violence symbolique, c'est un concept qui a été développé par Pierre Bourdieu. Et pour lui, c'est une acception plus compliquée que l'acception dans laquelle je l'utilise, parce que, par violence symbolique, Bourdieu, il désignait à la fois les violences symboliques dans le cadre du sexisme ou du racisme. Donc, il y a les dominants qui profèrent des paroles, qui utilisent des expressions. À la fois, ils expriment leur domination, et les dominés qui entendent ces paroles, d'abord, se sentent infériorisés, donc, se sont blessés par ces paroles, et ils intériorisent cette infériorisation.
Victor Duran-Le Peuch : La hiérarchie imposée par les dominants, en fait, c'est ça ?
Marie-Claude Marsolier : Voilà. Mais qui, en plus de subir cette dévalorisation, vont l'intérioriser, et donc, ça marche dans les deux sens. Quand on parle des violences, donc, parler de violences symboliques vis-à-vis des animaux non humains, évidemment, ça peut aller que dans un sens, c'est-à-dire, c'est les dominants qui, avec ces arrangements de langage, légitiment leur oppression. Mais évidemment, les animaux non humains ne peuvent pas comprendre le sens de ces paroles, et ne peuvent pas intérioriser de cette manière et légitimer cette domination. Mais, cela dit, ce terme de violence symbolique me semble important, parce que c'est une évidence que la violence n'est pas que physique, elle se double d'une idéologie, de ces violences symboliques, qui, en fait, la légitiment. Et on ne peut pas exercer, enfin, c'est très difficile pour les humains d'exercer des violences physiques, s'il n'y a pas une légitimation, une idéologie derrière, et cette idéologie, elle est promue par des comportements, mais elle est aussi promue par du langage.
Victor Duran-Le Peuch : Justement, alors, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que, finalement, c'est si grave que le langage soit misothère ou spéciste ? Est-ce que ça a vraiment un impact sur la situation des animaux ? Et est-ce que, vraiment, le combat est là ? Je veux dire, quand les violences exercées sur les non humains sont bien réelles et atroces, par comparaison, ça semble, au moins un peu, relativiser l'importance de la violence qui ne serait que verbale.
Marie-Claude Marsolier : C'est vrai, hein, on peut penser ça. Mais, en fait, comme je disais, je pense que le langage participe à la légitimation de la violence physique. En fait, c'est tout un ensemble de choses implicites qui sont d'autant plus fortes qu'en général, elles ne sont pas conscientisées. Donc, il y avait Catherine Kerbrat-Orecchioni qui avait bien parlé de ça. Elle a écrit un livre qui s'appelle « L'implicite ». Et il ne faut pas négliger du tout que, dans notre langage, il y a à la fois... On peut dire les choses de manière explicite par des discours. Par exemple, effectivement, on peut dire que les non humains sont des êtres stupides et méchants et malfaisants et nuisibles. On peut le dire comme ça. Mais bon, quand c'est exprimé de manière aussi explicite, ça ouvre la porte à des controverses. C'est-à-dire que les gens peuvent dire « t'es bien sûr de ce que tu racontes ? Pourquoi malfaisant ? » Tandis que quand on a des façons de parler, des jeux de mots, des comparaisons, ces expressions ne sont pas données comme l'objet principal du message et donc passent inaperçues. Mais inconsciemment, elles ne peuvent que renforcer sous la forme d'un rabattage, notre idéologie inconsciente que les animaux non humains sont des êtres inférieurs et donc qu'on a tout loisir de les traiter exactement comme on le souhaite.
Victor Duran-Le Peuch : Donc, il faut changer le langage ?
Marie-Claude Marsolier : Donc, il faut changer le langage. En fait, les deux choses vont en même temps. Il faut changer de langage et de comportement. Il y a eu cet effort systématique qui a été fait dans la langue française qui est quand même aussi très misogyne, en particulier depuis le XVIIe, pour changer la langue. Et avec l'idée que ce changement aille, fonctionne de manière parallèle avec des changements de comportement. Et ça, je pense que c'est difficile à réfuter. Et donc, à partir de 1984, pour être très concret, le gouvernement français a commencé à mettre en place des commissions de langage pour féminiser la langue française et en particulier pour tout ce qui concernait les noms de fonctions et de postes et pour faire des propositions parce que dans les années 1980, on pouvait dire une coiffeuse comme on parlait d'un coiffeur une ouvrière comme on parlait d'un ouvrier une directrice d'école, ça allait bien mais on ne pouvait pas dire une directrice de cabinet. On ne pouvait pas dire une directrice de recherche. En fait, c'est tellement brillant de vérité en particulier pour ce terme de directrice d'école maternelle, ça, il n'y avait aucun problème mais directrice de recherche, tous les termes qui étaient valorisants n'étaient jamais mis au féminin et ça perdure jusqu'à aujourd'hui de manière assez surprenante. Même dans des milieux scientifiques qui sont censés avoir souvent une vision un peu critique en fait, il y a des femmes qui disent, moi je préfère qu'on m'appelle directeur de recherche, je trouve ça plus valorisant. Mais donc, il y a quand même le fait qu'aujourd'hui on peut dire une présidente de l'Assemblée nationale, une députée, une maire ou une mairesse. Les usages ne sont pas encore forcément complètement stabilisées mais au moins, il y a cette reconnaissance que ces fonctions peuvent être mises au féminin et donc ça légitime forcément la position des femmes qui occupent ces fonctions. Et donc pour les animaux non humains, c'est la même chose et c'est pour ça que je pense que c'est une bonne idée d'appliquer par exemple aux animaux non humains les termes dont on a parlé de « visage », de « figure », « d'accoucher », « d'être enceinte » et de « personne » aussi et de dire voilà « quelqu'un » ça peut être quand on dit « quelqu'un » ça ne dit pas c'est un humain c'est un, donc c'est un individu de la même manière qu'on parle d'un individu non humain on peut parler de un, de quelqu'un et je pense que c'est des voilà encore une fois, c'est des choses qui pour moi qui marchent de conserve et je pense c'est une évidence qu'il faut dans toutes les luttes contre les oppressions le langage est un enjeu majeur et le jour où en français on parlera plus de viande mais qu'on parlera de morceaux de cadavres ça voudra dire quelque chose de très significatif sur l'évolution de notre société.
Victor Duran-Le Peuch : c'est super, je prends ça comme conclusion. Est-ce que vous pourriez nous donner trois recommandations ?
Marie-Claude Marsolier : Ok alors en fait il y a pléthore de choses qui m'ont vraiment fait basculer dans la reconnaissance de ce que sont vraiment les autres animaux, dans le véganisme, dans la conscience de tous ces enjeux. Voilà donc j'en ai choisi trois mais c'est quand même extrêmement arbitraire et assez personnel peut-être. Donc le premier que j'ai choisi c'est un livre qui s'appelle « L'animal est-il une personne ? » d'Yves Christen et donc Yves Christen c'est un biologiste qui a écrit cette somme sur les animaux non humains en reprenant les tas de questions. La deuxième partie c'est « le vrai savoir des animaux » ou « le mythe de l'animalité comme absence » et ces chapitres c'est « Sans raison ? », « Sans vie sociale ? », « Sans émotions ? ». Et donc voilà et ça ça a été vraiment un déclic très important parce que encore une fois c'est un biologiste, donc il y a à peu près un millier de références primaires, c'est à dire qui font qui renvoient à des articles dans Nature, dans Science, des articles scientifiques. Et qui ont qui m'ont montré à quel point l'éthologie, la science du comportement chez des animaux non humains en particulier avait explosé ces trente dernières années. Un autre livre que j'ai adoré c'est « Zoopolis » de Sue Donaldson et Wim Kymlicka, donc c'est un livre donc c'est deux deux chercheurs canadiens, et c'est je pense vraiment le premier livre, et ça reste je pense vraiment la référence dans ce domaine, qui va expliquer concrètement ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait vivre de manière politique avec les animaux non humains et voilà et concrètement on arrête de les opprimer maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et le troisième livre que je recommanderais c'est le livre d'Axelle Playoust-Braure et d'Yves Bonnardel qui s'appelle « Solidarité Animale » et je pense qui a été écrit récemment et qui met je trouve parfaitement en perspective les relations entre spécisme, racisme sexisme qui explique très bien ce qu'est l'antispécisme qui illustre bien vraiment cette notion de convergence des luttes et la manière dont tous ces types d'oppression se ressemblent et pourquoi il faut, en luttant contre le spécisme, on lutte aussi contre le sexisme et contre le racisme.
Victor Duran-Le Peuch : Merci pour ces recommandations Marie-Claude Marsolier et surtout merci beaucoup d'être venue dans le podcast !
Marie-Claude Marsolier : Merci à vous Victor pour votre invitation !
Victor Duran-Le Peuch : On a parlé de plein plein de choses dans cet épisode, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et je suis surtout curieux de savoir ce que vous vous pensez de tout ça ! Alors écrivez-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux, et si ça vous plait likez, partagez, laissez des étoiles et des avis ça aide vraiment à faire connaître le podcast. On se retrouve lundi prochain pour une lecture Allez bisous !
Crédits
Comme un poisson dans l'eau est un podcast créé et animé par Victor Duran-Le Peuch. Charte graphique : Ivan Ocaña Générique : Synthwave Vibe par Meydän Musique : Winter's Call par Mattias Westlund
10 livres cités :
1984 George Orwell

Winston Smith, obscur tâcheron au ministère de la Vérité, réécrit le passé et envoie dûment dans le vide-mémoire les documents devenus obsolètes.
ISBN : 9782035971210 · publié le 10 novembre 2021
Description complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
Winston Smith, obscur tâcheron au ministère de la Vérité, réécrit le passé et envoie dûment dans le vide-mémoire les documents devenus obsolètes. Le Parti a toujours raison et aucun fait ne doit le contredire. Comment penser, aimer, savourer la beauté ou dire que deux et deux font quatre dans un État qui a pris le contrôle de la réalité, de votre mémoire, de votre langue même ? La meilleure dystopie du XXe siècle, dans une nouvelle traduction illustrée.
Cité dans 1 épisode(s) :L'animal est-il une personne ? Yves Christen
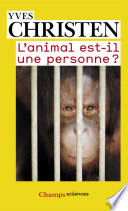
Longtemps nous avons considéré les animaux comme ceux que la nature avait privés des qualités que nous, les humains, possédons : l’aptitude à raisonner, apprendre, communiquer, s’adapter, décoder, transmettre, enseigner, ...
ISBN : 9782081278820 · publié le 11 octobre 2011
Description complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
Longtemps nous avons considéré les animaux comme ceux que la nature avait privés des qualités que nous, les humains, possédons : l’aptitude à raisonner, apprendre, communiquer, s’adapter, décoder, transmettre, enseigner, progresser... Les travaux scientifiques ont pulvérisé cette idée reçue et, depuis la dernière décennie, ils nous surprennent encore plus. Qui sont vraiment les animaux ? On les savait joueurs, blagueurs, rieurs, féroces parfois ; on les découvre tricheurs, menteurs, trompeurs, mais aussi aimants, mélancoliques ou encore émotifs, stratèges, sensibles aux intentions d’autrui, capables de respecter une morale ou d’élaborer une culture. La très grande ingéniosité des tests et l’extraordinaire diversité des observations scientifiques (éthologie, génétique, psychologie, zoologie, primatologie, neurosciences) nous révèlent les facettes de l’intelligence et de l’identité animales, et prouvent l’absurdité qu’il y a à réduire les compétences de la bête à la seule force de son instinct. Car en dépit des caractéristiques qui fondent l’homogénéité de son espèce, chaque animal est un individu à part entière, un être social unique, complexe, et par là même un sujet de droit. Des singes aux léopards, des éléphants aux antilopes, des baleines aux dauphins, l’auteur nous propose une approche de l’altérité qui apporte beaucoup au débat sur l’exploitation et la manipulation animales. Un plaidoyer fort documenté en faveur de la personne animale.
Cité dans 1 épisode(s) :Solidarité animale · Défaire la société spéciste Yves BONNARDEL, Axelle PLAYOUST-BRAURE
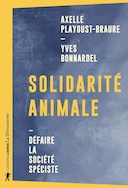
Proposant une synthèse claire et accessible, Axelle Playoust-Braure et Yves Bonnardel montrent en quoi le spécisme est une question sociale fondamentale et plaident en faveur d'un changement de civilisation proprement révolutionnaire.
ISBN : 9782348059278 · publié le 18 juin 2020
Description complète et liste des 4 épisode(s) qui le citent
Malgré la visibilité croissante de la " question animale ", la confusion règne parmi ses divers commentateurs. Les termes dans lesquels le débat est posé, y compris dans les milieux progressistes, empêchent d'en comprendre les enjeux véritables. C'est en particulier le cas pour la notion de " spécisme ", qui désigne une discrimination fondée sur le critère de l'espèce, et postule la supériorité des humains sur les autres animaux. Cette hiérarchisation des individus selon leur espèce a pourtant des effets très concrets : aujourd'hui, ce sont plus de 1 000 milliards d'animaux qui sont exploités et tués chaque année pour leur chair, parmi lesquels une vaste majorité d'animaux aquatiques. Comment est-il possible de continuer à justifier toutes ces souffrances et morts d'êtres pourvus de sensibilité ? Cet ouvrage, en dévoilant l'impasse théorique, éthique et politique dans laquelle nous enferme la société spéciste, clarifie les réflexions développées par le mouvement antispéciste en France. Proposant une synthèse claire et accessible, Axelle Playoust-Braure et Yves Bonnardel montrent en quoi le spécisme est une question sociale fondamentale et plaident en faveur d'un changement de civilisation proprement révolutionnaire.
Cité dans 4 épisode(s) :Le mépris des « bêtes » · Un lexique de la ségrégation animale Florence Burgat, Marie-Claude Marsolier

Comment les animaux non humains sont-ils représentés dans notre langage quotidien ?
ISBN : 9782130825500 · publié le 8 septembre 2020
Description complète et liste des 2 épisode(s) qui le citent
Comment les animaux non humains sont-ils représentés dans notre langage quotidien ? Cet ouvrage expose les mécanismes de ségrégation qui opposent humains et non-humains en regroupant ces derniers dans la catégorie négative des « animaux » ou des « bêtes », en leur refusant un visage, une personnalité, des sentiments, la possibilité de raisonner ou de vouloir. Il examine ensuite comment notre langue dévalorise les non-humains par les connotations péjoratives attachées aux termes qui leur sont associés. De nombreuses métaphores et expressions présentent les autres animaux comme des êtres essentiellement stupides, malfaisants, sales et obscènes ( « un porc », « un caractère de chien » ). D’autres mécanismes enfin permettent d’euphémiser, voire de nier les violences physiques dont ils sont victimes. Face à cette « misothérie » , ou mépris des animaux non-humains, incorporée dans notre langage, le sens critique et la rationalité restent nos meilleures ressources pour que cessent ces violences symboliques.
Cité dans 2 épisode(s) :Le sang et la chair · Les abattoirs du pays de l’Adour Noëlie Vialles

Cette récente séparation entre abattage et boucherie épargne à nos regards le geste fondateur du régime carné. Pourquoi donc faut-il verser le sang des bêtes pour pouvoir se nourrir de leur chair ?
ISBN : 9782735118199 · publié le 22 janvier 2016
Description complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
« Vous ne pourrez manger aucune bête crevée ». Notre société reste fidèle à l'interdit du Deutéronome et tue les animaux dont elle se nourrit. Mais tout procédé de mise à mort n'est pas accepté; il faut verser le sang pour pouvoir transformer le corps en substance consommable, en viande de « boucherie ». Or, de cette condition première du régime carné, nous ne voulons pourtant rien voir. Les sacrifices solennels, les célébrations festives, puis les tueries fonctionnant dans les villes ont fait place aujourd'hui à un abattage invisible, enclos dans des lieux appropriés, tenu à bonne distance. Cette récente séparation entre abattage et boucherie épargne à nos regards le geste fondateur du régime carné. Pourquoi donc faut-il verser le sang des bêtes pour pouvoir se nourrir de leur chair ? Et pourquoi cette nécessité offense-t-elle nos sensibilités, sans pourtant nous rendre végétariens ? En observant des abattoirs du sud-ouest de la France, Noélie Vialles, met en lumière l'existence d'un système complexe d'évitement et de dépassement du geste fatal. Son analyse montre comment les modalités de mise à mort et de préparation des animaux domestiques pour la consommation humaine mettent en jeu, bien au-delà de l'abattage, des représentations symboliques du sang, des hommes et des bêtes.
Cité dans 1 épisode(s) :Le silence des bêtes · La philosophie à l'épreuve de l'animalité Elisabeth de Fontenay
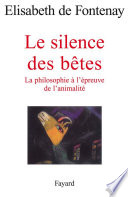
Elisabeth de Fontenay enseigne la philosophie à l'université de Paris-I. Elle a notamment publié les Figures juives de Marx (1973), Diderot ou le matérialisme enchanté (1981).
ISBN : 9782213638751 · publié le 1 avril 2014
Description complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
L'Antiquité fut en quelque sorte un âge d'or pour les bêtes. Car si les hommes offraient des animaux en sacrifice à Dieu, aux dieux, ils s'accordaient sur leur statut d'êtres animés et avaient pour elles de la considération. Certes, bien des questions demeuraient ouvertes, et les philosophes de ce temps ne manquèrent pas de s'entredéchirer en tentant d'y répondre. Les animaux pensent-ils ? Sont-ils doués de raison ? Ont-ils la même sensibilité que nous ? Faut-il s'interdire de les manger ? Mais pourquoi donc restent-ils silencieux ? Depuis que Dieu s'est fait homme, que le Christ s'est offert en sacrifice tel un agneau, c'est-à-dire depuis l'ère chrétienne, la condition de l'animal a radicalement changé. Désormais les philosophes se préoccupent surtout de verrouiller le propre de l'homme et de ressasser les traits qui le différencient des autres vivants, lesquels sont considérés comme des êtres négligeables : tenus pour des machines (Descartes) et à l'occasion comparés à des pommes de terre (Kant). Des hommes d'esprit et de coeur font bien sûr exception, au XVIIIe siècle surtout. A leur suite, Michelet dénoncera prophétiquement l'injustice faite aux animaux et annoncera que c'est compromettre la démocratie que de les persécuter. Au XXe siècle, une certaine littérature vient renforcer de nouveaux courants philosophiques pour rappeler que la manière dont nous regardons les bêtes n'est pas sans rapport avec la façon dont sont traités quelques-uns d'entre nous, ceux que l'on déshumanise par le racisme, ceux qui, du fait de l'infirmité, de la maladie, de la vieillesse, du trouble mental, ne sont pas conformes à l'idéal dominant de la conscience de soi. Ce livre expose avec clarté la façon dont les diverses traditions philosophiques occidentales, des Présocratiques à Derrida, ont abordé l'énigme de l'animalité, révélant par la même le regard que chacune d'elle porte sur l'humanité. C'est pourquoi on peut le lire aussi comme une autre histoire de la philosophie. Elisabeth de Fontenay enseigne la philosophie à l'université de Paris-I. Elle a notamment publié les Figures juives de Marx (1973), Diderot ou le matérialisme enchanté (1981).
Cité dans 1 épisode(s) :Le siècle des féminismes Eliane Gubin

Extrait de la couverture : "Le féminisme apparaît aujourd'hui comme un événement majeur, facteur d'une révolution sociale et culturelle sans précédent du XXe siècle.
ISBN : 9782708237292 · publié le 1 janvier 1970
Acheter sur Place des LibrairesDescription complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
Extrait de la couverture : "Le féminisme apparaît aujourd'hui comme un événement majeur, facteur d'une révolution sociale et culturelle sans précédent du XXe siècle. Pour la première fois dans l'histoire de l'Occident, les femmes se sont émancipées de la tutelle familiale et de leur incapacité juridique, ont acquis une indépendance économique, intellectuelle et sexuelle, et se sont imposées sur la scène publique et politique. Et pourtant, en ce début du XXIe siècle, le mouvement de libération des femmes semble à un tournant. En effet, il a pris une ampleur mondiale, fait partie intégrante des grands débats de société et resurgit là où on l'attendait le moins, notamment parmi les jeunes femmes de banlieue. ... Synthèse unique d'un siècle de combats des femmes, cet ouvrage n'a pas pour but d'entrer dans la polémique mais de l'éclairer par la précision du regard historique. Il offre au public le fruit de recherches internationales encore méconnues qui, depuis trente ans, ont défriché un nouveau champ de savoir. La pluralité des combats féministes y est retracée sans complaisance : de la lutte pour le droit de vote aux combats pour la dépénalisation de l'avortement et la libération sexuelle, en passant par le droit à l'éducation et au travail."
Cité dans 1 épisode(s) :L'implicite Catherine Kerbrat-Orecchioni

L'implicite, sa vie, son œuvre : sa genèse et ses effets pragmatiques ; comment les sujets parlants opèrent pour extraire de l'énoncé les contenus implicites, et comment ceux-ci opèrent sur les sujets parlants.
ISBN : 9782200218942 · publié le 1 janvier 1970
Acheter sur Place des LibrairesDescription complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
Pourquoi ne parle-t-on pas toujours directement, ce serait tellement plus simple ? Et corrélativement : pourquoi cherche-t-on à décrypter dans les énoncés d'autrui, au prix d'un surplus de " travail interprétatif ", ce qui s'y dit entre les lignes, ces sous-entendus et ces arrière-pensées qui en constituent en quelque sorte la partie immergée ? L'ouvrage tente de répondre à ces questions, en même temps que d'apporter quelque lumière dans le maquis terminologique fait de " présupposés ", de " sous-entendus ", d' " implications ", d' " insinuations ", d' " allusions ", de " valeurs illocutoires dérivées " et autres " tropes " - notions dont il propose une synthèse théorique nécessairement provisoire. L'implicite, sa vie, son œuvre : sa genèse et ses effets pragmatiques ; comment les sujets parlants opèrent pour extraire de l'énoncé les contenus implicites, et comment ceux-ci opèrent sur les sujets parlants. A ce titre, cet ouvrage s'adresse non seulement aux spécialistes de linguistique, mais aussi à tous ceux qu'intéresse le fait que les discours agissent (discours littéraire ou " ordinaire ", politique ou publicitaire), et qu'ils agissent en grande part, subrepticement mais efficacement, grâce à ces " passagers clandestins " que sont, dans les messages, les contenus implicites.
Cité dans 1 épisode(s) :Le Fondement De La Morale · Introduction Naturelle à la Philosophie de Schopenhauer - Édition Originale Annotée Arthur Schopenhauer
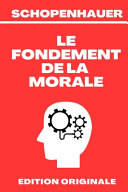
Le fondement de la morale développe en détail l'éthique de Schopenhauer et constitue l'introduction la plus naturelle à sa philosophie.
ISBN : 9798588782210 · publié le 31 décembre 2020
Description complète et liste des 1 épisode(s) qui le citent
Le fondement de la morale développe en détail l'éthique de Schopenhauer et constitue l'introduction la plus naturelle à sa philosophie. Extrait des notes du traducteur, Auguste Burdeau: " Le mémoire de Schopenhauer sur le Fondement de la Morale est de 1840: il fut écrit en vue d'un concours ouvert par la Société Royale du Danemark. L'auteur avait alors cinquante-deux ans; depuis vingt et un ans, il avait fait paraître son ouvrage capital: Le Monde comme volonté et comme objet de représentation. Ce n'est d'ordinaire ni à cet âge ni après de pareils livres, qu'un philosophe commence à prendre part aux concours: mais Schopenhauer alors n'avait plus d'autre moyen de se faire connaître. Son grand ouvrage n'avait point été lu: la première édition n'en était pas encore épuisée (la 2e est de 1844). Or l'auteur n'était pas de ces philosophes de vieille race, comme aurait dit Leibniz, à qui il importe peu de faire du bruit dans le monde, et qui estiment plus un seul disciple, mais digne d'eux, qu'une foule de lecteurs. Son système même, dirigé tout entier vers la pratique, et qui pour se réaliser a besoin du consentement de l'univers entier, légitimait à ses yeux son désir de popularité. Aussi pour la conquérir, jamais il ne négligea rien ". Note: édition originale optimisée pour une lecture agréable avec texte aéré et annotations.
Cité dans 1 épisode(s) :Zoopolis · Une théorie politique des droits des animaux Sue Donaldson, Will Kymlicka
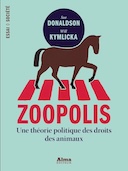
"Les auteurs recadrent le débat sur la responsabilité des humains à l'égard des animaux dans le domaine de la théorie politique.
ISBN : 9782362792052 · publié le 13 octobre 2016
Acheter sur Place des LibrairesDescription complète et liste des 4 épisode(s) qui le citent
En matière de droit des animaux les théories classiques visent à protéger les animaux contre les violences qu'ils peuvent subir et érigent une barrière protectrice autour d'eux. Or, une telle approche ne donne aucun résultat pratique significatif. Raison pour laquelle Will Kymlicka et Sue Donaldson se focalisent non sur les droits des animaux mais sur nos obligations concrètes à leur égard. Ce qui suppose que l'on examine nos relations avec eux. Ils proposent trois catégories d'animaux : domestique, sauvages et liminaire. Et pour chacune, trois modèles de vivre ensemble : la citoyenneté, la souveraineté, le statut de résident. Pour ce faire, ils s'appuient sur des travaux concernant les personnes en situation de handicap et la manière dont on peut les sortir de l'invisibilité sociale et politique. Aujourd'hui les théories de la justice intègrent enfin la notion de vulnérabilité reléguant par là même l'idée de citoyens de seconde zone. Cette reconnaissance, à la fois morale et politique, d'individus vulnérables, les auteurs de Zoopolis suggèrent de l'appliquer aux animaux.
Cité dans 4 épisode(s) :3 autres références :
- Concept de ‘violence symbolique’ de Pierre Bourdieu (wikipedia)
- « Mais à quoi sert le clitoris des rats ? » dans Sexe et genre (2019) - Priscille Touraille (recherche)
- Site internet de la campagne 'naturellement flexitariens' financée par Interbev (l’Association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes, le principal lobby de la viande en France) (www.naturellement-flexitariens.fr)
 Comme un poisson dans l’eau
Comme un poisson dans l’eau