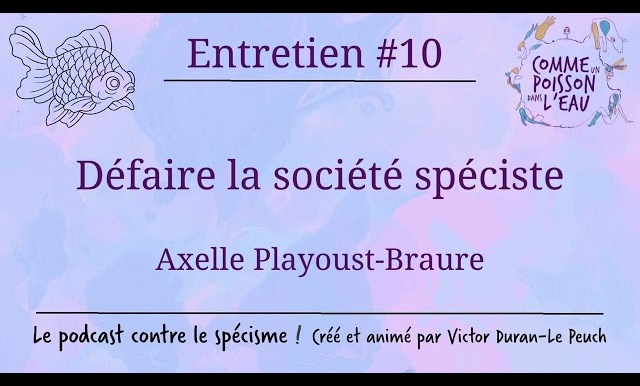Description
Axelle Playoust-Braure prolonge les réflexions de la première partie de l'entretien sur sa conception matérialiste du spécisme, vu comme une organisation sociale oppressive, dont l'élevage est une des institutions principales. Elle analyse à la suite du travail de la féministe matérialiste Colette Guillaumin l'élevage comme se situant dans la continuité des rapports d'appropriation des corps, tout comme l'esclavage, le servage et le sexage (néologisme forgé par Colette Guillaumin justement). Elle décrit aussi le publispécisme, c'est-à-dire le spécisme contenu dans les publicités, qui présentent les animaux comme étant déjà de la viande, c'est-à-dire seulement de la chair sur patte, et surtout qui fait disparaître l'individu qui était derrière la viande (Carol J. Adams parle à cet effet de "référent absent"). Les procédés de déformation de la réalité par la publicité atteignent leur paroxysme dans la 'suicide food' qui présente les animaux comme consentants et heureux de se faire manger, se découpant ou se servant eux-mêmes aux humains, mécanisme qui est fortement similaire à la présentation des femmes par les publicités sexistes comme étant des corps disponibles et consentants par défaut. Pour finir, Axelle Playoust-Braure propose quelques pistes pour parvenir à "défaire la société spéciste", et même pour aller au-delà de la seule abolition du spécisme.
Transcription
Voir la transcription
Victor Duran-Le Peuch : Salut, moi c'est Victor Duran-Le Peuch, et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l'eau, le podcast contre le spécisme.
Axelle Playoust Braure : Parler d'animalisation des animaux, c'est dénaturaliser leur oppression. C'est rappeler que celle-ci est politique, organisée, qu'elle ne s'inscrit pas de toute éternité dans un ordre du monde, et qu'elle peut avoir une fin. Il s'agit de voir l'humanité et l'animalité non pas comme des catégories biologiques, mais comme des catégories sociales. Sujet, objet. Personne, chose. Supérieur, inférieur. La notion d'animalisation, tout comme celle de différenciation, d'infériorisation ou d'appropriation, a donc l'avantage de mettre l'accent sur un processus, un rapport social, à la fois matériel et idéologique. Matériel, parce que dans le cas des animaux d'élevage, l'animalisation passe par le contrôle physique, l'enfermement, le marquage des corps, l'appropriation, la violence et le meurtre. Idéologiquement, parce que l'animalisation tente de se justifier par des croyances et des discours. Celui de l'infériorité des animalisés, par exemple.
Victor Duran-Le Peuch : Ça, c'était un extrait du livre « Solidarité animale » qu'Axelle Playoust-Braure a co-écrit avec Yves Bonnardel, histoire de vous donner envie de le lire. Et ça fait une piqûre de rappel sur les choses dont on a parlé dans la première partie de l'entretien. Allez écouter, si ce n'est pas encore fait. Les deux éléments super importants qu'il faut retenir de la première partie, sont le passage, dans la définition du spécisme, de l'espèce comme catégorie purement biologique à l'espèce comme catégorie sociale qui permet d'enrichir cette définition. Et second point à retenir, l'application de la grille matérialiste qui revient à analyser les structures matérielles de l'oppression. Oppression conçue comme la domination d'une classe d'individus sur une autre, avec donc des intérêts antagonistes. Et l'analyse matérialiste nous pousse à analyser les réseaux d'acteurs et les institutions d'acteurs, l'oppression, qui produisent notamment une idéologie pour légitimer l'ordre établi et faire en sorte que rien ne change. Bon j'ai conscience que tout ça peut paraître un peu abstrait, mais il faut voir que tout cela renvoie à des éléments extrêmement concrets, et que l'oppression spéciste désigne en fait des réalités observables, qui s'inscrivent dans les corps, dans la chair. Et c'est là qu'on voit que le spécisme n'est pas qu'une idéologie, car c'est avant tout des pratiques violentes d'appropriation des corps. C'est comme ça qu'Axelle Playoust-Braure analyse, dans son mémoire de master en sociologie, l'élevage en tant qu'institution de l'oppression spéciste.
Axelle Playoust Braure : Tout à l'heure je parlais du complexe animalo-industriel, et en fait c'est intéressant de regarder qui organise l'exploitation animale, à quel niveau. Donc moi ce que je trouve intéressant au niveau de l'élevage, je me suis surtout intéressée à l'élevage, c'est tout le réseau d'acteurs qui se met en place, alors surtout pour l'élevage intensif, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, avec la zootechnie, la pharmacologie, la génétique, tout ce qui est mis en place pour optimiser la production de viande, de lait, d'œufs, etc... pour optimiser les corps des animaux, pour les animaliser encore plus, pour les rendre encore plus à notre service. Et en fait l'optimisation, très concrètement, c'est l'optimisation du ratio de conversion alimentaire entre la nourriture qu'on donne aux animaux, qu'on appelle « feed » en anglais, et les produits qu'on obtient à la fin, c'est-à-dire « food » en anglais. Et plus le ratio « feed-food » est optimisé, plus ça fait des économies pour l'industrie de l'élevage, et plus on rentre dans un schéma intensif. Et puis, depuis 50 ans, mais surtout en fait depuis les années 2000, on a l'essor de l'aquaculture. Ça c'est aussi un truc à ne pas négliger, parce que l'immense majorité des animaux exploités à des fins de consommation alimentaire sont des animaux aquatiques, et c'est très intéressant de voir la façon dont l'industrie aquacole se développe. Enfin, c'est une industrie qui connaît un essor phénoménal, et qui cherche toujours plus à mettre en élevage de nouveaux animaux. Donc là, en ce moment, il y a tout un combat contre les élevages de poulpes, qui jusqu'ici été pêchés mais n'ont jamais fait l'objet d'élevage. Et donc, voilà, s'intéresser concrètement, pas seulement à l'idéologie spéciste, mais en fait historiquement, concrètement, politiquement, économiquement, comment s'organise le système spéciste, quelles sont ses priorités du moment, quelles sont ses faiblesses, etc... Et puis aussi voir les sources de financement du spécisme. Est-ce que c'est un soutien public à travers des subventions ? Est-ce que c'est des fonds d'investissement ? Qui finance l'exploitation animale ? C'est toutes des questions à se poser pour dresser un portrait le plus fidèle possible du spécisme tel qu'il est réellement.
Victor Duran-Le Peuch : On voit bien avec vos exemples en quoi consiste la matérialité du système spéciste. C'est des acteurs, des institutions, des financeurs, des industries, etc. Et vous décrivez aussi certains processus qui participent à l'élevage comme appropriation des corps. Vous parlez notamment de « viandisation » des corps animaux. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est ?
Axelle Playoust Braure : Alors, la notion d'appropriation me vient directement du travail de Colette Guillaumin. En fait, Colette Guillaumin a voulu décrire, comprendre les rapports homme-femme dans une optique matérialiste. Et en fait, elle s'est dit que les rapports hommes-femmes, ce n'était pas seulement l'exploitation de la force de travail, ce n'était pas seulement du travail non payé dans le cadre domestique, mais qu'il y avait autre chose. C'était une exploitation d'une autre nature. Elle a parlé d'appropriation. Et en fait, elle a décrit les rapports sociaux homme-femme comme étant des rapports de sexage qu'elle place dans la lignée d'esclavage et de servage qui sont, eux aussi, des rapports d'appropriation physique directe des corps qui ne sont pas seulement l'exploitation de la force de travail, mais qui vont plus loin. Il y a vraiment une appropriation des corps, une mainmise sur le corps où le corps est vu pas seulement comme un objet, c'est vu comme un outil qu’on va pouvoir utiliser pour atteindre nos objectifs. Et du coup, moi, je considère que l'élevage se situe dans la continuité des rapports d'appropriation théorisés par Colette Guillaumin, donc esclavage, servage, sexage, élevage, et que dans le cadre de l'élevage, les animaux sont avant tout conçus comme des corps et des corps qui sont là pour produire de la viande ou des œufs ou du lait. Et c'est en ça qu'avec l'optimisation de leur corps à un niveau extrêmement profond, puisque génétiquement, ils sont conçus pour grossir plus vite, pour produire plus de porcelets, pour produire plus de litres de lait par jour, etc. Il y a vraiment une construction des corps, en fait, qui est là pour servir les intérêts de la classe humaine, notamment l'intérêt au niveau de l'alimentation et des profits qu'on peut se faire à ce niveau-là.
Victor Duran-Le Peuch : C'est assez évident, d'ailleurs, même dans le vocabulaire utilitaire, parce qu'on va désigner les animaux par rapport à la fonction qu'on leur attribue dans l'alimentation. Donc, on va parler de poulet de chair ou de poule pondeuse ou de vache laitière. (Ouais.) Je trouve que c'est très... On voit vraiment l'inscription dans les corps.
Axelle Playoust Braure : Ouais, exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la publicité, où en fait, la publicité, c'est intéressant à analyser parce que c'est un peu la concentration de l'idéologie spéciste.
Victor Duran-Le Peuch : Oui. Alors, justement, dans votre mémoire, la troisième, la dernière partie, vous faites une analyse de contenu en prenant le cas des publicités spécistes. Et vous avez d'ailleurs proposé un terme pour le décrire, c'est le publispécisme, c'est ça ?
Axelle Playoust Braure : Oui, publispécisme, qui est un terme qui vient directement, qui est dérivé de publisexisme.
Victor Duran-Le Peuch : Et du coup, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de comment vous avez analysé ces publicités, justement, et qu'est-ce que vous y avez trouvé ?
Axelle Playoust Braure : Alors, en fait, moi, je me suis intéressée très tôt à la publicité spéciste parce qu'avant même de découvrir la cause animale, j'étais engagée dans des mouvements anti-pub, et notamment dans l'association RAP, Résistance à l'Agression Publicitaire. Et donc, quand j'ai découvert la question animale, assez naturellement, je me suis intéressée à la publicité pour les produits d'origine animale. Et à cette époque, donc en 2015, j'ai notamment lancé une page sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Je suis une pub spéciste » qui prenait des publicités pour des produits d'origine animale, pour le lait, la viande, etc... et qui essayait d'analyser la façon dont les animaux sont représentés. Quel genre de discours est véhiculé ? Est-ce que c'est une ambiance consensuelle ? Est-ce qu'il y a une juste représentation de l'élevage, de l'abattage ? Non. (spoiler !) En tout cas, il y a tout un matraquage, un matraquage publicitaire qui est considérable et qui a pour effet de diffuser, l'idéologie carniste. L'idéologie carniste, c'est cette idée que la consommation de produits animaux est naturelle, normale, nécessaire. C'est Melanie Joy qui a théorisé ce terme-là. Et puis aussi que la consommation, pour ajouter un quatrième N, que c'est « nice », que c'est sympa, que c'est agréable, que c'est délicieux, que c'est super, etc... Et du coup, voilà, le publispécisme, il diffuse et il renforce l'idéologie carniste. Et, il y a aussi une fabrique de l'ignorance autour de ce que c'est l'élevage. Par exemple, dans les publicités pour les produits d'origine animale, il ne va jamais y avoir de représentation des centres d'insémination. Très peu de gens savent que les centres d'insémination jouent un rôle crucial dans le circuit de production d'animaux d'élevage et de viande. Il y a très peu de représentation, voire aucune représentation de l'abattage, évidemment, alors qu'il n'y a pas de viande sans abattage d'animaux. Et donc, en fait, il y a une sélection de certaines étapes. En fait, ce n'est même pas présenté comme des étapes. En fait, dans la publicité pour les produits d'origine animale, la viande, elle est produite ex nihilo, elle tombe du ciel, elle est là, elle est délicieuse, elle est fraîche, elle est appétante, elle est disponible pour notre consommation. Et soit les animaux sont totalement absents des représentations, donc c'est ce que Carol Adams appelle le « référent absent », c'est-à-dire le référent principal de la viande qui devrait être l'animal vivant, sentient, il est totalement absent. Il y a une déconnexion entre le produit et l'individu qui fait que ça permet de ne pas créer de dissonance cognitive sur le fait que oui, pour obtenir de la viande, on a dû tuer un individu. Donc, soit dans la publicité, les animaux sont totalement absents, soit parfois ils sont présents, mais à ce moment-là, ils vont jouer un rôle actif dans leur propre viandisation.
Victor Duran-Le Peuch : Alors ça, c'est incroyable. Vous décrivez quelque chose qui s'appelle la « suicide food » et c'est vraiment très étonnant, quand on commence à l'analyser, et presque perturbant. En fait, la suicide food, c'est l'animal qui est présenté comme étant consentant à sa propre consommation par les humains.
Axelle Playoust Braure : Oui, c'est extrêmement perturbant. C'est des animaux qui sont tous au rire avec un couteau, où ils se découpent en tranches eux-mêmes. Ils sont dans des poses aguicheuses. En fait, ils se vendent. Ils sont consentants à leur consommation. C'est leur rôle, leur destinée. Et ils prennent plaisir à accomplir cette destinée. Et c'est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment le fantasme carniste le plus abouti. C'est vraiment une mise en scène décomplexée de ce qu'on voudrait que les animaux soient, c'est-à-dire qu'ils remplissent leur rôle qu'on leur a assigné. Et ça, c'est intéressant parce que dans la suicide food, je disais qu'il y avait des représentations d'animaux aguicheurs. En fait, il y a un mix que j'ai appelé le carnosexisme, un mix entre des représentations d'animaux sexualisés, et aussi des femmes animalisées. En fait, il y a un mélange des genres entre les femmes et les animalisées considérées comme des corps consommables, des corps qui sont là pour satisfaire le plaisir gustatif ou le plaisir sexuel. Et en fait, en tout cas, ce sont des corps disponibles, des corps qu'on peut s'approprier, qui sont là pour être saisis, dont on va se régaler. Donc évidemment, là, on a le « male gaze », on a le regard humain et mâle qui, en fait, produit des représentations de suicide food, des femmes, des animaux qui veulent être consommées, violées, tout ce que vous voulez. En fait, je trouve qu'il y a un parallèle assez intéressant entre la culture du viol et la culture carniste et la suicide food, où en fait, on a ce truc-là de discours qui légitime l'appropriation des corps, avec tout un tas d'idées sur le fait que les femmes sont d'emblée consentantes, le fait que les animaux participent d'eux-mêmes à leur propre consommation. Donc effectivement, c'est des contenus assez perturbants et on peut en avoir des exemples sur la page « Je suis une pub spéciste », mais aussi sur le site de CaroleAdams, où elle a fait tout un PowerPoint, en fait, avec plein d'images comme ça.
Victor Duran-Le Peuch : Mais d'ailleurs, je mettrai aussi en description le lien vers votre mémoire, où on peut voir à la fin justement tous les contenus publicitaires que vous avez analysés et que le plus souvent, vous catégorisez justement selon le type de processus et de procédé qui est utilisé.
Et une des choses que la suicide food efface, et en fait, même occulte en l'occurrence, c'est la résistance. C'est la résistance des animaux quand on les mène à l'abattoir. Moi, je me souviens que j'avais été très marqué, à titre personnel, par une vidéo de Earthling Ed, qui est un YouTuber végan qui montrait une vache qui s'enfuyait et qui faisait tout pour ne pas être tué. Et c'est vraiment une chose que la publicité et le carnisme en général font tout pour nous faire oublier : les animaux n'ont pas envie de mourir.
Axelle Playoust Braure : Ça, c'est très très important. En fait, dans la publicité, l'objectif, c'est de mettre en place une ambiance où il n'y a pas de friction, où il n'y a pas de résistance animale. C'est consensuel. Il y a une ambiance hédoniste autour du plaisir, de la satisfaction, on passe des bons moments, la famille, prendre soin de soi, tout ça. C'est vraiment une rhétorique qui est à mille lieues de la réalité des produits qui sont mis en scène. L'occultation à la fois des mécanismes de l'élevage, de la viandisation des animaux, mais aussi de la résistance animale, c'est quelque chose de très très intéressant.
Victor Duran-Le Peuch : Un autre procédé que vous analysez, c'est une désindividualisation des animaux, qui sont pris comme une masse ou comme déjà un ingrédient. On parle du poulet, par exemple.
Axelle Playoust Braure : Oui, en fait, les animaux sont toujours déjà de la viande, dans la publicité. C'est qu'ils n'ont pas d'existence avant leur transformation en viande, ou alors c'est juste un état transitoire, mais l'objectif, leur réelle condition, leur destinée, c'est le produit de consommation. Et c'est en ça qu'il y a une forme de désindividualisation et de déni de l'existence d'un individu qui résiste. C'est lié aussi au déni de la résistance animale. C'est qu'en fait, leur seule existence valable, leur but, c'est d'être viande. Et je trouve ça très intéressant de faire le parallèle avec les conditions concrètes d'existence des animaux dans le cadre de l'élevage. Moi, j'ai été très marquée aussi par des vidéos d'élevage de poulets de chair, où en fait, il faut savoir que les poulets de chair, ce sont des souches génétiques qui ont été optimisées pour ça, contrairement aux poules dites pondeuses, où elles ont été optimisées pour la production d'œufs. En fait, les poulets de chair, ils grossissent 4 fois plus vite qu'il y a 50 ans. Et en fait, ils atteignent leur poids dit d'abattage en à peu près un mois, en un peu plus d'un mois. Et en fait, il y a des vidéos comme ça qui montrent les élevages de poulets de chair au bout d'à peu près un mois, où en fait, les animaux ne peuvent plus marcher. Déjà, il y en a plein qui sont déjà morts, parce qu'ils ont succombé à leurs conditions de survie. Et en fait, on voit des poulets de chair, c'est encore des bébés...
Victor Duran-Le Peuch : Oui, ils ont des corps hypertrophiés avec des têtes de poussins et des petites pattes qui s'effondrent sous le poids de leur propre corps.
Axelle Playoust Braure : C'est ça, c'est les muscles qui prennent toute la place parce qu'on veut que... On a voulu d'eux que ce soit des muscles destinés à la consommation et en fait, l'individu, c'est presque une gêne pour l'objectif qu'on a pour eux. Et en fait, quand on regarde ces poulets-là, ils sont pas encore morts, mais ils ressemblent déjà à des poulets rôtis, en fait. Ce sont des poulets rôtis pas encore morts. C'est ce truc trop bizarre où en fait, on les a tellement objectifiés qu'ils ont beau être encore vivants, ils ont beau résister, ils ont beau être quand même des individus, malgré tout, et ben en fait, ils ressemblent déjà à des objets de consommation. Ce sont déjà, en puissance, ce sont toujours des biens de consommation. En fait, l'appropriation des animaux a atteint un stade, je pense... Il n’y a pas d'équivalent en termes d'appropriation et de transformation des corps et d'utilisation des corps. On atteint un truc extrême, quoi.
Victor Duran-Le Peuch : Ouais. Et le choix d'analyser la publicité à la suite de la reformulation théorique que vous menez de matérialisme, enfin de définition de matérialisme du spécisme, est-ce que ça en découle directement ? Est-ce que la publicité est une des institutions en fait, qu'il faudrait pouvoir décrire de façon très précise, qui véhicule l'oppression spéciste ?
Axelle Playoust Braure : Oui, alors je pense qu'il faut voir la publicité comme un outil au service de l'institution de l'élevage et de l'exploitation animale. Ça vaut le coup de voir les financements exorbitants qui sont mis là-dedans. Ça vaut le coup d'analyser l'évolution des discours mobilisés par la pub, parce que il y a aussi le néocarnisme qui a été conceptualisé aussi par Melanie Joy, qui est que face à toutes les critiques qui sont émises envers l'industrie de l'élevage et notamment l'élevage industriel, il y a un renouvellement des discours de la part de l'élevage pour pouvoir perdurer dans le temps et se relégitimer, qui est les petits élevages, la viande bio locale, l'élevage familial, l'absence d'antibiotiques, le plein air, etc... Donc il faut aussi, c'est intéressant de voir que la façon dont les contenus publicitaires évoluent sont parfois une réponse directe aux mobilisations de contestation de l'exploitation animale. Et concrètement aussi, il y a une régie de contrôle des contenus publicitaires qui sont parfois mobilisés par les mouvements féministes. Parce qu'évidemment, le publisexisme et la façon dont les femmes sont représentées dans la pub, il y a énormément de choses à dire. Et donc il y a des groupes féministes, des associations qui portent plainte contre certaines publicités, parce que ça porte atteinte à l'image des femmes, etc. Ça véhicule la culture du viol, machin. Et qui obtiennent parfois gain de cause, où des publicités sont retirées, il y a des amendes qui doivent être payées, etc. Et je pense qu'il y aurait quelque chose à faire à ce niveau-là sur certaines publicités qui sont mensongères, qui sont trompeuses, qui sont tout ce que vous voulez à propos de ce que c'est réellement l'élevage.
Victor Duran-Le Peuch : C'est très intéressant parce que ce que vous dites sur le néocarnisme, ça rejoint exactement ce que vous disiez au début de l'entretien sur le fait que même quand l'idéologie est contestée, tant que les institutions et les acteurs de l'oppression restent, en fait il y a une nouvelle production d'une nouvelle idéologie, et l'idéologie peut simplement se renouveler, utiliser de nouveaux arguments qui seront tout aussi faux, mais qui seront différents, et qui passeront inaperçus pendant un moment jusqu'à être contestés de nouveau. Et c'est un cycle sans fin, en fait. Tant qu'on ne s'est pas attaqué aux structures de l’oppression.
Axelle Playoust Braure : C'est ça, en fait, l'idéologie ne s'embarrasse pas de de logique, de rationalité, c'est pas son rôle, c'est pas son but, c'est pas son but d'être logique. Son but c'est de convaincre les esprits, c'est de verrouiller un ordre social, c'est que les gens soient équipés d'une palette d'arguments bidons pour pouvoir ne pas remettre en question leurs habitudes et l'ordre du monde. Et c'est ça qu'il y a parfois de déstabilisant, c'est que des individus qui sont par ailleurs très intelligents, très rationnels, etc... peuvent, sur certaines questions où ils ont un intérêt à ne pas changer, mobiliser des arguments complètement farfelus, complètement bidons, qui d'ailleurs sont les mêmes que plein d'autres gens dans la population, pourtant c'est des gens qui se sont pas...
Victor Duran-Le Peuch : Mais tous les mêmes, c'est ça qui est vraiment étonnant, en fait, c'est que c'est toujours les mêmes arguments, c'est les dix mêmes arguments qui tournent en boucle et qui sont débunkés en permanence, mais qui reviennent. Et c'est justement ça, en fait, c'est une idéologie qui est parfois inconsciente et dont les personnes n'ont pas conscience, de revéhiculer, que les personnes n'ont pas conscience de revéhiculer à chaque fois qu'ils présentent une objection qu'ils pensent originale, mais qui est juste très banale, en fait.
Axelle Playoust Braure : C'est ça. Et tous ces gens-là ne se sont pas concertés pour avoir les mêmes arguments, c'est vraiment une production sociale, idéologique, qui dépasse les raisonnements que les gens peuvent faire dans leur for intérieur. Et c'est pour ça aussi, pour revenir à la définition du spécisme en tant que discrimination arbitraire injuste, c'est qu'on aura beau avoir des arguments logiques sur le fait que le critère de l'espèce est arbitraire parce que si, parce que ça, c'est intéressant d'avoir les raisonnements solides, mais en vrai, ça ne va pas être opérant politiquement, de dire que le spécisme est injuste et que le critère de l'espèce est illogique par rapport à ce qu'il est censé justifier. Oui, c'est très important de le savoir, mais en fait, on aura beau avoir raison sur les faits, ça ne suffira pas pour lutter efficacement contre une organisation sociale totalement sédimentée, verrouillée par des intérêts, par des lobbys, par des gens qui mettent toute leur énergie et tout leur argent pour que rien ne change. Et c'est ça aussi où il faut avoir un peu de... Il faut voir large, il faut avoir une grosse ambition, il faut voir loin, en fait, quand on est antispéciste, et il faut s'organiser à la hauteur des enjeux pour réellement avoir un impact pour diminuer le nombre d'animaux tués, pour freiner le développement de l'aquaculture, par exemple. Là, actuellement, on a l'industrie de l'élevage d'insectes qui se met en place. Comment on empêche ça de se développer ? Il faut se renseigner sur qui sont les acteurs, comment sont-ils financés ? À quel point la réglementation est en leur faveur ? Comment on peut les bloquer sur certains points pour qu'ils ne se développent pas aussi vite qu'ils le feraient sans nous ? Et à ce sujet, moi, je recommande vraiment les analyses issues de l'altruisme efficace, qui est un mouvement social assez récent qui utilise la démarche scientifique et la rationalité pour informer les stratégies des mouvements sociaux et pour faire en sorte que l'allocation de nos ressources, qui sont des ressources limitées, eh bien l'allocation des ressources entre différentes stratégies optimise les résultats et l'impact positif qu'on peut avoir sur le monde et augmente l'efficacité de nos luttes politiques.
Victor Duran-Le Peuch : Vous avez parlé de l'énorme ampleur de l'enjeu et vous parlez parfois de changements civilisationnels et votre ouvrage s'appelle, que vous avez co-écrit avec Yves Bonnardel, « Solidarité animale », mais a pour sous-titre « Défaire la société spéciste ». Donc j'aimerais peut-être finir sur cette question : qu'est-ce que ça implique concrètement de défaire la société spéciste ? Vous avez donné des pistes peut-être que vous en avez d'autres et surtout pour créer quoi à la place si on défait la société spéciste ?
Axelle Playoust Braure : Alors défaire la société spéciste, le mot important là-dedans c'est « société », ça fait référence à tout ce que j'ai expliqué, c'est de considérer le spécisme comme vraiment une organisation sociale, un système. Et quand on perçoit le spécisme de cette façon-là, je pense que les priorités ce sont tout ce qui est démantèlement des institutions spécistes, élevage, pêche, expérimentation animale, corrida, etc... chasse, machin. C'est l'abolition du statut de propriété des animaux. Il y a plein de juristes en droit animal qui réfléchissent à cette question, moi-même je ne suis pas juriste mais il y a je pense toute une réflexion sur le statut des animaux, quel statut, quelle personnification juridique leur accorder. Et puis défaire la société spéciste, c'est pas seulement une question d'abolition.
Victor Duran-Le Peuch : Ah oui justement vous avez écrit récemment un article pour la revue « Mouvement » qui s'intitule « Spécisme, abolir ne suffira pas » et dans lequel justement vous dites que l'abolition n'est pas suffisante, qu'il faut penser autre chose et que c'est pas dans un lointain futur c'est en fait dès maintenant.
Axelle Playoust Braure : En fait ce que je dis dans cet article « abolir ne suffira pas », c'est qu'il faut pas seulement voir les animaux comme des corps souffrants comme des individus envers qui on devrait avoir des devoirs simplement négatifs, c'est à dire ne pas les faire souffrir, ne pas les tuer ne pas les enfermer, ne pas, ne pas l'idée c'est pas seulement d'abolir leur exploitation mais c'est vraiment de leur donner une place à part entière au sein de nos sociétés qui sont déjà des sociétés inter-espèces on cohabite déjà avec des animaux, que ce soit des animaux domestiques dans nos foyers, des animaux même des animaux d'élevage, il y a une forme de cohabitation même si elle prend des formes d'exploitation. Il y a des animaux liminaires qui sont ni domestiques ni sauvages mais qui bénéficient de la présence humaine et des infrastructures humaines qui vivent dans nos villes, donc les pigeons, les rats les lapins, etc. Donc en fait, l'idée c'est pas seulement de ne pas faire souffrir les animaux. C'est de les inclure sérieusement et de prendre en compte leurs intérêts leurs préférences, leurs volontés, leurs désirs et d'incorporer toutes ces choses-là à leur sujet dans l'organisation sociale, dans les institutions. Par exemple réfléchir à leur épanouissement, le fait qu'ils puissent choisir leur lieu de vie, leurs activités, le droit à des soins de santé, le droit au déplacement sécurisé sans être menacé d'être écrasé etc... Donc c'est vraiment repenser la cité en prenant en compte le fait que il n'y a pas que des humains valides, adultes qui vivent dans la ville ou qui se déplacent dans le monde. Il y a tout un tas d'individus aux caractéristiques différentes et il faut aménager la société pour qu'elle soit inclusive pour le plus d'individus possible. Il y a un ouvrage classique en éthique animale qui s'appelle « Zoopolis » qui a été écrit par Will Kymlicka et Sue Donaldson en 2011 et qui a été traduit en 2016 en français, qui est une des premières tentatives de vraiment réfléchir à tous nos devoirs positifs envers les animaux et à la façon dont ils pourraient être inclus sérieusement dans les institutions et les aménagements du territoire par exemple.
Victor Duran-Le Peuch : Axelle Playoust-Braure, quelles sont vos trois recommandations pour les auditeurices?
Axelle Playoust Braure :
Alors, déjà moi je recommande vivement les livres de Joseph Andras qui est un auteur qui a écrit sur différentes luttes sociales. Par exemple la guerre d'Algérie, ou la Kanaky, la lutte d'indépendance de la Kanaky et il y a un petit livre qui est sorti l'année dernière si je ne me trompe pas, qui s'appelle « Ainsi nous leur faisons la guerre » qui est en fait un triptyque de trois courts récits d'histoires de résistance animale, de solidarité animale des humains envers les animalisés, et c'est vraiment magnifique, c'est très très bien écrit, j'ai trouvé ça bouleversant, et je recommande à tout le monde cette lecture. Et je recommande aussi de Joseph Andras le livre « De nos frères blessés » qui parle justement d'une figure de la résistance au colonialisme français en Algérie, Fernand Iveton, et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé bouleversant. Ensuite je recommande la newsletter Animatopie, qui est une newsletter hebdomadaire qui est vraiment très utile, parce que de façon condensée on a l'actualité du mouvement animaliste, que ça soit l'actualité des ONG, l'actualité des lois, l'actualité scientifique même au niveau de l'éthologie animale. Et puis chaque newsletter a un sujet, une thématique donc c'est toujours très intéressant, très sourcé, très utile. Et puis en dernière recommandation, je voudrais mettre l'accent sur le fait que les mouvements antispécistes n'ont pas le monopole du questionnement autour de l'animalité, de l'animalisation, et qu’il y a d’autres mouvements sociaux, notamment les mouvements antiracistes, les mouvements des personnes issues de l'immigration, des quartiers populaires, les personnes racisées, mobilisent ces concepts-là. Et il y a des productions théoriques très intéressantes, je renvoie par exemple au, « FUIQP » le Front Uni de l'Immigration et des Quartiers Populaires qui produit des luttes et des analyses très intéressantes, qui a été co-fondé par le sociologue Saïd Bouamama. Et puis je renvoie aussi au collectif « Justice et Vérité pour Adama » parce qu'en fait je suis de plus en plus convaincue que les mouvements animalistes et les animalistes ont tout intérêt à s'intéresser de façon désintéressée aux autres mouvements sociaux. Pas seulement dans une optique de convaincre les autres mouvements sociaux de rejoindre le mouvement antispéciste, pas seulement pour faire des parallèles entre les conditions des différentes groupes marginalisés, mais vraiment parce que ce sont des groupes qui produisent des analyses incroyables sur le monde social, et qui oeuvrent eux aussi vraiment pour une société débarrassée des rapports de pouvoir. Donc je recommande toutes ces ressources là.
Victor Duran-Le Peuch : Super, merci beaucoup je mettrai tout ça en description comme toujours et un énorme merci à Axelle Playoust-Braure d'être venue dans Comme un poisson dans l'eau
Axelle Playoust Braure : Merci à toi Victor
Victor Duran-Le Peuch : Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Malgré tout ce qu'a dit Axelle Playoust-Braure sur la publicité, s'il vous plaît, faites un maximum de pub pour Comme un poisson dans l'eau, histoire de donner des ressources et combattre notamment le publispécisme ! Quelqu'un m'a dit récemment que les épisodes du podcast sont comme des tracts sonores, plus écolo et plus faciles à distribuer que des tracts papier d'ailleurs. Je dis, ça je dis rien hein ! Allez, à lundi prochain, bisous !
Crédits
Comme un poisson dans l'eau est un podcast créé et animé par Victor Duran-Le Peuch. Charte graphique : Ivan Ocaña Générique : Synthwave Vibe par Meydän Musique : Fragments par Nomyn
4 livres cités :
Ainsi nous leur faisons la guerre Joseph Andras
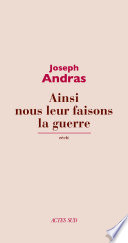
Un chien à Londres en 1903, un singe à Riverside en 1985, une vache et son veau à Charleville-Mézières en 2014 sont les protagonistes de cette fresque en trois panneaux qui évoque les rapports entre animaux et humains à l’ère ...
ISBN : 9782330149024 · publié le 6 avril 2021
Description complète et liste des 3 épisode(s) qui le citent
Un chien à Londres en 1903, un singe à Riverside en 1985, une vache et son veau à Charleville-Mézières en 2014 sont les protagonistes de cette fresque en trois panneaux qui évoque les rapports entre animaux et humains à l’ère industrielle, ou plus précisément l’assujettissement d’êtres vivants doués de sensibilité à d’autres êtres vivants doués de sensibilité mais également dotés d’une froide rationalité.
Cité dans 3 épisode(s) :L'idéologie raciste · Genèse et langage actuel Colette Guillaumin

ISBN : 9783111269757 · publié le 1 janvier 1970
Description complète et liste des 2 épisode(s) qui le citent
Cité dans 2 épisode(s) :Politique sexuelle de la viande · Une théorie critique féministe végétarienne Carol Adams

Dès sa première parution en 1990, La Politique sexuelle de la viande, qualifiée de « bible de la communauté végane » par le New York Times, s'est imposée comme un ouvrage de référence dans le domaine du droit animal.
ISBN : 9782825145326 · publié le 26 mai 2016
Acheter sur Place des LibrairesDescription complète et liste des 4 épisode(s) qui le citent
L'ouvrage de Carol Adams de 300 pages en comptant les notes et les références ; il est truffé de citations et de références littéraires qui documentent une superposition d'oppressions hiérarchisées commençant par les animaux (politique de la viande), les femmes (politique sexuelle), les primitifs et les noirs (politique de la colonisation) ; devant les assiettes de riz et de pommes de terre des gens du Tiers-Monde, les journalistes hommes, blancs, occidentaux s'exclament "mais vous n'avez pas mangé de viande depuis combien de temps ?" ignorant que 80 % des protéines de ces pays proviennent traditionnellement de céréales et de légumineuses à l'inverse de nous, dont 80 % des protéines sont des céréales et des légumineuses de seconde main, issues d'animaux , protéines femelles ou protéines plus viriles de la viande rouge.
Cité dans 4 épisode(s) :Solidarité animale · Défaire la société spéciste Yves BONNARDEL, Axelle PLAYOUST-BRAURE
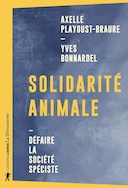
Proposant une synthèse claire et accessible, Axelle Playoust-Braure et Yves Bonnardel montrent en quoi le spécisme est une question sociale fondamentale et plaident en faveur d'un changement de civilisation proprement révolutionnaire.
ISBN : 9782348059278 · publié le 18 juin 2020
Description complète et liste des 4 épisode(s) qui le citent
Malgré la visibilité croissante de la " question animale ", la confusion règne parmi ses divers commentateurs. Les termes dans lesquels le débat est posé, y compris dans les milieux progressistes, empêchent d'en comprendre les enjeux véritables. C'est en particulier le cas pour la notion de " spécisme ", qui désigne une discrimination fondée sur le critère de l'espèce, et postule la supériorité des humains sur les autres animaux. Cette hiérarchisation des individus selon leur espèce a pourtant des effets très concrets : aujourd'hui, ce sont plus de 1 000 milliards d'animaux qui sont exploités et tués chaque année pour leur chair, parmi lesquels une vaste majorité d'animaux aquatiques. Comment est-il possible de continuer à justifier toutes ces souffrances et morts d'êtres pourvus de sensibilité ? Cet ouvrage, en dévoilant l'impasse théorique, éthique et politique dans laquelle nous enferme la société spéciste, clarifie les réflexions développées par le mouvement antispéciste en France. Proposant une synthèse claire et accessible, Axelle Playoust-Braure et Yves Bonnardel montrent en quoi le spécisme est une question sociale fondamentale et plaident en faveur d'un changement de civilisation proprement révolutionnaire.
Cité dans 4 épisode(s) :4 autres références :
- La newsletter animaliste Animatopie (www.animatopie.com)
- le complexe animalo-industriel est un concept forgé par l'anthropologue culturelle et philosophe néerlandaise Barbara Noske (concept)
- le mémoire de master en sociologie d'Axelle Playoust-Braure "L'élevage comme rapport d'appropration naturalisé. Le cas du publispécisme" (www.academia.edu)
- Les mouvements antiracistes comme le Front Uni des immigrations et des quartiers populaires (http://fuiqp.org) fondé par le sociologue Saïd Bouamama ou le comité Vérité et justice pour Adama (www.justicepouradama.co)
 Comme un poisson dans l’eau
Comme un poisson dans l’eau